Pouvez-vous commencer par nous expliquer ce qu’est cette sous-section du CNU que vous présidez, et à quoi elle sert ?

À partir du moment où une discipline, en l’occurrence les sciences infirmières, est reconnue par l’université française, toute une organisation doit se mettre en place. Parmi ces éléments de structuration, il y a les sections du CNU, qui ont plusieurs missions : étudier les dossiers de candidature à la qualification des futurs enseignants-chercheurs (qui est une étape préalable au concours que peuvent passer les candidats pour obtenir des postes), contribuer à la réflexion sur la carrière des enseignants-chercheurs, et enfin un rôle de médiation quant aux conditions de la qualification et au positionnement de la discipline.
Cet article a été publié dans le n°50 d’ActuSoins magazine (septembre-octobre-novembre 2023).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Combien la discipline compte-t-elle de membres ?
Nous avons une douzaine de maîtres de conférences, et un professeur… Concernant les doctorants, il est difficile d’avoir une évaluation, car nous sommes dans une phase de transition qui n’appelle pas nécessairement un positionnement clair et net des universités sur le doctorat en sciences infirmières. Il faut rappeler que jusqu’en 2019, les infirmières qui souhaitaient faire un doctorat n’avaient pas la possibilité de le faire en sciences infirmières. La plupart choisissaient les sciences de l’éducation, la sociologie, la santé publique…
Quand la sous-section a été créée, toutes les universités n’ont pas eu le même positionnement, en vertu de leur autonomie. Certaines universités, comme la mienne, ont déclaré clairement un doctorat en sciences infi rmières, et d’autres ont estimé que cette discipline viendrait plutôt contribuer à des thématiques plus larges : environnement et santé, population, société et santé, etc.
Pensez-vous qu’il faudrait que davantage d’universités aillent vers le doctorat en sciences infirmières ?
C’est mon souhait, même si cela ne semble pas être le choix majoritaire. Je pense que dans ce moment de création de la discipline, il faut lui donner de la visibilité, la faire valoir. Si elle est noyée dans d’autres filières, ou dans des thématiques trop générales, si elle manque de lisibilité, on risque d’avoir une discipline sur le papier, mais peu existante dans les faits.
Pouvez-vous nous donner une idée des travaux qui sont menés dans le cadre de doctorats infirmiers ?
Je pense par exemple à une recherche sur l’environnement capacitant dans la prise en soin des patients, une autre sur la notion de répit chez les aidants et les organisations qui en découlent, une autre encore sur la consultation infirmière d’éducation thérapeutique dans le suivi des patients atteints de BPCO [Bronchopneumopathie chronique obstructive, N.D.L.R.], ou à une dernière sur la place du théâtre animé par des infirmiers dans la prévention du VIH en République démocratique du Congo… Mais il faut noter que ces exemples sont orientés par le fait que nous sommes un laboratoire qui s’intéresse beaucoup aux sciences infirmières dans leur dimension de promotion de la santé.
Diriez-vous que les sciences infirmières, en tant que discipline universitaire, sont encore en cours de construction ?
Largement. Treize enseignants-chercheurs dispersés entre sept ou huit universités, ce n’est rien en comparaison de ce qu’on voit dans d’autres disciplines. Par ailleurs, il faut que les laboratoires, les universités, les UFR jouent le jeu, qu’ils aident les chercheurs à construire cette discipline et à la valoriser. Il serait également souhaitable que l’Inserm s’intéresse à notre jeune discipline, soit en créant une unité de sciences infirmières, soit par un autre moyen. Il faut enfin que les pouvoirs publics, à commencer par le ministère de la Santé, soutiennent la création de cette discipline sur une période assez longue. Si ces conditions sont réunies, ce qui est possible, alors les choses pourront se mettre en place, et ce sur plusieurs années…
Est-ce que l’un des critères de la réussite de la discipline serait qu’un infirmier prenne la place du médecin que vous êtes à la tête de la section du CNU ?
Bien entendu. Pour construire une section du CNU, il y a des conditions en termes de nombre de professeurs et de maîtres de conférences. Lorsque notre section a été mise en place, ces conditions n’étaient pas réunies, que ce soit pour ce qui est du nombre de maîtres de conférences ou pour ce qui est du nombre de professeurs. Il a bien fallu commencer avec des personnes qui étaient déjà engagées dans ce domaine. Aujourd’hui, les choses se sont modifiées, et nous commençons à renouveler la section avec des maîtres de conférences en sciences infirmières. En ce qui concerne les professeurs, il en faut trois, et il en manque donc encore deux, mais nous les aurons dans quelques années.
Propos recueillis par Adrien Renaud
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine n°50 septembre-octobre-novembre2023
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
[maxbutton id=”2″


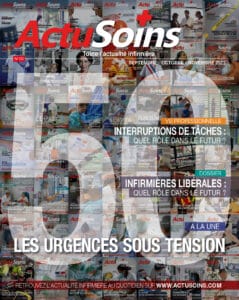 Cet article a été publié dans le n°50 d’ActuSoins magazine (septembre-octobre-novembre 2023).
Cet article a été publié dans le n°50 d’ActuSoins magazine (septembre-octobre-novembre 2023).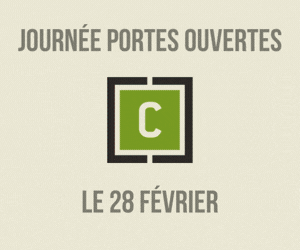









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.