La surveillance de la péridurale nécessite une compétence et une vigilance accrues, notamment de la part des infirmiers.

Sommaire
ToggleQu’est-ce qu’une péridurale ?
La péridurale est une méthode d’anesthésie loco-régionale qui joue un rôle crucial dans la gestion de la douleur, tant pour l’analgésie périopératoire et post-opératoire de diverses interventions chirurgicales que pour l’analgésie obstétricale.
Bénéfices de la péridurale
Cette technique est particulièrement bénéfique lors de chirurgies abdominales et thoraciques, où une gestion efficace de la douleur est essentielle pour la récupération du patient. En obstétrique, la péridurale est souvent choisie pour soulager les douleurs de l’accouchement. En offrant une analgésie efficace et prolongée, elle améliore considérablement le confort et le bien-être des patients.
Techniques de mise en place

 Rôle de l’infirmier
Rôle de l’infirmier
Lors de la pose de la péridurale, l’infirmier joue un rôle à la fois auprès du patient et auprès du médecin qui insère le cathéter. En ce qui concerne le patient, il explique le geste et le déroulement de l’intervention, et veille à ce que celui-ci soit correctement installé, généralement en position assise avec le dos arrondi. Cette posture est essentielle pour optimiser l’accès à l’espace péridural : plus le patient est détendu et le dos bien courbé, plus l’espace entre les vertèbres s’ouvre, rendant la ponction plus aisée. En parallèle, l’infirmier assiste le médecin en préparant le matériel stérile nécessaire et en s’assurant du respect strict des règles d’asepsie.
Analgésie : médicaments utilisés
Le cathéter péridural sert de conduit pour l’administration de divers médicaments. Les anesthésiques locaux, tels que la bupivacaïne, la levobupivacaïne, la lidocaïne, et la ropivacaïne, sont couramment utilisés pour anesthésier la région cible et bloquer la transmission des signaux de douleur au cerveau. En plus des anesthésiques locaux, des adjuvants comme le sufentanil, la morphine et la clonidine, peuvent être ajoutés pour améliorer l’efficacité de l’anesthésie et prolonger sa durée.
Péridurale : Surveillance peropératoire et post-opératoire par l’infirmière
Lorsque la pose de la péridurale se fait au bloc opératoire, la surveillance peropératoire est réalisée par l’infirmier anesthésiste sous la responsabilité du médecin anesthésiste. En post-opératoire, cette surveillance est reprise par l’infirmier de salle de réveil, puis par celui du service de chirurgie. Lorsque la pose a lieu en salle de naissance, la surveillance est réalisée par l’infirmier du service ou la sage-femme, en collaboration avec l’infirmier anesthésiste. Une surveillance rigoureuse est essentielle pour garantir l’efficacité de la péridurale, détecter rapidement les complications potentielles et ajuster le traitement en fonction de l’état du patient.
Elements de surveillance
Les éléments de surveillance comprennent :
- La prise des paramètres vitaux : fréquence cardiaque (FC), saturation en oxygène (SpO2), tension artérielle (TA), fréquence respiratoire (FR).
- L’évaluation de la douleur à l’aide d’outils d’évaluation tels que l’Échelle visuelle analogique (EVA), l’Échelle verbale simple (EVS) ou l’échelle numérique.
- L’évaluation du degré du bloc moteur à l’aide du score de Bromage (il ne doit pas y avoir de bloc moteur) :
- – 0 = absence de bloc moteur (le patient peut fléchir les hanches, les genoux et les pieds)
- – 1 = incapacité du patient à surélever les jambes étendues mais fl exion des genoux et des pieds possible
- – 2 = incapacité à fléchir les genoux mais flexion des pieds possible
- – 3 = incapacité à fléchir les pieds
- La vérification de la conscience.
- La surveillance de l’apparition d’effets secondaires.
- La vérification de l’aspect du point d’entrée du cathéter pour détecter toute infection.
- La vérification de la bonne connexion et de la fixation du cathéter.
- La vérification du réglage de la PCEA (Analgésie contrôlée par le patient) selon la prescription médicale.
- L’évaluation de la reprise de la diurèse et la vérification de l’absence de globe vésical.
Consignes pour les patients
Il n’existe pas de consignes particulières pour les patients porteurs d’une péridurale en post-opératoire dans les services de chirurgie, à l’exception de ne pas se lever ou marcher seuls. Ils peuvent dormir sur le dos, mais doivent éviter de le frotter pour ne pas déplacer le cathéter. En général, la péridurale est utilisée pour des interventions lourdes, le patient en convalescence ne se mobilise donc que très peu.
Fréquences des contrôles
Le rythme de surveillance doit être strictement respecté pour prévenir et identifier les complications à un stade précoce.
- Le médecin qui pose la péridurale effectue une surveillance rapprochée de vingt minutes après l’administration de la dose test, pour s’assurer d’une absence d’intoxication aux anesthésiques locaux.
- Durant les quatre à six premières heures suivant l’insertion du cathéter péridural, une surveillance horaire est impérative. Cette période est critique car le risque de complications est le plus élevé.
- Passé ce délai, la fréquence des contrôles peut être espacée, généralement toutes les six heures, en fonction de l’état clinique du patient. Un ajustement peut être nécessaire si l’état du patient évolue.
Actions en cas de problème
Pour tout problème détecté il est impératif d’appeler immédiatement le médecin anesthésiste-réanimateur (MAR) selon le protocole de l’établissement.
Péridurale : Gestion du pansement
Sauf indication contraire d’un protocole de service, le pansement est en général changé tous les deux à trois jours. S’il est souillé ou si les bords se décollent, il est remplacé plus tôt. La zone autour du site d’insertion est nettoyée avec une solution antiseptique, puis laissée à sécher à l’air avant l’application d’un nouveau pansement stérile. Lors du changement, il est important de décoller doucement le pansement pour éviter de tirer sur le cathéter, et d’éviter l’utilisation de ciseaux pour prévenir le risque de section.
Objectif du pansement
Le nouveau pansement en place, transparent pour permettre de visualiser le site d’insertion, adhère totalement à la peau. L’objectif principal est de minimiser le risque d’infection tout en maintenant l’intégrité du dispositif.
Péridurale : complications et effets secondaires
Bien que la péridurale soit considérée comme une méthode sûre et efficace elle peut entraîner certaines complications. Ces dernières peuvent varier en gravité :
- Bradycardie : une diminution de la fréquence cardiaque peut survenir
- Hypotension artérielle : une des complications les plus courantes causée par la vasodilatation induite par la péridurale
- Brèche durale : ponction accidentelle de la dure-mère
- Péridurale extensive
- Rachianesthésie totale
- Hématome péri-médullaire
- Abcès péridural
- Asymétrie d’analgésie
- Anesthésie sous-durale : administration accidentelle sous la dure-mère
- Intoxication aux anesthésiques locaux : l’absorption systémique excessive des anesthésiques locaux peut provoquer des symptômes de toxicité, y compris des convulsions, une arythmie cardiaque et, dans les cas extrêmes, un arrêt cardiaque.
Effets secondaires
La péridurale peut également provoquer des effets secondaires.
- Dépression respiratoire
- Bloc moteur des membres inférieurs
- Nausées/vomissements
- Prurit
- Analgésie insuffisante
- Infection sur cathéter
- Douleurs lombaires ou dorsales.
Infirmiers cadre législatif : responsabilité des infirmières
Le cadre législatif confère aux infirmiers une responsabilité significative dans la gestion de la péridurale. En pratique, cela signifie que les infirmiers doivent être formés et compétents pour évaluer et gérer la douleur, ainsi que pour administrer les médicaments de manière sécurisée via les cathéters périduraux. Ils doivent également être en mesure de reconnaître et de réagir rapidement aux complications potentielles, garantissant ainsi une prise en charge optimale et sécurisée des patients. Leur intervention s’inscrit dans un cadre juridique qui met l’accent sur la surveillance, le rôle propre et le rôle prescrit.
Surveillance de la douleur
L’article R.4311-2 du Code de la santé publique (CSP) stipule que l’infirmier participe activement à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes. Ce rôle fondamental s’étend à diverses situations cliniques, y compris la gestion des dispositifs de péridurale.
L’article R.4311-5 du CSP indique que dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est tenu d’évaluer la douleur. Cette évaluation est essentielle pour adapter les soins et assurer une prise en charge efficace de la douleur, particulièrement importante dans le contexte de l’utilisation d’un cathéter péridural.
L’article R.4311-8 du CSP précise que l’infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques dans le cadre de protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Cela permet une réponse rapide et adaptée aux besoins changeants des patients sous péridurale.
Administration de médicaments dans un cathéter péridural
Les infirmiers sont autorisés à effectuer des réinjections de médicaments à des fins analgésiques dans les cathéters périduraux, sur prescription médicale, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (article R.4311-9 du CSP). L’IADE, quant à lui, est habilité à gérer les dispositifs d’anesthésie loco-régionale dont fait partie la péridurale (article R.4311-12 du CSP) et prend en général en charge la péridurale pendant toute la durée de l’intervention. Il est souvent présent lors de la pose, travaillant en binôme avec le médecin anesthésiste réanimateur.
En salle de naissance utilisation courante de la péridurale
En 2021, l’enquête nationale périnatale a montré que 82 % des femmes accouchaient avec une péridurale, faisant de la France le pays où cette anesthésie est la plus couramment utilisée dans ce cadre. La péridurale est une analgésie efficace pour le travail et l’accouchement dans plus de 98 % des cas. Elle offre également une analgésie adéquate en cas de manoeuvres d’extraction instrumentale ou de césarienne en urgence, ce qui permet d’éviter les risques associés à l’anesthésie générale.
Indications de la péridurale
Au-delà du choix de la mère, certaines indications obstétricales et médicales peuvent rendre cette intervention nécessaire. Les indications obstétricales incluent la présentation du siège, la grossesse gémellaire, l’utérus cicatriciel, les anomalies d’insertion placentaire. Les indications médicales englobent les antécédents d’hémorragie du post partum sévère, l’obésité morbide, les facteurs de risque d’intubation difficile ainsi que les contre indications aux efforts expulsifs, telles que le pneumothorax et certaines pathologies ophtalmologiques.
Délivrance de la péridurale
Aucune dilation minimale n’est requise pour administrer une péridurale, tant que le travail est en cours. De même, aucune dilatation maximale ne contre-indique la pose, sauf si la naissance du bébé est imminente.
Julie VIOLET
IADE, Master en pédagogie en sciences de la santé
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Surveillance et gestion de la péridurale : Un guide pour les infirmiers
La péridurale est une technique d’anesthésie couramment utilisée lors des accouchements, permettant aux patientes de vivre ce moment avec moins de douleur. Cependant, sa surveillance et sa gestion sont essentielles pour garantir la sécurité et le confort des patientes.
Importance de la surveillance
Les infirmiers jouent un rôle crucial dans le suivi des patients sous péridurale. Cela inclut l’évaluation régulière des signes vitaux, l’observation de la douleur et la vigilance vis-à-vis des effets secondaires potentiels. Une communication claire avec la patiente est également nécessaire, lui permettant d’exprimer ses besoins et ses préoccupations.
Gestion des complications
Il est essentiel d’être préparé à gérer diverses complications pouvant survenir avec l’utilisation de la péridurale, telles que l’hypotension ou les maux de tête posturaux. Les infirmiers doivent être formés pour identifier rapidement ces problèmes et fournir des interventions appropriées pour assurer la sécurité de la patiente.
Conclusion
En tant qu’infirmiers, votre expertise dans la surveillance et la gestion de la péridurale est inestimable. Un bon suivi peut faire une différence significative dans l’expérience de la patiente pendant l’accouchement, soulignant l’importance de la formation continue et de la mise à jour des pratiques.
Exemples de scénarios cliniques en péridurale pour les infirmiers
La péridurale est une technique d’anesthésie loco-régionale couramment utilisée dans différents contextes cliniques, notamment l’obstétrique et la chirurgie. Comprendre les divers scénarios cliniques peut aider les infirmiers à mieux se préparer à la surveillance et à la gestion des patients sous péridurale. Voici quelques exemples de scénarios cliniques illustrant l’importance de la surveillance infirmière.
Scénario 1 : Accouchement avec péridurale
Contexte
Marie, 28 ans, est admise à la maternité pour accouchement. Après plusieurs heures de travail, elle décide de recevoir une péridurale pour soulager la douleur.
Interventions infirmières
- Préparation et communication : L’infirmier explique la procédure de mise en place de la péridurale à Marie, répond à ses questions et la calme avant l’intervention.
- Positionnement : Il aide Marie à se placer en position assise, le dos courbé pour faciliter l’insertion du cathéter.
- Surveillance post-anesthésie : Après la mise en place de la péridurale, il surveille la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et évalue régulièrement l’intensité de la douleur à l’aide de l’échelle EVA.
Complications potentielles
L’infirmier reste vigilant aux signes d’hypotension, de bradycardie ou de complications liées à la ponction, telles que des céphalées post-ponction.
Scénario 2 : Chirurgie orthopédique
Contexte
Jean, 65 ans, doit subir une arthroplastie totale de la hanche sous péridurale. Il présente des antécédents de cardiopathie, ce qui complique la gestion anesthésique.
Interventions infirmières
- Évaluation pré-anesthésique : L’infirmier évalue l’état de santé général de Jean, vérifie ses antécédents médicaux et son consentement éclairé.
- Surveillance intra-opératoire : Pendant la durée de l’intervention, il surveille les paramètres vitaux et le bloc sensitif de Jean. Il s’assure que l’anesthésiste est informé de toute anomalie.
- Gestion de la douleur : Après la chirurgie, il administre des analgésiques via le cathéter péridural et surveille l’efficacité du traitement.
Complications potentielles
L’infirmier reste attentif aux signes de complications telles que des réactions allergiques aux médicaments ou des effets secondaires au niveau du site de ponction.
Scénario 3 : Gestion de la douleur post-opératoire
Contexte
Sophie, 40 ans, a subi une hystérectomie et reçoit une péridurale pour un soulagement prolongé de la douleur.
Interventions infirmières
- Surveillance post-opératoire : L’infirmier évalue la douleur de Sophie à intervalles réguliers et ajuste le débit de la péridurale si nécessaire, suivant les protocoles.
- Surveillance des effets secondaires : Il surveille les effets secondaires éventuels, notamment la rétention urinaire ou la dépression respiratoire, et communique avec l’anesthésiste si des problèmes surviennent.
- Évaluation de la mobilité : Il évalue le degré du bloc moteur de Sophie à l’aide du score de Bromage, s’assurant qu’elle ne présente pas de bloc excessif.
Complications potentielles
Les complications comme une infection au site de ponction, des signes de choc, ou une anesthésie sous-durale peuvent survenir, requérant une intervention rapide.
Conclusion
Ces scénarios cliniques illustrent l’importance de la vigilance et de la compétence des infirmiers dans la surveillance et la gestion des patients sous péridurale. La formation continue et la bonne communication avec l’équipe médicale sont essentielles pour garantir des soins optimaux et une prise en charge sécurisée des patients.
✅ FAQ – Surveillance et gestion de la péridurale (Guide infirmier)
Qu’est-ce qu’une analgésie péridurale ?
L’analgésie péridurale est une technique d’anesthésie loco-régionale consistant à injecter des anesthésiques locaux et/ou des morphiniques dans l’espace péridural afin de diminuer la douleur tout en maintenant la conscience et la mobilité partielle.
Dans quels contextes utilise-t-on la péridurale ?
Elle est principalement utilisée :
- pendant le travail et l’accouchement,
- lors d’interventions chirurgicales du bas du corps,
- en post-opératoire pour un contrôle prolongé de la douleur.
Quels sont les rôles de l’infirmier(ère) dans la surveillance d’une péridurale ?
Selon les recommandations habituelles, l’infirmier doit :
- s’assurer du bon fonctionnement de la pompe (si PCA ou perfusion continue).
- surveiller les paramètres vitaux (TA, FC, FR, SpO₂),
- évaluer la douleur à intervalles réguliers,
- contrôler le bloc moteur et sensitif,
- vérifier le point d’insertion du cathéter et les signes d’infection,
- surveiller les effets secondaires potentiels,
- s’assurer du bon fonctionnement de la pompe (si PCA ou perfusion continue).
Quels paramètres doivent être surveillés après la pose d’une péridurale ?
Après la pose, la surveillance inclut :
- tension artérielle toutes les 5 à 15 minutes au début,
- fréquence cardiaque,
- fréquence respiratoire,
- saturation en oxygène,
- niveau de sédation,
- intensité de la douleur,
- extension du bloc sensitif (test au froid),
- bloc moteur (score de Bromage).
Quels sont les principaux effets secondaires d’une péridurale ?
Les effets secondaires les plus fréquents incluent :
- hypotension,
- prurit,
- rétention urinaire,
- nausées/vomissements,
- bloc moteur trop étendu,
- céphalées post-ponction accidentelle de la dure-mère,
- insuffisance respiratoire (rare, mais grave en cas d’opioïdes).
Comment reconnaître une complication grave ?
Les signes d’alerte incluent :
- chute importante de la tension,
- dyspnée ou bradypnée,
- bloc moteur asymétrique ou s’étendant jusqu’aux membres supérieurs,
- fièvre ou douleur au point d’insertion,
- signes neurologiques inhabituels,
- suspicion d’hématome péridural (urgence absolue).
Quelle est la conduite à tenir en cas d’hypotension liée à la péridurale ?
La prise en charge habituelle consiste à :
- placer la patiente en décubitus latéral,
- administrer un remplissage vasculaire selon protocole,
- vérifier la dose injectée,
- contacter l’anesthésiste en cas de non-amélioration.
Comment évaluer l’efficacité de la péridurale ?
L’efficacité est évaluée par :
- la diminution de la douleur (échelle EVA),
- l’apparition du bloc sensitif,
- le maintien d’un bloc moteur modéré mais non incapacitant.
Quelle surveillance du cathéter péridural est nécessaire ?
L’infirmier doit vérifier :
- la fixation du cathéter,
- l’absence de saignement ou de fuite de LCR,
- la propreté du pansement,
- les signes d’infection (rougeur, chaleur, douleur).
Quand retirer le cathéter péridural ?
Il est retiré :
- sur prescription médicale,
- après la fin de la perfusion analgésique,
- en l’absence de complications.
- Le retrait se fait en respectant l’asepsie et en vérifiant l’intégrité du cathéter.
Quelles sont les contre-indications à la péridurale ?
Principales contre-indications :
- refus du patient,
- troubles de la coagulation,
- infection au point de ponction,
- choc hémodynamique,
- hypertension intracrânienne sévère.
Quels documents infirmiers doivent être complétés ?
Selon les recommandations usuelles :
- traçabilité des paramètres vitaux,
- évaluation de la douleur,
- surveillance du bloc sensitif et moteur,
- incidents ou effets secondaires,
- débit et contrôles de la pompe si applicable.



 Rôle de l’infirmier
Rôle de l’infirmier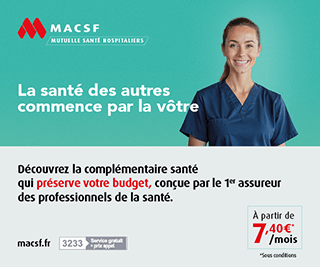








Vous devez être connecté pour poster un commentaire.