Dans les établissements sanitaires, des assistants sociaux sont à pied d’oeuvre dans une bonne partie des services. Leur mission auprès des équipes soignantes permet d’optimiser la qualité des parcours de soins et de vie, par une prise en charge globale, pendant et après l’hospitalisation. Exemple au CHU de Montpellier.

Prévenir les impacts sociaux de la maladie, préparer la sortie d’hospitalisation, protéger les personnes vulnérables… une soixantaine d’assistants sociaux exercent dans différents pôles du CHU de Montpellier. Une partie a ses bureaux directement dans les services de soin – en psychiatrie, en hématologie, dans le service des maladies infectieuses tropicales par exemple – les autres ont des bureaux dédiés attenant au bureau des entrées. Tous travaillent de concert avec les équipes soignantes pour accompagner les patients durant leur hospitalisation. Ils sont déjà en première ligne pour faciliter l’accès aux soins et maintenir sa faisabilité.
L’accès aux soins avant tout
« Faute de prise en charge, totale ou complémentaire, des personnes renoncent à leurs soins », explique Céline Ericher-Fourré, assistante sociale dans le service de gérontologie du centre Antonin Balmès. « Beaucoup de patients n’ont pas de mutuelle, d’autres n’ont pas de Sécu parce qu’une démarche n’a pas été mise en œuvre lors d’un changement de statut ou parce qu’elles arrivent sur le territoire. » Son rôle : récupérer un droit perdu, activer les dispositifs existants pour les personnes qui n’entrent pas dans les critères… « Cette mission est principale, mais ce n’est pas la seule », avertit la professionnelle. Cette assistante sociale travaille directement avec les médecins et infirmiers au sein même du service où elle est intégrée et où sont accueillis des publics de plus de 75 ans, souvent en perte d’autonomie.
L’accompagnement social permet de trouver des solutions pour adapter le retour au domicile à la perte d’autonomie. Le travail se fait en étroite collaboration avec les médecins, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes… par le biais de staffs hebdomadaires pour faire le point sur tous les aspects. « Avoir une vue d’ensemble de la situation pour accompagner au mieux le projet de vie du patient est capital », précise l’assistante sociale. « Etre inclus dans l’équipe crée une bonne dynamique. » Pour cette professionnelle, l’idée est de tout mettre en place, créer du lien avec les partenaires extérieurs, monter des dossiers, orienter, coordonner… pour que la sortie se passe au mieux. « Nous nous assurons que tous les relais soient pris hors de l’hôpital », précise-t-elle. « Nous sommes une courroie entre l’intra et l’extra hospitalier. »
Au cas par cas
Idem au pôle de psychiatrie adulte dans lequel travaillent vingt assistants sociaux, l’effectif le plus gros dans un service. « Les conséquences d’une pathologie psychiatrique peuvent être plus importantes, plus globales, sur tout le fonctionnement de la personne et sur ses vulnérabilités à l’extérieur, que celles d’une pathologie physique », explique Mathilde Domec, assistante sociale dans l’unité d’hospitalisation. « La sortie ne peut pas se faire de la même manière que pour un patient classique. » Elle est présente au quotidien dans le service afin que les IDE puissent la solliciter facilement au cas où, et elle fait ses consultations à l’étage dans des bureaux dédiés.
Tous les jours, il y a là aussi, les temps pour l’échange médical (staffs avec les médecins et soignants et relèves infirmières) et des rendez-vous plus individualisés avec les patients, à leur demande ou sur orientation d’un médecin. « Nous pouvons nous auto-saisir en fonction d’éléments présentés par les praticiens ou par les IDE aux relèves », indique Mathilde Domec. L’écoute des familles, l’orientation vers une structure est une autre partie intégrante du travail. « Nous travaillons beaucoup avec les infirmiers dans cet accompagnement. » Aller ensemble à domicile, s’il faut évaluer un patient, prévoir un étayage des soins, se relayer en fonction des démarches…
Un rôle pivot indispensable
« Leur rôle pivot est indispensable dans le parcours du patient » estime Julie Pezzatini. « Cela amène une autre dimension au soin » estime cette IDE du Centre de lutte anti-tuberculose (CLAT), à l’hôpital Arnaud de Villeneuve qui soigne des populations précaires, parfois dans un parcours d’exil. Elle est par ailleurs très impliquée dans l’Education thérapeutique du patient (ETP). « Expliquer sa pathologie à une personne malade nécessite parfois de reformuler avec des mots pas forcément scientifiques, qui seront bien compris. »
Cette infirmière travaille en binôme avec une assistante sociale, notamment lors du premier entretien avec le patient. « Nous avons un public en demande d’aide, et c’est très rassurant d’avoir à proximité une personne à même d’apporter des réponses que nous soignants n’avons pas. » Comme faire comprendre que ne pas honorer un rendez-vous médical n’est pas obligatoirement signe de désintérêt mais plutôt dû à des contraintes qui peuvent échapper aux soignants. « Travailler dans cette complémentarité avec des assistantes sociales permet d’avoir une approche réellement globale. Elles sont des facilitateurs de soin et de vie. »
Myriem Lahidely
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus |
|
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus |
|





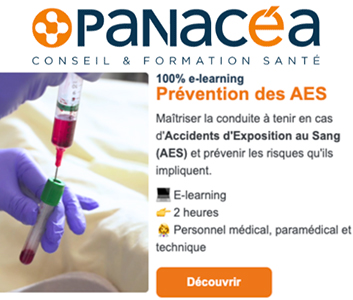



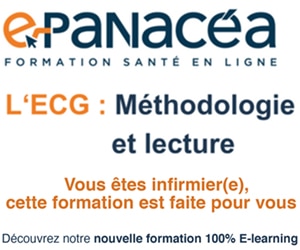
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.