Février 2022, Christelle Calmettes, photographe, prévoit une quinzaine de jours pour suivre le travail des équipes du CHANGE (Centre Hospitalier Annecy Genevois) sur le don d’organes et de tissus. Une douzaine de jours passent ponctués par deux refus de don par des proches. Puis, un arrêt thérapeutique (LAT) est programmé chez un jeune patient, en raison du pronostic. Il s’agit d’un des quatre cas de prélèvements d’organes sur donneurs décédés, après LAT et arrêt circulatoire (catégorie III de Maastricht)*, autorisé en France depuis 2015. Le CHANGE a été le premier centre à pratiquer des prélèvements dans ce cadre et forme d’autres établissements à cette procédure.
Ce dossier a été publié dans le n°45 d’ActuSoins Magazine (juin-juillet-août 2022).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous !
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Une procédure codifiée
Après une décision collégiale de LAT par l’équipe médicale qui suit le patient, l’équipe de la CDOT (Coordination Don d’Organes et de Tissus) prend le relais pour recenser et « qualifier » le donneur potentiel grâce à des premiers bilans et la recherche de contre-indications. Puis, un entretien est réalisé par l’équipe de la CDOT (Coordination don d’organes et de tissus) avec les proches. Objectif : les informer sur la procédure et s’assurer de l’absence d’opposition au don. Ils seront accompagnés tout au long du processus.
Le patient et donneur potentiel est alors recensé après validation par l’agence de Biomédecine (ABM) et les premières informations sont entrées dans un dossier Cristal, le logiciel de l’ABM, qui va anonymiser le dossier.
Les bilans permettent de vérifier si les organes sont prélevables et greffables et comprennent notamment un scanner corps entier, une échographie cardiaque, une fibroscopie (pour une greffe de poumons), une coronarographie et une sérologie ainsi qu’un typage HLA (pour apprécier la compatibilité tissulaire donneur/receveur). Quand le dossier Cristal est complet, les équipes de prélèvements de greffe des différents CHU sont informés et des choix sont effectués en fonction des priorités de la liste nationale des malades en attente de greffe.
Compte à rebours
Commence alors un vrai marathon : pour chaque organe, les équipes qui réaliseront ensuite la transplantation viennent au CHANGE pour réaliser les prélèvements. La LAT est mise en oeuvre dans la chambre du patient en réanimation. Après le décès, le registre national des refus est interrogé. Puis, la circulation régionale normothermique (CRN) est mise en place, toujours en réanimation, avant que le donneur ne soit amené au bloc pour les prélèvements. La phase d’ischémie chaude fonctionnelle – depuis l’AT jusqu’à la perfusion des organes par CRN – est minutée. Ensuite, entre le moment où l’organe est prélevé et le moment où il est greffé, il ne faudra pas dépasser 3 à 4 heures pour un coeur, 6 heures en moyenne pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon et 18 heures pour un rein.
Texte et photos : Christelle Calmettes
* La classification de Maastricht définit quatre catégories de donneurs décédés suite à un arrêt circulatoire (DDAC) : personnes décédées ayant fait un arrêt circulatoire en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée ; personnes ayant fait un arrêt circulatoire en présence de secours qualifiés, mais la réanimation n’a pas permis la récupération de l’activité circulatoire (DDAC-M2) ; personnes hospitalisées décédées, suite à une décision de LAT (DDAC-M3) ; personnes décédées en mort encéphalique ayant fait un arrêt circulatoire irréversible au cours de la réanimation (DDAC-M4).
Une prise en charge des plaies exsudatives, dès la détersion. Testez gratuitement les nouveaux formats |  |
|---|---|
| Grâce à sa couche super absorbante, UrgoStart Plus Absorb possède de hautes capacités d’absorption. Je souhaite recevoir des échantillons ! | |


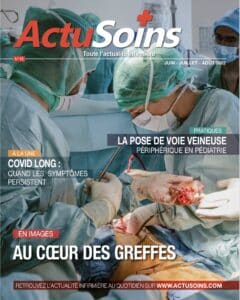 Ce dossier a été publié dans le n°45 d’ActuSoins Magazine (juin-juillet-août 2022).
Ce dossier a été publié dans le n°45 d’ActuSoins Magazine (juin-juillet-août 2022).






Soyez le premier à laisser un commentaire !