Les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) connaissent actuellement une transformation profonde sur les plans organisationnel, financier et qualitatif. Si les objectifs des réformes semblent compris et partagés, leur mise en oeuvre génère de nombreux questionnements.
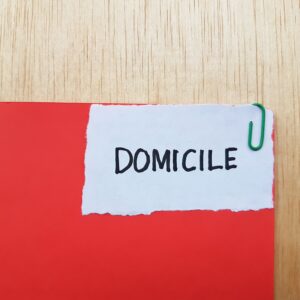 « Les SSIAD ont trois priorités à remplir, à savoir assurer le maintien des personnes à domicile, éviter leur hospitalisation et empêcher leur institutionnalisation », résume Christine Chatelain, ancienne infirmière et directrice de l’Association Soins à domicile de Fontainebleau et sa Région (SDFR SSIAD) en Seineet- Marne. « La prise en charge par un SSIAD relève généralement du choix du patient, mais en réalité, c’est souvent l’opportunité d’une place qui le conduit à le solliciter », poursuit Virginie Merlatti, ancienne infirmière et directrice de l’offre de soins du SSIAD Val’santé (Drôme). Des places se libèrent lorsque les patients retrouvent leur autonomie ou, à l’inverse, entrent en Ehpad ou décèdent.
« Les SSIAD ont trois priorités à remplir, à savoir assurer le maintien des personnes à domicile, éviter leur hospitalisation et empêcher leur institutionnalisation », résume Christine Chatelain, ancienne infirmière et directrice de l’Association Soins à domicile de Fontainebleau et sa Région (SDFR SSIAD) en Seineet- Marne. « La prise en charge par un SSIAD relève généralement du choix du patient, mais en réalité, c’est souvent l’opportunité d’une place qui le conduit à le solliciter », poursuit Virginie Merlatti, ancienne infirmière et directrice de l’offre de soins du SSIAD Val’santé (Drôme). Des places se libèrent lorsque les patients retrouvent leur autonomie ou, à l’inverse, entrent en Ehpad ou décèdent.
Créés en 1981, les SSIAD sont des structures rattachées aux Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Ils sont gérés soit par des organismes privés à but non lucratif, soit par des organismes ou établissements publics. Leur mission est de prodiguer des soins à domicile aux personnes âgées de plus de 60 ans et, depuis 2004, aux personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes de certaines pathologies chroniques. Ces critères d’inclusion définissent le nombre de places attribuées à chaque structure en fonction des besoins du territoire, la prise en charge en SSIAD étant entièrement financée par l’Assurance maladie. Ces structures prennent en charge les patients, uniquement sur prescription médicale avec parfois des orientations par des assistantes sociales ou des services de Soins de suite et réadaptation (SSR).
Cet article a été publié dans le n°55 d’ActuSoins magazine (janvier 2025).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Partage des compétences
Les SSIAD sont organisés autour d’une équipe composée d’aides-soignants pour les soins de nursing, et d’infirmiers, salariés, libéraux ou exerçant dans des centres de santé infirmiers, pour les actes techniques. Le nombre de passages à domicile et le contenu des interventions sont définis selon les besoins de chaque patient, traduits dans un projet d’accompagnement personnalisé.
Depuis 2020, l’Association Toulousaine de soins à domicile (ATSAD), qui gère un SSIAD, a fait le choix de salarier des infirmiers « pour répondre à la demande, offrir une prise en charge globale, de qualité, assurer la continuité des soins et venir en appui aux aides-soignants », énumère Lucille Ratz, infirmière de coordination (Idec) au sein du SSIAD. Leur présence permet aussi à la structure d’accepter de prendre des soins plus complexes. L’équipe poursuit toutefois sa collaboration avec des infirmiers libéraux en raison de l’étendue du secteur d’intervention.
Le SSIAD a également vocation à coordonner les soins à domicile, une mission effectuée par les infirmiers coordinateurs. Ces derniers assurent ainsi le suivi des patients, maintiennent le lien avec les professionnels de santé et la famille, organisent les sorties et gèrent les besoins en matériel. « Je tiens compte des retours des patients et je suis chargée des ajustements du plan de soins », précise Charlotte Girardot, Idec au sein du SSIAD de l’association Gammes, à Montpellier. Côté équipe, elle s’occupe du management, des plannings ou encore des formations.
Fusion des SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) et des SAAD (Services d’accompagnement à domicile)
Parallèlement à la prise en charge quotidienne des patients, les SSIAD connaissent une transformation de leur fonctionnement, marquée par une réforme organisationnelle. Depuis un décret de juillet 2023, ils disposent d’un délai de deux ans et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2025, pour s’adjoindre une activité d’aide, en fusionnant ou en se regroupant avec un ou plusieurs Services d’accompagnement à domicile (SAAD). Dans ce cadre, ils doivent demander une autorisation pour devenir un Service autonomie à domicile (SAD) auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) et du Conseil départemental. Si la convention doit être effective fin 2025, ils disposent d’un délai plus long pour la fusion. La finalité de cette réforme consiste à proposer un guichet unique aux patients ayant besoin de soins et d’aide à domicile. Avec ce nouveau fonctionnement, infirmiers, aides-soignants et aides à domicile seront amenés à travailler davantage ensemble, ce qui permettra de mieux coordonner les passages et d’éviter les glissements de tâches dus au manque de personnel. « Pour autant, les services n’ont pas attendu la loi pour s’organiser autour de la prise en charge du patient », tient à préciser Virginie Merlatti. À Montpellier, le SSIAD de l’association Gammes, qui a expérimenté pendant cinq ans un Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) propose déjà cet accompagnement global. « Pour nous, ce lien entre les soins et l’aide représente une réelle cohérence dans l’accompagnement du public complexe », estime Alain Lefevre, directeur du Pôle Autonomie à domicile-Santé de l’association. En termes d’organisation, les cadres du « soin » et ceux de « l’aide » partagent le même bureau. « Sur nos 200 patients, la moitié sont pris en charge par les deux secteurs, il est donc cohérent qu’ils travaillent ensemble », soutient-il.
Cette fusion représente toutefois un nouveau paradigme parfois complexe à appréhender. C’est le cas à Toulouse où les équipes du SSIAD de l’ATSAD ont commencé l’année dernière à rencontrer des SAAD afin de discuter de la réforme. « Nous n’avons pas toujours été bien reçus car les SAAD n’ont pas d’obligation à se rapprocher du soin », fait savoir Lucille Ratz avant d’ajouter : « Pour autant, je vois un bénéfice avec cette réforme puisque nous allons proposer une offre globale utile pour le bénéficiaire, souvent perdu. » Ce point de vue est également partagé par le réseau associatif ADMR, qui soutient cette démarche pour « tendre vers une simplification du secteur et une meilleure lisibilité pour les usagers », explique Pauline Chevalier, sa responsable santé et autonomie. Des rapprochements, gérés au niveau local, sont d’ailleurs en cours. « Mais sur certains départements, c’est moins évident car les deux types de structures ne sont pas toujours présentes », ajoute-t-elle. De plus, la structuration juridique de la nouvelle entité à créer n’est pas évidente à concevoir. La création de Groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) peut être l’une des solutions. C’est le choix que Christine Chatelain pourrait envisager pour son activité. Néanmoins, « nous avons de nombreuses questions sans réponse, concernant notamment le territoire à couvrir, les conventions des professionnels, le libre choix des patients, reconnaît-elle. Nous aurions aimé bénéficier de l’option du conventionnement de partenariat en lieu et place d’une fusion des structures. »
Les réformes de la tarification et de la qualité
Parallèlement à ces fusions, les SSIAD vivent aussi une réforme de leur tarification. Jusqu’à présent, les frais relatifs aux soins prodigués étaient pris en charge dans le cadre d’une dotation globale déterminée par le nombre de places, indépendamment du profil des usagers. Celle dotation prenait en compte la rémunération des salariés du service ainsi que celle des personnels libéraux, les frais de déplacement, les charges relatives aux fournitures, au petit matériel médical et des autres frais généraux du service. La récente réforme de la tarification, mise en oeuvre depuis mai 2023 et prévue jusqu’en 2027, vise une meilleure adéquation du budget aux profils des personnes accompagnées et aux soins réalisés. La nouvelle dotation comprend trois briques. La première est un forfait global de soins qui bénéficie des nouvelles modalités de calcul, reflétant à la fois l’activité du service et les caractéristiques des personnes accompagnées. La deuxième est une dotation de coordination destinée aux services délivrant des prestations d’aide et de soins, afin de financer les actions garantissant la cohérence de leurs interventions dans ces deux domaines. Enfin, la troisième concerne des financements complémentaires pour certaines actions, des publics spécifiques ou des interventions à des horaires spécifiques.
Pour attribuer des dotations au plus près des réalités du terrain, les acteurs ont dû saisir pendant environ un an l’intégralité des actes effectués par patient, sur la plateforme SIDOBA (Système d’information de l’offre de la branche autonomie). Désormais, pour calculer le montant des forfaits globaux de soins de l’année N, la collecte des données individuelles s’effectue au fil de l’eau, du 1er juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1. Outre la complexité de la mise en oeuvre de la réforme, les acteurs pointent certains écueils. « L’activité de l’année en cours n’est pas forcément identique à celle de l’année du recueil des données, rappelle Pauline Chevalier, regrettant une éventuelle inadéquation entre la dotation et les besoins des patients. Nous restons vigilants sur ce point. » Autre problématique : le niveau de dépendance des patients en situation de handicap ne fait pas partie des données demandées par le nouveau logiciel, donc des indicateurs permettant de déterminer le montant de la dotation. Les SSIAD pourraient également subir des pertes en cas d’hospitalisation longue des patients, puisqu’ils ne sont plus rémunérés pendant cette période. Auparavant, avec le forfait, la place était conservée pendant environ trois semaines. Enfin, la dotation spécifique versée aux SSIAD renforcés (deux à trois passages par jour en binôme) ne l’est plus dans le cadre de cette réforme, ce qui, dans certains cas, « peut inciter à ne plus accepter les prises en charges lourdes, donc conduire à sélectionner les patients », regrette Christine Chatelain.
À ces deux réformes s’ajoute celle de la qualité. Dans le cadre des travaux sur l’évaluation globale des ESMS et la construction d’un référentiel qualité avec un socle commun, la Haute autorité de santé (HAS) entend réguler le secteur avec une évaluation externe tous les cinq ans, effectuée par des évaluateurs accrédités Cofrac. Au regard des autres réformes en cours, celle-ci a été pour le moment gelée. « Il y a une logique derrière tout cela, reconnaît Alain Lefevre. L’ensemble des réformes visent à améliorer l’offre et l’accompagnement proposés aux patients. Mais il aurait été pertinent de pouvoir les mener les unes après les autres car ce cumul de changements peut nous mettre en difficulté. »
Relations entre SSIAD et infirmiers libéraux : un équilibre à trouver
Les relations entre les infirmiers libéraux et les SSIAD sont parfois marquées par des tensions. Un facteur principal contribue à cette situation : les modalités de facturation.
Généralement, si un patient qui s’apprête à être accompagné par un SSIAD dispose déjà d’un infirmier libéral, ce dernier peut poursuivre sa prise en charge uniquement s’il accepte de signer une convention avec le SSIAD. Dans tous les cas, l’intégralité de la facturation relève de la structure. Elle rémunère l’infirmier libéral selon les modalités de la convention qui les lie, ce dernier ne cote alors plus les soins à la Caisse d’assurance maladie (CPAM).
« Il arrive que des infirmiers libéraux refusent de signer une convention, indique Virginie Merlatti, ancienne infirmière et directrice de l’offre de soins du SSIAD Val’santé (Drôme). Dans ce cas-là, il est nécessaire de trouver une solution satisfaisante pour le patient : discussion avec l’infirmier libéral, orientation du patient vers un autre cabinet, etc. »
Les conventions entre les SSIAD et les infirmiers libéraux relèvent du droit privé, la facturation peut donc varier d’une structure à une autre. « Même si d’usage, la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) s’impose, les SSIAD ne sont pas dans l’obligation de la respecter », explique Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI). Cette flexibilité dans les conventions peut entraîner des frustrations concernant la rémunération des soins. Les infirmiers libéraux se heurtent à un autre frein : ils ne peuvent plus facturer de Majoration de coordination infirmière (MCI), car cette coordination est officiellement assurée par les SSIAD.
« Pour ces différentes raisons, les syndicats représentatifs des infirmiers libéraux demandent une externalisation des coûts infirmiers, des forfaits des SSIAD afin que les infirmiers soient payés directement par la Cpam », fait savoir John Pinte, président du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil). Ce fonctionnement, expérimenté pendant la crise sanitaire, « permettrait de créer des synergies à l’échelle des territoires là où aujourd’hui, il existe une forme de concurrence », ajoute Daniel Guillerm, qui plaide pour la signature d’un accord cadre national encadrant les relations entre les SSIAD et les Idel infirmières libérales.
Une prise en charge optimale
Témoignage : Magalie Quinton, infirmière libérale en Isère, en secteur semi-rural
« Depuis environ 20 ans, je travaille avec l’équipe du SSIAD de mon territoire. Nous nous rencontrons régulièrement pour la prise en charge des patients et pour échanger sur de nouveaux outils. Je les sollicite parfois, notamment lorsque la situation de mes patients évolue et qu’ils ont besoin de soins de nursing. Je leur confie d’ailleurs toutes les toilettes. J’ai signé une convention avec ce SSIAD, même s’il n’applique pas la NGAP. J’accepte ce sacrifice bien que je pense qu’il serait logique d’externaliser le financement des soins infirmiers. Quoi qu’il en soit, je reste convaincue que la collaboration entre un SSIAD et un infirmier libéral garantit une prise en charge optimale pour les patients. »
Laure MARTIN
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |

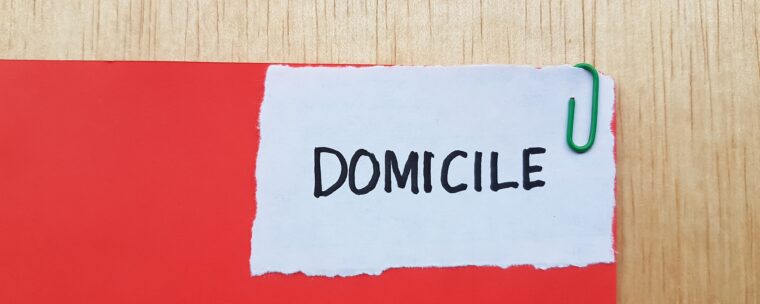
 Cet article a été publié dans le n°55 d’ActuSoins magazine (janvier 2025).
Cet article a été publié dans le n°55 d’ActuSoins magazine (janvier 2025).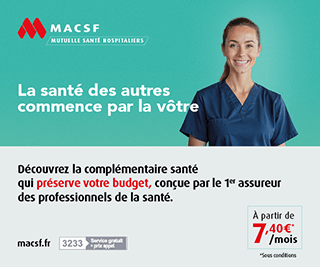









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.