L’arrivée des infirmiers de coordination (IDEC) dans le paysage sanitaire français s’est faite progressivement, au point que ces professionnels sont désormais présents dans un grand nombre de services hospitaliers. Si la coordination est pour eux une mission commune, sur le terrain, son application varie.

Infirmiers de parcours, infirmiers de flux, infirmiers coordinateurs… Leur point commun ? Assurer la coordination des parcours des patients à des échelles variées au sein des services hospitaliers. Car face à l’essor des maladies chroniques et au vieillissement de la population, la complexité des soins et des prises en charge a entraîné une multiplication des acteurs au chevet des patients, qui eux alternent entre soins de ville et hospitalisations. Pour garantir la continuité et la qualité optimale de leur prise en charge, une coordination est requise.
Agir face à la complexité des parcours
Il n’existe pas de définition unique du métier d’infirmier de coordination. En France, certains textes officiels mentionnent la profession, notamment le Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie du ministère de la Santé, qui fait état d’un métier de coordinateur de parcours de santé ou de parcours patient, accessible aux infirmiers sous condition de diplôme. Le deuxième plan Cancer (2014-2019), introduit aussi l’expérimentation des infirmiers de coordination (IDEC) en précisant que « l’intervention de l’IDEC s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire » et que sa mission « consiste à faciliter l’articulation entre les professionnels des soins de ville, les professionnels hospitaliers, les patients et leur entourage ».
Un financement dédié à la coordination des parcours a, par ailleurs, été acté au sein de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) de 2009. « Cette loi a mis en avant la logique de parcours, donc la nécessité de personnaliser la prise en charge avec des acteurs de liaisons ou de coordination », explique Fatima Yatim, maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), qui a participé en 2012 au Projet Capri à Gustave Roussy, sur la mise en place des parcours coordonnés en oncologie.
Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
D’un territoire à l’autre, d’un établissement à l’autre ou même d’un service à l’autre, les logiques d’affectation diffèrent.
Dans le service de cardiologie de l’AP-HM, par exemple, ces postes de coordination ont été, dans un premier temps, ponctionnés sur les effectifs en place. Puis, « après la crise sanitaire, face à l’explosion du nombre de postes d’IDEC et des nouveaux métiers, la direction a décidé de les financer dans cet objectif de fluidifier le parcours des patients », rapporte Zouba Kebaili, cadre supérieure de santé à l’AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille). D’un point de vue organisationnel, « la création de la fonction des IDEC est liée à la conjugaison de plusieurs facteurs. La durée moyenne de séjour a diminué, le turn-over des patients est aujourd’hui important, les cadres de santé ne peuvent donc plus remplir un rôle managérial tout en gérant le flux des patients, en augmentation. »
Déploiement et fiche de poste
S’il apparaît logique que chaque professionnel, dans son activité, assure une part de coordination, pour autant, dans les parcours complexes, cette fonction a tout intérêt à relever d’une seule personne, au risque que des interfaces ne soient pas couvertes. « Dans un monde parfait où tout le monde effectue sa propre coordination, l’IDEC interviendrait uniquement en support, pointe Fatima Yatim. Or, une grande partie des IDEC rattrapent aussi les problèmes des uns et des autres car ils détiennent cette vision globale et des fonctions diverses, pas toujours clairement définies. Ce sentiment d’être un “bouche-trou” est usant et explique parfois les problèmes de recrutement. »
Pour éviter cette situation, certains établissements ont élaboré des fiches de poste, « nécessaires pour clarifier les rôles de chacun, faciliter leur intégration, éviter les glissements de tâches et mieux se coordonner pour une pertinence des soins », soutient-elle. C’est le cas à l’AP-HM, avec toutefois une adaptation des missions en fonction des besoins des services. À Gustave Roussy, un travail a été mené en ce sens en 2012 car « la direction des soins souhaitait que les compétences cliniques des IDEC soient reconnues, tout en tenant compte de leurs dimensions organisationnelles et managériales, indique Fatima Yatim. Nous avons cherché à les équilibrer. »
Répartition des missions
Au sein des services, la répartition des missions entre les différents postes de coordination est parfois complexe à gérer. Car les missions de l’IDEC peuvent s’étendre de l’expertise clinique assez poussée à un versant très administratif. Définir un périmètre de compétences précis et ciblé est nécessaire pour la protection des patients, des IDEC et des médecins en termes de responsabilité.
« Des arbres décisionnels ou des algorithmes de décisions doivent être élaborés afin de s’assurer que le bon intervenant prenne en charge l’information remontée par un patient et la traite en faisant appel à son jugement clinique », estime Fatima Yatim.
À l’AP-HM, Marie-Cécile Gros, infirmière de flux en chirurgie cardiaque, travaille au sein des services de consultations, en lien avec l’IDEC des consultations, qui gère les liens externes. Elle coordonne l’arrivée et la sortie des patients, pour 44 lits. « Je vais nécessairement avoir un contact avec tous les patients dès leur arrivée dans le service », indique-t-elle. Accueil, installation en chambre, réponse aux interrogations, réalisation des examens, procédures pour la sortie d’hospitalisation, explication concernant le transfert vers les Soins de suite et de réadaptation (SSR) : ses missions sont variées. En parallèle, quotidiennement, Marie-Cécile Gros gère le flux permanent des patients dans le service et la logistique, par exemple pour les transports. Elle participe également au staff médical au cours duquel tous les dossiers patients sont abordés. « Je récupère les informations les concernant, le but étant qu’à leur sortie, ils disposent, sur leur compte-rendu, de toutes les informations sur leurs rendez-vous, déjà programmés », précise-t-elle. Une gestion des flux qui auparavant relevait des missions des cadres de santé.
Postes dédiés ou missions partagées
À l’Institut Curie, (sites Paris et St Cloud) l’organisation diffère. L’établissement dispose d’une cellule de coordination des parcours patients, au sein de laquelle les IDEC interviennent uniquement pour les prises en charge très complexes. Ils ont pour mission d’organiser la sortie du patient (Hospitalisation à domicile, professionnels libéraux, etc.), et d’assurer le lien entre les prestataires extérieurs, l’équipe interne et les patients. En parallèle, des infirmiers de coordination d’une activité interviennent au sein de spécialités définies, par exemple en nutrition ou en oncogériatrie. Ils ne coordonnent pas l’intégralité de la prise en charge du patient, mais uniquement le parcours du patient au sein de cette activité. « Ils vont, sur un temps donné, vérifier que l’ensemble des acteurs de la prise en charge sont bien programmés », explique Sabine Belorgey, directrice des soins de l’ensemble hospitalier.
Sadia Bonhomme est justement infirmière référente en oncogériatrie depuis sept ans. Au sein du département interdisciplinaire de soins de support sur le site de Paris, elle travaille en binôme avec deux oncogériatres, en hôpital de jour et en consultation. Dès qu’un patient âgé est pris en charge et qu’un facteur de fragilité a été identifié par un professionnel de santé, il est orienté en oncogériatrie afin d’anticiper des complications éventuelles au regard des pathologies associées. « Mon rôle est de suivre et d’organiser la prise en charge avec les ressources internes telles que le service social ou la nutrition, ainsi que les services externes, pour veiller au suivi du patient et éviter le basculement dans la fragilité, rapporte Sadia Bonhomme. Je remplis les documents et m’assure que le parcours du patient soit fluide. » Elle réalise également les prises de sang, les pansements et les soins de nursing. « Je fais de la coordination, des soins et de l’évaluation de patients en fonction de la problématique complexe identifiée », indique-t-elle. L’Institut Curie est actuellement en train de cartographier les parcours proposés aux patients en fonction des pathologies et des organes. Une réflexion est en cours, en gynécologie, pour proposer une infirmière de parcours pour l’intégralité du parcours patient afin de répondre aux besoins du service.
Une coordination complète

À l’hôpital Foch (Suresnes), le fonctionnement des nombreux services qui disposent d’IDEC, varie. En oncologie, quatre à cinq infirmiers de coordination interviennent à trois niveaux pour la prise en charge des patients venant principalement en hôpital de jour pour leur chimiothérapie. Ils organisent tout d’abord des consultations d’accompagnement, à savoir des consultations infirmières au cours desquelles « nous recevons les nouveaux patients ou ceux qui changent de ligne de traitement, explique Sylvie Chaboud, IDEC en oncologie depuis une quinzaine d’années. Nous allons reprendre toutes les informations transmises par le médecin lors de la consultation d’annonce concernant les traitements, les toxicités, les conseils diététiques ou encore le soutien psychologique et social. »
Les IDEC assurent également de la coordination « pure » à savoir l’organisation de la sortie d’hospitalisation, ainsi que la gestion des appels téléphoniques et des emails des patients de retour à leur domicile. « Nous sommes le lien entre le service, le patient et l’oncologue, souligne Sylvie Chaboud. Dès lors que le patient ou ses proches expriment une problématique rencontrée à domicile, ou une incompréhension, ils peuvent nous contacter. » En fonction, ils gèrent les difficultés en toute autonomie ou sollicitent l’oncologue si nécessaire. « Nous pouvons programmer des hospitalisations, car notre objectif est d’être au maximum dans l’anticipation afin d’éviter le passage aux urgences », rapporte-t-elle.
Enfin, ils interviennent au sein de la maison des soins de support – Institut Line Renaud, afin d’effectuer des consultations de suivi de patients sous traitements (chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapie).
Montée en compétences et formation
Les infirmiers ne deviennent pas IDEC par hasard. « Ils souhaitent souvent renouer avec les fondamentaux de leur métier initial, afin de retrouver le contact au long court avec le patient », analyse Fatima Yatim. Dans tous les cas, exercer à ce poste implique de détenir une solide expérience préalable au sein du service ou du pôle « car malgré le compagnonnage, sans cette antériorité, cela leur prendrait trop de temps pour s’acculturer au réseau », explique Zouba Kebaili. Ce poste requiert également une capacité de jugement basée justement sur la maîtrise de l’environnement et l’expertise acquise au sein du service. Un point de vue partagé par Sabine Belorgey : « À ce poste, il faut un IDE expérimenté. Maîtriser le secteur dans lequel on travaille est un pré-requis. » Les qualités demandées sont nombreuses : autonomie, anticipation, organisation, communication, bienveillance, souplesse, rigueur, adaptabilité constante. « Les IDEC accomplissent une grande partie de travail dans l’ombre, ajoute Sophie Michel, faisant-fonction de cadre de santé en chirurgie cardiaque, à l’AP-HM. Une charge importante de leur travail ne se quantifie pas. Ils sont très sollicités par tout le personnel et doivent savoir gérer, sans stress, des imprévus. » Ils ont également un important travail administratif à accomplir. « Dans un service de médecine, la mission de coordination peut être confiée à des secrétaires, mais dans notre service, nous avons besoin d’une expertise infirmière dès la prise des rendez- vous, soutient Zouba Kebaili. Les IDEC sont notre verrou pour que la prise en charge soit fluide. »
Des diplômes universitaires et des masters sont accessibles afin d’acquérir des compétences en coordination. Certains centres hospitaliers les exigent, d’autres les recommandent uniquement. Mais rares sont ceux à valoriser financièrement cette fonction.
Laure MARTIN
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |


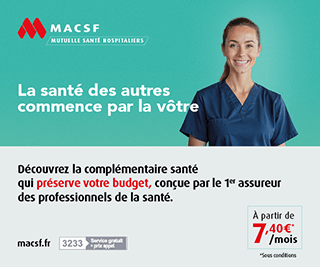
 Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).
Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).

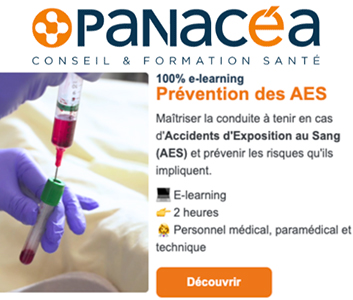




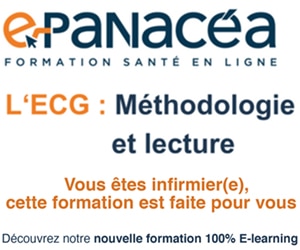
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.