Confrontés aux souffrances et aux parcours éprouvants des patients, les soignants peuvent parfois voir leur empathie s’éroder. La fatigue de compassion, lorsqu’elle s’installe, impacte toutes les dimensions de leur vie. Des moyens existent pour la prévenir ou en atténuer les effets.
La crise sanitaire liée au Covid a eu le mérite de sortir la santé mentale des soignants de la terra incognita où elle était placée depuis longtemps. Elle n’est plus un impensé, ni un tabou, se félicite Magali Briane, psychiatre coordinatrice de l’hôpital de jour dédié aux professionnels de santé de la clinique Mon repos à Écully (Rhône) et vice-présidente de l’association Soins aux professionnels de la santé (SPS). La fatigue compassionnelle fait partie des difficultés de santé mentale qui peuvent affecter les professionnels du soin car la compassion ou l’empathie font partie de l’ADN de leur métier. Mais ce phénomène est difficile à identifier. Contrairement au traumatisme vicariant, avec lequel elle est parfois confondue, la fatigue compassionnelle n’est pas une pathologie à proprement parler, ni un syndrome comme le burn-out, qui relève d’un épuisement général, souligne la psychiatre. Il faut dire que « les frontières entre ces différentes notions ne sont pas franches », remarque Philippe Zawieja, psychosociologue du travail et consultant sur le bien-être et la performance au travail. Elles ont en commun certaines caractéristiques et manifestations, certains facteurs de risque et peuvent même constituer des facteurs de risques les unes pour les autres…

Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Usure lente et insidieuse
Marine Dupont, psychologue clinicienne et chargée de mission au Centre national de ressource et de résilience, définit la fatigue compassionnelle comme « une usure lente et insidieuse de la capacité d’empathie » d’une personne. Les soignants affectés ne parviennent plus à « entrer en empathie avec les patients mais aussi avec leurs proches, ajoute Magali Briane. Ils perdent leur capacité d’écoute et la capacité presque physique d’entrer en contact avec l’autre. Dans les relations d’aide, cela peut être très coûteux, émotionnellement, d’être en empathie et d’écouter ou voir des gens souffrir toute la journée », ajoute la psychiatre. La notion de cumul d’exposition joue beaucoup dans la fatigue compassionnelle. Philippe Svandra, infirmier de formation, docteur en philosophie et coordinateur pour les Ifsi à l’université de Créteil, présente l’exposition à la souffrance des autres comme une sorte de « goutte-à-goutte ». À un certain moment, précise Marine Dupont, « il y a tellement de saturation dans la relation thérapeutique que les personnes se coupent de ce qu’elles ressentent, dans un mécanisme de défense, de protection ». Un mécanisme paradoxal se met en place : à force de ressentir de l’empathie, le soignant souffre de « souffrir avec » et va finir par ne plus compatir et se distancier des patients.
Le terme même de compassion vient du latin patior, qui signifie « souffrir » et cum, qui signifie « avec », rappelle Philippe Svandra. « Les philosophes allemands ajoutent à cette définition de la compassion une dimension de résonance, précise-t-il. Quelque chose résonne en nous. » Magali Briane évoque aussi les neurones miroir : « certaines études montrent que quand un soignant est face à quelqu’un qui souffre, les mêmes zones cérébrales s’activent chez lui. En quelque sorte, il s’harmonise avec lui ». Et parfois c’est trop.
Neurones miroirs
Les soignants concernés ont du mal à identifier la fatigue compassionnelle, d’une part en raison de son apparition progressive et de ses manifestations peu spécifiques (voir encadré) et d’autre part parce qu’elle reste encore largement méconnue. Comme tout ce qui touche à la santé mentale des soignants, « cela devrait être enseigné dans les instituts de formation », estime Magali Briane. Dans les services où la charge émotionnelle est considérée comme plus importante, comme l’oncologie, la pédiatrie ou les soins palliatifs, les soignants sont un peu plus sensibilisés, remarque Dominique Friard, ancien infirmier aujourd’hui superviseur d’équipes. Mais, selon lui, la prise de conscience est insuffisante en psychiatrie, alors que cette charge peut y atteindre des niveaux élevés. « Depuis la suppression des études spécifiques d’infirmier en psychiatrie, poursuit-il, les soignants travaillent beaucoup moins ce que produit en eux la relation avec le patient, la possibilité de prendre du recul, et ils prennent cette relation de plein fouet. Ils ont aussi des représentations erronées de la psychiatrie et des pathologies psychiatriques qui les rendent moins tolérants. » La fatigue compassionnelle percute également les représentations de ce qu’est et comment « doit » être un soignant. « On pourrait toujours donner plus », illustre Philippe Svandra.
Même s’ils ne parviennent pas à en identifier la cause, le changement dans leur manière d’appréhender les patients, causé par la fatigue compassionnelle, s’accompagne chez de nombreux professionnels d’un sentiment d’échec dans leur mission et d’un fort sentiment de culpabilité. Cela peut conduire à l’apparition de stratégies d’adaptation mais aussi à des dépressions, observe Magali Briane. La fatigue de compassion se répercute aussi sur les collectifs de travail avec des soignants qui deviennent plus irritables et se replient sur eux-mêmes par peur de la stigmatisation. Les patients sont aussi impactés, puisque les soignants sont moins disponibles pour eux, moins à leur écoute et moins en capacité de comprendre leurs besoins. Le système de santé dans son ensemble en pâtit, ajoute la psychiatre, car certains vont quitter leur profession. « Le système de santé a besoin que les soignants aillent bien pour qu’ils puissent bien faire leur métier », insiste-t-elle.
Aller bien pour soigner
Une meilleure information sur ce qu’est la fatigue compassionnelle pourrait aider les soignants à la reconnaître pour eux-mêmes mais aussi pour les autres : « ce qu’on ne voit pas pour soi on peut parfois le voir pour ses collègues », souligne la psychiatre. L’information doit aussi évoquer les facteurs qui favorisent son apparition. Peut-être survient-elle plus facilement dans certains services de par la nature des besoins des patients – quoique cela ne soit pas prouvé – ou chez certains soignants qui ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs (schéma d’abnégation), à être particulièrement exigeants envers eux-mêmes ou à poser des limites ? « Il ne faut pas stigmatiser ces personnes car tout le monde apprécie des soignants dévoués, et surtout, il ne faut pas dédouaner les organisations de leur responsabilité », insiste Magali Briane.
Les experts s’accordent à considérer les facteurs organisationnels comme déterminants : ils peuvent soit favoriser l’émergence de la fatigue compassionnelle, soit contribuer à sa prévention, notamment en fonction de l’importance accordée aux temps d’échanges au sein des équipes. Dominique Friard, qui encadre ces temps sous forme d’analyses de pratique ou de supervision, les juge indispensables, tout comme les « espaces de parole intersticiels » et informels durant lesquels les soignants partagent librement leurs ressentis entre collègues. Les moments et les espaces d’échanges institutionnalisés et soutenus par la hiérarchie, poursuit-il, permettent de déposer ce qui est difficile, d’exprimer les émotions, d’analyser ce qui affecte, de réaliser qu’on n’est pas seul à être affecté et « de recharger les batteries ». Selon lui, « cela peut permettre à un soignant de comprendre, par exemple, que ce qu’il ressent ne vient pas de lui mais du patient ou de sa famille ». En plus de ce type de mesure (et de toutes celles qui préviennent le burn-out), Philippe Zawieja, préconise aussi dans les échanges informels sur les patients ou en réunion de staff, d’employer un langage « qui ne génère pas trop d’images mentales » et de prévenir ses interlocuteurs en amont d’un échange sur un patient durant lequel des choses difficiles doivent être dites afin d’éviter l’effet de surprise. Pour réduire le risque psychosocial que constitue la fatigue compassionnelle, il estime qu’il serait pertinent de concevoir des parcours professionnels offrant aux soignants la possibilité de changer de services à plusieurs reprises, lorsqu’ils ne le font pas eux-mêmes spontanément.
« Suffisamment juste »
Quels que soient les moyens de prévention mis en place dans les services, les soignants peuvent déployer des stratégies, avec le soutien des psychiatres et psychologues pour les accompagner. Dans l’idéal, « il faut que les soignants aient le temps et l’énergie de s’ouvrir à des choses qui vont les ressourcer, mais, avec l’intensification du travail, cela devient de plus en plus difficile », souligne Magali Briane.
En prévention, Marine Dupont insiste sur la nécessité pour les soignants « d’apprendre à prendre soin d’eux, ce dont ils n’ont, souvent, pas l’habitude ». Il peut s’agit de pratiquer des activités qui les ressourcent en dehors du travail mais pas seulement. Au travail, « pour s’apaiser après un moment éprouvant ou avant d’enchaîner avec la vie de famille, remarque-t-elle, on peut regarder une vidéo rigolote quelques minutes, se passer de l’eau froide sur les mains, toucher un petit objet qui a du sens pour soi », ou bien sûr parler avec un ou une collègue. Magali Briane évoque aussi les autosoins basés sur l’apaisement émotionnel qui permettent de mettre à distance des émotions. Réorganiser son travail pour éviter les tâches répétitives, si c’est possible, peut être bénéfique également. « Il ne s’agit pas de lâcher le travail mais de se prioriser », résume Célia Belrose, psychologue clinicienne qui travaille notamment à la Maison des soignants, à Paris. Quand la fatigue de compassion se fait trop lourde, il peut cependant être nécessaire que la personne soit extraite de son environnement de travail, ajoute-t-elle, pour faire cesser les automatismes.
La reconnaissance, par des professionnels de santé, de leur propre fatigue et de ses causes externes est un premier pas important. Une psychothérapie s’avère souvent indispensable, en complément du traitement des symptômes les plus gênants (insomnie, agitation, etc.). La première étape, souligne Magali Briane, vise la régulation émotionnelle. Ensuite, une démarche psychoéducative, qui devrait être utilisée en prévention, consiste à donner des informations au soignant pour qu’il comprenne ce qu’il traverse, les raisons de cette situation, et les leviers qu’il peut mobiliser. Puis le travail se poursuit sur la flexibilité psychologique, l’évitement émotionnel et la restauration de l’estime de soi. En somme, ajoute Philippe Svandra en reprenant les mots du psychanalyse Winnicott, « il s’agit de lui montrer que l’objectif est d’être un soignant ‘‘suffisamment juste’’, et lui dire que c’est déjà beaucoup ».
Les signes de la « surcharge de l’humain »
La diversité, voire l’apparente banalité, des manifestations de la fatigue compassionnelle rend cette dernière difficile à identifier : troubles du sommeil, de l’alimentation, difficultés relationnelles… L’apparition de « pensées opératoires » fait partie de ces manifestations, souligne Célia Belrose, psychologue clinicienne à la Maison des soignants de Paris. « Au lieu de nommer le patient, on utilise le nom de sa pathologie ou son numéro de chambre, par exemple. On ne l’investit plus, on se distancie, on automatise les rapports humains avec lui et cela peut cristalliser des situations conflictuelles avec les autres personnes autour de lui ».
Le sentiment de « surcharge de l’humain » provoque chez les soignants une incapacité croissante à s’impliquer auprès des patients comme ils le souhaiteraient, ce qui engendre chez eux une véritable souffrance, ajoute Magali Briane, psychiatre et vice-présidente de l’association Soins aux professionnels de la santé (SPS). Cette situation peut conduire à un sentiment de dévalorisation, à une auto-stigmatisation, et même à une remise en question de soi, non seulement dans la relation aux patients, mais également vis-à-vis de ses proches, de ses enfants ou de ses collègues. Elle peut aussi mener à une remise en question de l’exercice de son métier…
La fatigue compassionnelle percute en effet la capacité des soignants à « encaisser » les émotions qu’ils peuvent ressentir face aux récits, situations ou blessures des patients, considérée comme une compétence professionnelle. « Les soignants ont à cœur de bien faire leur métier, de réaliser leur mission de soin, souligne Célia Belrose, et certains, peut-être à cause de leur histoire personnelle, ne vont pas lâcher cette mission, quitte à s’oublier eux-mêmes. » Une difficulté réside aussi dans l’évolution de ce qui est généralement attendu des soignants. « Quand j’étais en formation, il y a de nombreuses années, on nous disait qu’un bon professionnel n’a pas d’émotions, se rappelle Philippe Svandra, infirmier de formation, docteur en philosophie et coordinateur pour les Ifsi à l’université de Créteil. C’était illusoire mais quand on ressentait des émotions, on pensait qu’on n’était pas de bons soignants. » Aujourd’hui, ce n’est plus le cas mais l’empathie peut devenir trop lourde.
Géraldine Langlois
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus |
|
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus |
|






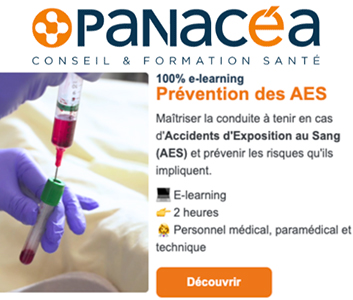





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.