Se former tout au long de sa carrière fait partie des obligations déontologiques des infirmiers. Un devoir pas toujours facile à remplir, malgré la diversité des formations envisageables. Parmi celles-ci : les Diplômes universitaires (DU) et inter-universitaires (DIU). Mode d’emploi de ces formations très particulières.

« C’est un engagement. » Voilà le mot qui, selon le Pr Florian Ferreri, psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine de Paris (AP-HP) et vice-doyen de la faculté de santé de Sorbonne-Université en charge des professions paramédicales, résume l’inscription à l’un des 250 DU ou DIU que propose son institution.
Un terme qui peut s’entendre de plusieurs façons : un engagement personnel, car la charge de travail que représentent ces formations est souvent loin d’être négligeable ; un engagement financier, car les droits d’inscriptions dépassent souvent le millier d’euros ; et un engagement professionnel enfin, car l’amélioration continue des connaissances fait partie du mouvement général de montée en compétences des infirmiers. Reste à savoir comment, concrètement, cet engagement peut prendre forme.
Mais d’abord, qu’est-ce au juste qu’un DU ? C’est un diplôme qui relève de la formation professionnelle continue, délivré par une université (ou plusieurs universités mutualisant leurs moyens dans le cas des DIU). Contrairement à beaucoup de formations proposées, les DU reposent sur des standards académiques universitaires, et supposent un investissement conséquent : le volume horaire concerné se compte en dizaines voire en centaines d’heures, et le travail théorique s’accompagne souvent d’un stage pratique et de la rédaction d’un mémoire. La durée d’enseignement peut s’étaler sur une, voire deux années. Enfin, comme leur nom l’indique, les DU donnent lieu à la délivrance d’un diplôme officiel reconnu par l’université. Quant aux contenus, ils peuvent être très divers. Certaines de ces formations attirent d’importants contingents infirmiers (formation plaies et cicatrisation, formation prise en charge de la douleur, santé au travail, formation soins palliatifs…) et sont délivrées par de nombreuses universités, alors que d’autres sont davantage liées à des thématiques « de niche » (« santé publique en milieu pénitentiaire, par exemple, seulement proposée par l’Université Paris-Cité), et les infirmiers peuvent y être largement minoritaires. Car c’est l’une des spécificités des DU : nombreux sont ceux qui sont ouverts à divers professionnels de santé, et qui permettent aux infirmiers de rencontrer d’autres soignants;
Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Une démarche qui en vaut la peine
Si se lancer dans un DU n’est pas une démarche anodine, cela semble être une démarche qui en vaut la peine. C’est du moins le sentiment qui prévaut quand on demande aux infirmiers qui ont validé un DU le bilan qu’ils retirent de cette expérience. « Après avoir passé trois DU et un DIU, je peux témoigner que cela m’a permis d’être beaucoup plus sereine avec mes patients, d’avoir des éléments concrets et validés pour effectuer des prises en charge plus sécures et plus pertinentes, de mieux comprendre le parcours du patient, de lui apporter une aide psychologique et physique plus qualifiée, et quelques fois d’éviter de faire des bêtises ! », témoigne par exemple Lucienne Claustres-Bonnet, présidente du Dispositif d’aide à la coordination (DAC) « Ressources Santé » et vice-présidente de l’Association nationale françaises des IDE et étudiants (Anfiide). Une position à laquelle adhère sa consoeur Brigitte Hérisson, secrétaire générale de l’Anfiide qui a longtemps travaillé dans le domaine des soins palliatifs et de la douleur : celle-ci estime que les trois DU qu’elle a passés lui ont permis « de postuler et de répondre aux besoins de l’établissement pour une amélioration de la qualité des soins », mais aussi d’assurer une forme de « transfert de connaissances auprès de ses pairs ».
Autre aspect fréquemment mis en avant par les infirmiers qui ont fait cette expérience : suivre un DU, c’est souvent s’ouvrir de nouveaux horizons. C’est ainsi que Maxence Gal, infirmier libéral et lui aussi membre du bureau de l’Anfiide, estime que son DU « virage ambulatoire » lui a permis d’acquérir des « connaissances systémiques liées à notre système de santé » qui l’ont « incité et motivé à être un des co-fondateurs de la CPTS Var Ouest », tandis que son DU « télémédecine » lui a permis d’initier un projet de télémédecine au sein de cette même CPTS, projet dont il est aujourd’hui l’administrateur. Faire un DU, c’est également approfondir un thème pour lequel on a un intérêt personnel. « Je me suis inscrite au DU “douleur” quand j’étais encore aide soignante en réanimation, témoigne Marlène Carreras, infirmière et référente “douleur” aux urgences-Smur du CH de Montauban (Tarn-et-Garonne), qui a suivi ce DU en même temps que la deuxième année de son cursus en Ifsi. J’avais compris que face à des situations compliquées, on ne pouvait pas sauver tout le monde, mais que pour la douleur il était évident qu’on pouvait faire des choses pour chacun. »
De la difficulté de démarrer

Reste que si les DU représentent pour les infirmiers qui se lancent dans l’aventure une source de satisfaction et d’épanouissement certaine, ils sont également dans une large mesure l’aboutissement d’une course où les obstacles se présentent aussi bien avant, pendant, qu’après le cursus. Les difficultés démarrent en effet dès le moment où, la décision d’approfondir ses connaissances dans tel ou tel domaine étant prise, l’infirmier se met en quête de la formation qui répond le mieux à ses attentes. Car c’est bien simple : il n’existe aucune liste centralisée des DU et DIU ouverts aux infirmiers. « Pour trouver un DU qui nous correspond, la plupart du temps, nous devons passer du temps à chercher car le titre est souvent vague, déplore Lucienne Claustres-Bonnet. Un DU plaies et cicatrisation a-t-il la même valeur s’il est à Toulouse, Nancy, Paris ou Marseille ? Le contenu est-il le même ? Répondre à ces questions est quasiment impossible, le choix se fait le plus souvent à la lecture du programme proposé. » C’est pourquoi la plupart du temps, les infirmiers se décident sur des critères avant tout géographiques : bien que les enseignements en distanciel se développent, les participants ont à cœur de minimiser le nombre de kilomètres parcourus pour se former.
Mais l’identification du lieu de formation adéquat n’est que le point de départ des difficultés pour l’infirmier identifié, il faut en effet s’y inscrire, ce qui implique… d’être sélectionné. « À Sorbonne-université, la plupart de nos DU reçoivent plus de candidatures qu’il n’y a de places, avertit Florian Ferreri. La sélection se fait donc sur la motivation, sur la cohérence de la demande par rapport au parcours, mais aussi sur la date d’inscription : ce n’est pas “premier arrivé, premier servi”, mais un dossier arrivé tôt aura plus de chances qu’un autre d’être accepté. » Tout infirmier souhaitant s’inscrire à un DU aura donc intérêt à soigner son dossier de candidature, car dans certains cas, les places peuvent être chères. Et « cher » est sans doute le mot approprié, car Florian Ferreri mentionne un autre critère de sélection : la solidité du mode de financement prévu pour régler les frais d’inscription.
Le coût… et le temps

Car c’est là l’un des grands sujets de préoccupation pour les infirmiers s’inscrivant à un DU : ces formations de qualité sont longues et ont un coût important, que les universités doivent répercuter sur les participants. Or les modalités de prise en charge par l’employeur ou par des mécanismes de financement de la formation professionnelle sont complexes et généralement peu adaptés aux spécificités des DU. Pour ce qui est des infirmiers salariés, par exemple, on constate que les budgets de formation sont souvent alloués à d’autres types de formation.
« L’enveloppe globale des hôpitaux pour la formation est souvent conséquente, mais les établissements ont tendance à favoriser celles qui leur apportent une plus-value directe », constate Christophe Mesnier, président de la Coordination nationale infirmière. Or le bénéfice apporté par un DU est souvent à moyen terme, et indirect. « Les demandes des agents sont d’abord réparties entre celles qui sont dans le catalogue de formation de l’établissement, et les DU, qui sont des demandes individuelles et qui ne figurent pas dans le catalogue, passent après », regrette le responsable syndical.
Autre obstacle, et pas des moindres : en période de forte tension sur les ressources humaines, les services rechignent souvent à laisser leurs infirmiers s’absenter une, voire plusieurs journées par mois. Reste qu’il faut reconnaître qu’à force de persévérance (« Si une demande n’est pas acceptée une année, elle peut l’être l’année suivante », encourage Christophe Mesnier), de nombreux infirmiers salariés parviennent à faire prendre en charge leur DU par leur employeur, et que dans ce cas, cette prise en charge comprend non seulement les frais d’inscription, mais aussi bien souvent les frais de transport. Le temps de formation, bien sûr, est dans ce cas considéré comme du temps de travail, ce qui n’est pas toujours le cas du temps de transport. Les libéraux doivent quant à eux soit fermer leur cabinet pendant qu’ils sont en formation, soit trouver une solution pour que leur cabinet continue à tourner sans eux. « On doit prendre sur le temps personnel, et trouver des remplaçants », témoigne John Pinte, président du Syndicat des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil).
Financement partiel… ou nul
Résultat de toutes ces difficultés accumulées : dans de nombreux cas, les infirmiers finissent par se former sur leur temps et sur leurs deniers personnels. « Je me suis auto-financée, c’était un projet personnel, pour améliorer mes prises en soin », explique par exemple Marlène Carreras. « C’est une situation bien plus fréquente que cela devrait être, commente Christophe Mesnier. Ce sont des soignants qui décident de se mettre en mouvement : souvent, ils n’attendent pas les délais incompressibles dont l’institution a besoin pour les soutenir. Ils finissent par faire cela seuls, et on les comprend ! » Le président de la CNI ajoute qu’en plus d’être dommageable aux finances des intéressés, cette situation l’est pour l’attractivité des établissements, car les personnes qui se sont formées par elles-mêmes, qui sont des soignants qui souvent font preuve de dynamisme et de ténacité, auront par la suite souvent tendance à saisir des opportunités et à s’envoler vers d’autres horizons.
Il ne faut cependant pas désespérer. Il existe, que l’on soit en libéral ou salarié, des possibilités de financement au moins partiel, par exemple via le Compte personnel de formation (CPF), et pour les libéraux via le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL). Le Développement professionnel continu (DPC), en revanche, n’est pas adapté dans sa forme actuelle à la prise en charge des DU. « Il faut que le DU corresponde à nos orientations nationales prioritaires définies par arrêté, et si c’est le cas il faut que les organismes décident d’inscrire leur formation au DPC, et de toute façon le coût d’un DU excède largement nos plafonds de financement », énumère Michèle Lenoir-Salfati, directrice générale de l’Agence nationale du DPC (ANDPC). Résultat : pour le programme 2023-2025, pour l’instant, un seul infirmier a fait prendre en charge une partie du coût de son DU via le DPC, révèle-t-elle.
Des formations intensives
Une fois les difficultés liées à l’inscription et au financement résolues, l’infirmier qui souhaite suivre un DU n’en est pas au bout de ses peines. Car le cursus en lui-même est souvent très intense : entre les journées d’enseignement en présentiel, les visio, le stage le cas échéant, la préparation des évaluations et bien sûr le mémoire et sa soutenance qui viennent très souvent sanctionner le parcours de formation, les efforts à fournir sont loin d’être négligeables.
« C’est une décision qui doit être mûrement réfléchie, ce sont des formations intensives et il faut pouvoir y consacrer le temps nécessaire », avertit Florian Ferreri. Le vice doyen de Sorbonne-Université pointe notamment, « en plus de l’écoute aux cours », l’importance du « travail personnel à fournir ». « Ce ne sont pas des formations passives, il y a un moment d’écoute, mais il y a aussi des périodes proactives », souligne-t-il. Un point de vigilance que confirme par exemple Marlène Carreras à l’aune de son expérience du DU « douleur ». « En termes d’effort personnel, j’ai trouvé qu’il y avait pas mal de travail, même si la validation finale, si on avait bien suivi, n’était pas si dure que cela », témoigne l’infirmière occitane.
Reste une question. Une fois son DU en poche, comment l’infirmier peut-il valoriser les connaissances acquises ? Car au-delà d’une plus grande confiance dans ses savoirs professionnels, tout travailleur qui acquiert de nouvelles compétences peut espérer une reconnaissance de celles-ci, qu’il s’agisse de reconnaissance financière ou symbolique. Or, de l’avis général, c’est très rarement le cas. « Avoir un DU n’augmente pas notre rémunération », avertit Lucienne Claustres-Bonnet, qui remarque que « ces compétences ne sont reconnues que par nous », même si, et ce n’est pas négligeable, « elles nous apportent de la sérénité dans notre exercice ». « Il n’y a aucune compensation monétaire, confirme sa consoeur et collègue de l’Anfiide Brigitte Hérisson, mais l’immense satisfaction de participer en équipe à la prise en soin du patient. »
Perspectives de valorisation
Le manque de reconnaissance financière est d’ailleurs l’un des principaux axes d’amélioration sur la question pointée par les représentants de la profession. Car selon eux, puisque tout le monde a intérêt à ce que les infirmiers continuent à se former tout au long de leur carrière avec des cursus ambitieux et de qualité, il serait judicieux d’allouer des moyens financiers qui inciteraient davantage les professionnels à se lancer dans une telle aventure.
« Il est dommage de ne pas valoriser davantage ces formations, car c’est un outil extrêmement intéressant pour augmenter les compétences, pour faire en sorte que les connaissances acquises par un agent puissent infuser au sein de son équipe, regrette Christophe Mesnier. Imaginez qu’une infirmière formée en plaies et cicatrisation, par exemple, puisse obtenir une reconnaissance pour l’accompagnement de ses collègues sur les cas complexes… Cela permettrait d’augmenter les connaissances de l’équipe, de fidéliser la soignante, etc. »
Même constat dans le monde libéral. « On a intérêt à ce que les infirmiers soient mieux formés, tout le monde y gagnerait, estime John Pinte, du Sniil. Et bien qu’on ne puisse pas faire une nomenclature pour ceux qui ont suivi un DU, on pourrait par exemple faire de la téléexpertise entre confrères. Actuellement, je peux solliciter en téléexpertise un médecin, mais on pourrait imaginer que je puisse aussi solliciter un infirmier qui a fait un DU « plaies » ou « douleur ». » Un mécanisme qui, selon le président du Sniil, permettrait de mettre en avant et de donner un petit écho pécuniaire aux compétences acquises lors d’un DU.
Le réalisme commande cependant d’ajouter un bémol à ces propositions ambitieuses : étant données les discussions budgétaires en cours et l’éternelle recherche d’économies du côté de l’Assurance maladie, on peut douter que l’augmentation des ressources allouées à la formation longue des infirmiers devienne dans un avenir proche la priorité des pouvoirs publics. Faut-il désespérer pour autant ? Certainement pas, car les DU et DIU restent attractifs en eux-mêmes, et continuent à attirer des professionnels. La meilleure preuve en est que ceux qui ont goûté à ces formations ont tendance à renouveler l’expérience : il n’est pas rare de croiser des professionnels chevronnés qui ont non pas un, mais deux, voire trois DU et même davantage. « Si c’était possible, je ferais un DU chaque année », sourit Marlène Carreras. C’est le propre du savoir : celui qu’on acquiert nous sert avant tout à mesurer l’étendue de celui qu’il nous reste à acquérir !
Le DU « Infirmier Santé au Travail » : un véritable projet professionnel
 Les infirmiers en santé au travail doivent être formés par leur employeur, ce qui donne aux DU consacrés à cette thématique un caractère particulier. Exemple avec le Pr Vincent Bonneterre, responsable du DIU « Infirmier en santé au travail » à la faculté de Grenoble.
Les infirmiers en santé au travail doivent être formés par leur employeur, ce qui donne aux DU consacrés à cette thématique un caractère particulier. Exemple avec le Pr Vincent Bonneterre, responsable du DIU « Infirmier en santé au travail » à la faculté de Grenoble.
Pouvez-vous commencer par nous présenter votre DIU « Infirmier en santé au travail » ?
Il faut d’abord savoir que c’est un DIU qui s’adresse aux infirmiers qui ont choisi un exercice spécifique, qui exige des qualifications différentes. Nous prenons dans notre DU des infirmiers qui sont déjà embauchés : la réglementation prévoit que leurs employeurs ont douze mois pour les former. C’est une formation qui se fait en lien avec la pratique, avec un tuteur dans le lieu de travail qui nous permet de confirmer que les choses se sont bien passées. C’est une formation de 240 heures, dont 105 heures de stage, avec la rédaction d’un mémoire. Comme il s’agit d’un DIU, nous avons plusieurs lieux de formation.
Justement, comment se passe la formation sur les différentes facultés ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons quatre CHU, et certains cours sont faits à Clermont-Ferrand, d’autres à Grenoble, d’autres à Lyon et d’autres encore à Saint-Étienne. Cela permet de répartir la charge entre les universités. Traditionnellement, nous faisions l’ensemble des enseignements en présentiel, puis au moment du covid nous faisions tout en visio… Nous avons repris le présentiel sauf exception, et il n’est pas exclu qu’à l’avenir, nous donnions davantage de souplesse, pour que ceux qui veulent venir assister aux cours puissent venir, et que les autres fassent du distanciel.
Comment s’opère la sélection des étudiants ?
Il faut d’abord savoir qu’on a de plus en plus de besoins : les médecins du travail sont toujours moins nombreux, on délègue toujours plus de missions aux infirmiers en santé au travail… Nous formions dix personnes par faculté et par an, et là nous avons doublé les effectifs, ce qui avec quatre universités fait 80 personnes par an. Les candidatures se font en ligne sur les sites des universités entre avril et juin, et nous avons un jury qui se réunit début juillet. Nous avons des critères d’inclusion : le fait d’être en poste ou avoir une promesse d’embauche, avoir un médecin tuteur… Et nous formons en priorité les gens de notre région.
Comment conseillez-vous aux infirmiers de se préparer à un tel DU ?
C’est un projet professionnel qui s’adresse en général à des personnes qui ont fait d’autres choses avant, qui sont passées par différents services hospitaliers, par le libéral, qui ont agi sur prescription médicale pendant longtemps et qui souhaitent prendre un peu de hauteur, participer à des actions de promotion de la santé. Il faut avoir cette envie en soi, car l’infirmier en santé au travail est parfois seul au sein des entreprises, il est le contact des ressources humaines pour des questions importantes… Je conseille d’échanger avec des infirmières qui exercent, de s’arranger pour faire des stages d’observation, de se donner une chance de voir ce que cet exercice représente avant de se lancer dans une formation longue.
Quelle charge de travail représente ce DU ?
Nous avons une population qui est très consciencieuse, et qui fournit les efforts nécessaires. Je suis responsable pédagogique depuis 2015, et une seule personne n’a pas validé. Nous avons peut-être eu deux ou trois abandons, souvent du fait de problématiques personnelles. Mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une quantité de travail importante : pour les étudiants, tout est nouveau, il y a une partie réglementaire qui est souvent difficile, il faut assimiler les différents types de risques… On a souvent l’impression qu’il y a beaucoup d’information. Par ailleurs, il ne faut pas cacher que le travail de mémoire, le fait d’identifier une problématique, de poser une méthode pour y répondre, c’est un investissement important.
Adrien RENAUD
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins


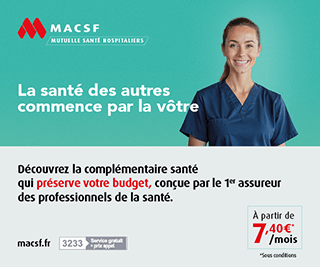
 Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).
Cet article a été publié dans le n°54 d’ActuSoins magazine (septembre 2024).


 Les infirmiers en santé au travail doivent être formés par leur employeur, ce qui donne aux DU consacrés à cette thématique un caractère particulier. Exemple avec le Pr Vincent Bonneterre, responsable du DIU « Infirmier en santé au travail » à la faculté de Grenoble.
Les infirmiers en santé au travail doivent être formés par leur employeur, ce qui donne aux DU consacrés à cette thématique un caractère particulier. Exemple avec le Pr Vincent Bonneterre, responsable du DIU « Infirmier en santé au travail » à la faculté de Grenoble.



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.