Depuis une quinzaine d’années, des protocoles de coopération formalisent des délégations d’activités ou d’actes entre professionnels paramédicaux et médicaux. Ces dispositifs, qui encouragent le développement de nouvelles compétences infirmières, se déploient à l’échelle locale et nationale.
Fin 2023, 106 protocoles locaux et 57 protocoles nationaux, dont 44 concernant les infirmiers, étaient déployés sur le territoire, d’après les données de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Initié par l’article 51 de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) de 2009, le dispositif des protocoles de coopération a été rénové par l’article 66 de la Loi Organisation et transformation du système de santé (OTSS) du 24 juillet 2019. Cette coopération entre professionnels de santé, qui se traduit sur le terrain par des délégations de tâches, vise à élargir l’offre de soins et à réduire les délais d’accès à une prise en charge, afin d’améliorer les parcours de santé des patients. Le protocole concrétise la démarche de coopération entre professions de santé en décrivant les activités ou les actes de soins transférés, et la façon dont les professionnels de santé vont réorganiser leur mode d’intervention auprès du patient. Les délégations peuvent être de plusieurs natures : réalisation d’actes ou d’activités à visée préventive, à visée diagnostique ou à visée thérapeutique. La coopération entre professionnels de santé est possible quels que soient les modes d’exercice (libéral, salarié, mixte) et les cadres d’exercice (établissements de santé, maisons de santé, pôles de santé, réseaux de santé, centres de santé, cabinets médicaux, Ehpad, HAD, SSIAD, etc.). Chaque professionnel de santé est responsable de ses actes mais la supervision du protocole relève de la responsabilité du délégant.
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Deux types de protocoles de coopération
En 2009, le pilotage des projets de protocoles reposait sur les Agences régionales de santé (ARS) qui les régulaient pour une application régionale à la suite d’un avis conforme de la Haute Autorité de santé (HAS). Depuis la loi de 2019, le pilotage est national. Des appels à manifestation d’intérêt (AMI) sont lancés par le Comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI), afin de répondre à une problématique de santé nationale. Les protocoles de coopération nationaux sont encadrés par arrêtés, qui définissent de manière stricte la profession du délégant et du délégué, l’acquisition des compétences exigées pour la mise en oeuvre du protocole, les actes ou activités dérogatoires aux conditions légales d’exercice, les critères d’inéligibilité pour les patients ne pouvant être pris en charge dans le protocole et les lieux possibles de mise en oeuvre. Les équipes terrain peuvent se rattacher à un protocole national, en se déclarant auprès des tutelles sur le portail dédié « démarches simplifiées ». Pour rendre effectives des pratiques innovantes, le ministère publie également régulièrement de nouveaux AMI afin d’ouvrir la création et la rédaction des protocoles de coopération aux équipes de professionnels volontaires. Ces dernières s’engagent à rédiger un projet de protocole et son modèle économique, avec le soutien continu du secrétariat du CNCI.
En parallèle, les équipes peuvent aussi créer leur propre protocole à l’échelle locale, qui ne sera applicable, dans un premier temps, qu’à l’équipe l’ayant élaboré. Il n’a pas vocation à obtenir l’avis de la HAS mais doit toutefois être déclaré à l’ARS via la plateforme dédiée. Son extension est possible à d’autres équipes du territoire voire au niveau national, sous réserve d’une évaluation de pertinence par le CNCI et l’avis de la HAS.
Dans les deux cas, ces protocoles sont nominatifs. Ce fonctionnement implique donc un engagement de plusieurs médecins et infirmiers afin de garantir la continuité du protocole en cas de départ d’un membre de l’équipe.
Les équipes hospitalières
Du côté de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), le coordonnateur général des soins, Marc Catanas, a l’intention, dans le cadre de l’élaboration du projet de soins 2024-2030, de mettre l’accent sur le développement des protocoles de coopération. Actuellement, une dizaine sont déployés au sein de l’institution. « Il m’est important de promouvoir la pratique infirmière car cela valorise également l’expertise, et permet d’apporter une approche et une vision infirmière à une prise en charge médicale », soutient-il. Le dispositif va prendre la forme d’une structure de suivi avec un groupe de travail et un porteur de projet. Cet observatoire des protocoles de coopération affichera une double mission : d’un côté, recenser et suivre les protocoles existants en accompagnant les équipes si besoin, et de l’autre apporter un soutien méthodologique à celles souhaitant déployer des protocoles.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) propose déjà un accompagnement de ce type. L’établissement s’est rapidement saisi de l’opportunité offerte par les protocoles, considérés comme « une perspective d’innovation donnant la possibilité de formaliser l’expertise infirmière », souligne Nsuni Met, cheffe de projets protocoles de coopération/pratique avancée à la Direction de la stratégie et de la transformation au sein de l’AP-HP. Dès 2010-2011, les équipes ont proposé des protocoles « consultation du voyage » et « prescription d’une radiologie par un infirmier d’accueil et d’orientation ». Aujourd’hui 80 protocoles locaux et nationaux sont mis en place dans les 38 établissements de l’AP-HP, rassemblant plus de 400 délégants et 500 délégués. Si à l’origine, les temps d’instruction par les tutelles étaient relativement longs, l’AP-HP constate un effort de simplification des démarches. Dans cette dynamique, l’institution s’est saisie de l’opportunité d’élaborer des protocoles locaux. « Depuis 2019, quinze ont été autorisés et une vingtaine sont en cours d’instruction », indique-t-elle. Dans ce contexte, les équipes désirant présenter un protocole doivent rédiger une lettre de cadrage. L’objectif est de démontrer que le projet répond à un besoin de santé, que l’acte est dérogatoire, tout en mettant en évidence l’impact sur le parcours de soins des patients. Elles doivent également fournir des informations détaillées sur les formations et les prérequis nécessaires pour les délégués et délégants. À l’AP-HP, des référents « protocoles de coopération » sont présents au sein de chaque groupe hospitalier pour accompagner les équipes à la rédaction des fiches projets. Dès lors que la lettre de cadrage est rédigée, son instruction débute au sein d’une task force au niveau central, constituée de plusieurs directions (juridique, ressources humaines, qualité et gestion des risques), suivie d’un examen devant un comité de pilotage. Ce dernier statue sur la possibilité pour l’équipe d’écrire le protocole, qui sera de nouveau validé par la task force. Le Copil décide ensuite de la possibilité de présenter le projet au vote des commissions médicales et des soins. Si le vote est favorable, le directeur général de l’AP-HP autorise le protocole. La HAS, la DGOS et l’ARS sont alors informées du protocole autorisé. « Ce processus prend huit à neuf mois de temps d’instruction », précise Nsuni Met. « Nous utilisons les protocoles nationaux et locaux pour fidéliser et attirer les soignants en accordant un spectre plus large de missions et compétences aux infirmiers dans le cadre de leur pratique professionnelle. »
Pour une intégration dans le décret d’actes
« J’espère qu’une réflexion va être menée sur l’intégration des actes dérogatoires dans le décret de compétences notamment pour les protocoles ayant désormais une dizaine d’années d’existence », poursuit la cheffe de projet. Un point de vue partagé par le Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) mais uniquement pour les compétences déployées dans le cadre des protocoles nationaux, le syndicat étant hostile aux protocoles locaux, qu’il considère comme « de petits arrangements entre professionnels amis », souligne Thierry Amouroux, son porte-parole. Et d’ajouter : « Dès l’origine, nous avons accepté les protocoles nationaux comme des expérimentations utiles pour savoir si la délégation était bénéfique pour la population et les soignants. » Pour autant, le SNPI estime que la durée de l’expérimentation devrait être limitée dans le temps. « Ce qui est mené à titre expérimental doit être généralisé à l’ensemble des infirmiers dans une logique d’évolution des compétences », estime-t-il, précisant que l’enjeu concerne aussi la prise en charge des pathologies chroniques face à la désertification médicale. La Coordination nationale infirmière (CNI), de son côté, a toujours été opposée aux protocoles de coopération. « Nous estimons que si une infirmière peut intégrer un protocole, elle est alors capable d’acquérir les compétences pour effectuer l’acte de manière générale, soutient sa présidente, Céline Laville. Dès l’origine, nous aurions dû revoir les compétences infirmières en révisant le décret d’actes et non multiplier les protocoles, du moins pour tout ce qui n’est ni local ni hyperspécifique. Le ministère et le lobbying médical doivent accepter que les compétences infirmières aillent plus loin que l’existant. »
Le décret concernant les protocoles prévoit une prime de 100 euros brut pour les infirmiers engagés, à la charge des établissements, et non cumulable. Pour le SNPI, ce montant témoigne d’un certain « mépris » à l’égard de la profession. « 100 euros, c’est largement insuffisant, et surtout, il faudrait que le montant soit versé en salaire et non en prime, estime Thierry Amouroux. Cette somme ne permet pas de reconnaître la hausse de la responsabilité des infirmiers. » Le travail de refonte sur le métier d’infirmier mené actuellement permet d’envisager une réflexion sur le sujet. « Si tel est le cas, la rémunération par prime n’aura plus lieu d’être et nous pourrons espérer une hausse du salaire des infirmiers », conclut Céline Laville.
Protocoles de coopération en libéral
Les protocoles de coopération peuvent se déployer dans un contexte libéral. « C’est essentiel pour l’accès aux soins des patients de manière rapide et coordonnée », souligne Emmanuelle Barlerin, infirmière libérale et co-présidente d’AVECsanté*. « Pour mettre en place ces protocoles en ville, il faut fonctionner en équipe, avec des projets communs et une volonté d’avancer ensemble », ajoute le Dr Pascal Gendry, également co-président d’AVECsanté. Même si les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) semblent offrir un environnement propice, elles ne disposent pas pour autant de tous les outils. « En raison de la rémunération à l’acte et de nos compétences respectives, nous restons cloisonnés dans nos fonctions de professionnels de santé, estime le médecin. Contrairement à l’hôpital, la prise en charge de la pathologie est confiée aux professionnels de santé individuellement. Il faut parvenir à faire bouger les lignes. »
Certains protocoles nationaux se mettent toutefois en place, notamment pour le repérage des fragilités par des infirmiers libéraux ou encore pour la prise en charge des cystites. Lorsque des professionnels libéraux souhaitent adhérer à un protocole, ils doivent se déclarer sur le portail gouvernemental « démarches simplifiées ».
Cette démarche nécessite une coordination minutieuse, car chaque convention entre professionnels ainsi que les certifications attestant de la formation des délégués doivent être déclarées. Au sein du Pôle de santé Haute Combraille (PSHC) à Pontaumur (Puy-de-Dôme), les professionnels appliquent le protocole de coopération national sur la prise en charge des cystites impliquant les infirmiers libéraux et les pharmaciens, en remplacement des médecins.
Pour ce protocole national, à chaque prise en charge, une rémunération de 25 euros est versée par la Cpam à la SISA, les professionnels décidant ensuite de la répartition entre ceux impliqués. Dans le cadre d’un protocole local, ce sont les ARS qui rémunèrent les équipes, à leur appréciation, selon leurs schémas territoriaux de santé. « Nous avons souhaité adhérer à ce protocole car il participe à l’amélioration des pratiques et permet d’accroître la collaboration entre les professionnels », explique Sonia Rivalier, infirmière libérale au PSHC. Bien que le protocole comporte de nombreux critères d’exclusion limitant la prise en charge d’une large part de la patientèle du territoire, il permet néanmoins de répondre à des demandes ponctuelles. La rémunération de 25 euros n’est pas considérée comme limitante pour les professionnels de santé, contrairement à l’absence de valorisation du travail d’équipe, nécessaire à la mise en place du protocole. « Nous avons financé nos réunions d’équipe par les financements perçus dans le cadre de l’Accord conventionnel interprofessionnel (ACI) de la MSP », souligne le Dr Etienne Deslandes, médecin généraliste au PSHC, précisant que l’absence de soutien à l’ingénierie constitue une limitation dans la rédaction de protocoles locaux. Les structures souhaiteraient bénéficier de financement pour du personnel formé en ingénierie pour l’élaboration de protocoles.
« Certaines dérogations préfiguratrices pourraient intégrer le métier socle »
La mise en oeuvre des protocoles de coopération cristallise les demandes d’évolution des compétences des infirmiers. Est-ce envisageable et envisagé ? Brigitte Feuillebois, conseillère experte des professions paramédicales au ministère de la Santé et Marie-Astrid Meyer, cheffe de mission pour la pratique avancée et les protocoles de coopération à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) apportent des éclaircissements.

Une évolution des compétences infirmières en lien avec celles acquises dans le cadre des protocoles, peut-elle être envisagée ?
M-A. Meyer – De manière générale, la finalité des protocoles de coopération est soit d’envisager d’intégrer les compétences acquises dans un métier socle parce qu’elles sont utilisées par un grand nombre de professionnels, soit de rester pérennes, donc sur un fonctionnement délégant/délégué car la coopération ne concerne qu’une part restreinte de délégués.
B. Feuillebois – Dans le cadre des travaux en cours sur la réforme des compétences infirmières, certaines dérogations préfiguratrices permettent de définir des activités qui pourraient éventuellement être intégrées dans le métier socle, notamment dans le champ technique ou dans des approches plus globalisantes telles que les consultations infirmières. Cependant, pour le moment, dans un grand nombre de domaines, les effets ne sont pas suffisamment significatifs pour que ces compétences, telles quelles, intègrent le métier socle. La réflexion se pose toutefois pour Asalée, qui cible l’éducation thérapeutique, et pour les consultations en santé sexuelle. Ainsi, si nous décidons de cibler les missions de l’infirmier de demain sur la prévention et l’éducation, nous pourrons éventuellement intégrer des éléments des constats observés dans le cadre de ces protocoles.
D’autres évolutions sont-elles à prévoir ?
B. Feuillebois – Du côté des infirmiers, nous avons deux projets de protocoles nationaux en cours de d’élaboration : l’un sur l’accompagnement de la douleur par l’infirmière et l’autre sur les soins palliatifs. Ils sont suffisamment emblématiques pour que nous envisagions un déploiement national.
M-A. Meyer – Nous prévoyons par ailleurs de continuer à déployer les protocoles pour toutes les professions. Il faut noter que les manipulateurs en électroradiologie médicale occupent la première place du podium avec la prise en charge de 98 000 patients sur les 400 000 recensés en 2022 pour le seul protocole échographie. Avec ce constat et les avancées technologiques, il est opportun de nous poser des questions sur la refonte de leur métier socle ou sur une évolution vers la pratique avancée. C’est grâce aux protocoles que nous parvenons à ces réflexions. Ils peuvent aussi constituer une réponse territoriale pour améliorer l’accès aux soins pour le plus grand bénéfice des patients. Grâce à l’enquête annuelle, nous pourrons identifier efficacement les protocoles qui sont les plus performants, et inversement, afin de répondre aux besoins. Cela nous permettra de déterminer s’il faut mettre fin à certains protocoles.
La mise en place des protocoles de coopération par les professionnels libéraux rencontre quelques freins pointés du doigt par les acteurs : une rémunération non adaptée et l’absence d’accompagnement en ingénierie…
M-A. Meyer – En préambule, il est important de noter que 60 % des protocoles nationaux sont déployés en ville et que 30 des 106 protocoles locaux le sont aussi. Les protocoles nationaux sont co-portés par la DGOS et la DSS. Certains ciblent déjà particulièrement les libéraux, notamment celui pour les Soins non programmés (SNP) ou encore pour la prise en charge à domicile, par l’infirmier libéral, des patients âgés ou en situation de handicap, en difficulté pour se déplacer aux cabinets des médecins. Ils peuvent déjà s’en saisir.
En ce qui concerne les protocoles locaux, nous avons l’intention d’encourager les ARS à se positionner en tant que ressources des professionnels libéraux, dans leur rédaction. Dans tous les cas, le principe est de travailler avec des équipes volontaires, sans oublier que le médecin peut ainsi redéployer son temps sur des patients plus complexes.
B. Feuillebois – Depuis 2019, l’adossement d’un financement a un protocole facilite l’adhésion des libéraux. À titre d’exemple, le protocole portant sur les SNP dispose d’une enveloppe spécifique, fixée à 25 euros par l’Assurance Maladie. Cette somme est versée à la structure, et la répartition entre les professionnels engagés est ensuite déterminée par l’accord local. Pour le protocole relatif à la prise en charge des personnes âgées et handicapées, le modèle économique a récemment été accepté par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) avec un montant forfaitaire de 370 euros par patient entrant dans le protocole. Ce montant est partagé à hauteur de 310 euros pour l’infirmière et 60 euros pour le médecin. L’insuffisance de la valorisation pointée du doigt par les libéraux n’est en réalité qu’une des raisons expliquant le déploiement limité des protocoles en ville. Certains médecins ne souhaitent pas se détacher d’une certaine partie de leur activité. ■
Laure MARTIN
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
En 2022, 400 000 patients ont été déclarés suivis dans le cadre des protocoles nationaux, dont 70 000 par des infirmiers.
*Représentée dans toute la France par ses quinze fédérations régionales, l’association AVECsanté œuvre au développement de l’exercice coordonné en équipe et en Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP).
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |


 Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
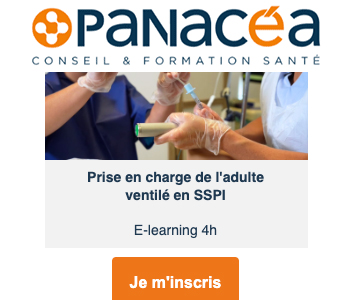

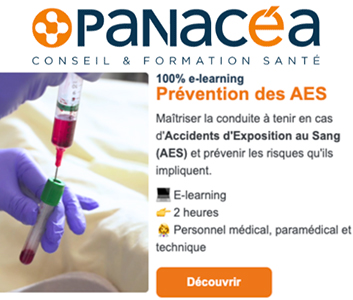





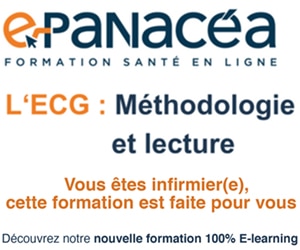
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.