Remarques insidieuses de patients, carrières plus lentes, hiérarchie trop effacée… Le sujet est presque invisible, mais des infirmiers et infirmières sont parfois victimes de racisme sur leur lieu de travail.
Aujourd’hui, Assia* est une infirmière heureuse. Elle exerce depuis de longues années comme Ibode dans un établissement privé parisien. Elle aime line du bloc, la précision et la technicité de l’orthopédie dont elle est spécialiste. Pourtant, si elle se dit épanouie dans son travail, se dessine, au gré de son récit, un parcours émaillé de micro-agressions, de vexations invisibles. Comment aurait-elle imaginé que pour elle, tout aurait été si dur ? Tout débute quand elle est étudiante en IFSI : alors qu’elle estime avoir rendu un travail sérieux, elle doit repiquer sa deuxième année pour une mauvaise note. Même si elle ne peut rien prouver, elle ne peut s’empêcher de faire le lien entre ce résultat et son groupe de travail, constitué uniquement d’autres étudiants aux noms maghrébins. Quand elle valide son diplôme, c’est avec la fierté de rendre hommage aux sacrifices de ses parents, originaires de Tunisie. Arrivée sur le marché du travail au milieu des années 90, Assia s’étonne lorsqu’on exige d’elle un test psychotechnique. Elle demande à d’autres camarades de son IFSI s’ils ont été confrontés à cette exigence, et leur réponse négative la plonge dans l’incompréhension.
Elle postule à plusieurs établissements parisiens, en vain. Alors quand elle apprend de source que des postes sont vacants dans un autre hôpital, elle se présente auprès de la direction. La secrétaire lui confirme que des postes sont libres. Pourtant, encore une fois, sa candidature n’est pas retenue. « Même un poste de nuit ? », interroge-t-elle lors d’une tentative de candidature. La réponse est non. Elle sort en pleurant. Assia postule enfin à la Pitié-Salpétrière. Sa recruteuse ne comprend pas les refus successifs, son dossier est bon. « C’est incompréhensible. Moi je vous prends ». Elle revit. Mais ce n’est pas fini : une fois postée, elle fait face à des remarques insidieuses. « Je ne savais pas qu’ils recrutaient des gens comme toi », s’entend-elle dire un jour de la part d’une consœur, alors qu’elle exerce au bloc des urgences. Et puis le sentiment d’avancer professionnellement plus lentement que les autres ne la lâche pas…
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
L’hôpital, pas exempt de racisme
L’expérience d’Assia est-elle une exception ? En 25 ans, les choses ont sans doute changé, mais il est difficile de le confirmer ou de l’infirmer, tant les chiffres manquent.
Du côté de la Dilcrah (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti- LGBT), aucune étude spécifique n’a été menée sur le sujet du racisme subi par les infirmiers de la fonction publique. « Proposer des formations [sur les discriminations] ne fait pas partie des missions de la FHF, ce sont les établissements qui mettent en place des actions à destination des professionnels et des patients, dans le cadre plus large de la lutte contre les discriminations à l’hôpital », rappelle de son côté la Fédération Hospitalière de France. Contactée sur les initiatives des directions d’hôpitaux quand des actes de discriminations raciales sont commis à l’encontre des soignants, l’AP-HP, qui ne dispose pas de chiffres sur la question, a répondu qu’il existe dans ces cas les déclarations d’effets indésirables (voir ci-dessous). Finalement, c’est une étude menée par l’Association des directrices et des directeurs d’hôpital en 2015 qui est la plus révélatrice. Les résultats montrent que les discriminations envers les soignants existent en effet, basées sur le genre, l’âge, l’apparence physique… et l’origine ethnique. Les personnels hospitaliers et les usagers ne sont pas concernés de la même façon : « l’origine ethnique joue davantage en défaveur des usagers (62 %) que des professionnels (39 %)1 » , peut-on y apprendre. Comprendre : les usagers font comparativement davantage face à d’actes racistes (voir ci-dessous sur le syndrome méditerranéen) que les soignants.
Pourtant, « à l’intérieur de l’hôpital, il existe à la fois des rapports de classe, de genre, et inévitablement de race. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les postes sont blancs, masculins, et plus vous descendez dans la hiérarchie, plus les profils sont variés, avec des femmes, notamment des femmes racisées. La diversité des profils est inversement proportionnellement au prestige et à la technicité des professions », affirme la sociologue Marguerite Cognet, spécialiste des discriminations raciales à l’hôpital. Les métiers d’aides-soignants, agents de services hospitaliers, services techniques, infirmiers, comptent ainsi plus de personnes racisées, explique-t-elle. Pour ces personnes, « les parcours, l’accès aux promotions sont plus compliquées ». Ça a été le cas pour Jacinthe*, infirmière intervenant en post-opératoire. « Quand j’étais étudiante, je travaillais jour et nuit. Ma cadre faisait appel à moi comme aide-soignante vacataire. Le jour où j’ai été diplômée et que j’ai candidaté pour un CDI d’infirmière, j’ai constaté que des personnes arrivées bien plus tard étaient prises. Moi pas, et j’ai dû conserver un statut de vacataire », déplore-t-elle. Quand elle doit s’absenter pour un grave problème familial, elle constate à son retour que toutes ses vacations sont annulées. « On m’a dit que j’avais fait du mal à l’institution en la laissant tomber, alors que je vivais une épreuve familiale ! »
Mais comment être sûre que ce comportement était bien lié à sa couleur de peau ? C’est toute la difficulté. Car les épisodes de racisme frontal, « intentionnels », comme le précise Marguerite Cognet, sont relativement peu fréquents. Au quotidien, le racisme se fait plus sournois. « À commencer par l’humour. Toutes les personnes racisées doivent gérer ça en permanence », précise la sociologue. Quitte à passer pour « des personnes aigries » quand elles se permettent de contester une mauvaise blague. Les soignantes racisées subissent aussi du paternalisme, c’est-à-dire, « la reproduction de comportements et de pratiques à partir de préjugés et de représentations racistes », explique Marguerite Cognet. Pourtant, des situations ubuesques se produisent parfois. Jacinthe se rappelle un moment horrible. « Un monsieur est arrivé. Il avait un tatouage de Jean-Marie Le Pen, mais je devais le soigner. Puis il m’a dit : “Retourne chez toi, sale singe”. Ça a été très violent. Après son réveil, il s’est excusé », relate-t-elle. Le mal était pourtant fait. Face à ces mots, ces gestes ou comportements, Jacinthe ou Assia se sont souvent senties seules et estiment ne pas avoir été ou être correctement protégées par l’institution.
Du côté des soignants, le risque du syndrome méditerranéen
Si les soignants subissent le racisme et les discriminations, il arrive aussi qu’ils puissent prendre en charge un patient différemment en fonction de leur origine, à cause de stéréotypes dont ils sont imprégnés, malgré eux. C’est ce que l’on appelle le « syndrome méditerranéen ». Dans leur article « Le syndrome méditerranéen : une stigmatisation par catégorisation des conduites de maladies », paru dans la revue Médecine de décembre 2020, Myriam Dergham et Rodolphe Charles le définissent ainsi : « Le syndrome méditerranéen est défini implicitement comme une manifestation excessive de la douleur ou de la plainte par des patients du pourtour méditerranéen ; il est alors d’usage de moins donner suite à leurs demandes, en particulier d’antalgiques ». Cela concerne les patients maghrébins, mais aussi, par extension les patients originaires d’Afrique subsaharienne ou même d’Europe de l’est. Myriam Dergham, interne en Médecine Générale et détentrice d’un Master Enjeux et Politiques de Santé – DEPT de Saint Etienne, cite les travaux de l’équipe du professeur Xavier Bobbia, urgentiste à Montpellier : par un questionnaire, les répondants (1 563 médecins et infirmiers urgentistes en France, en Suisse, en Belgique et à Monaco) ont dû interpréter et évaluer un visuel de gravité. Face à eux, des images générées par de l’IA, 4 femmes, 4 hommes, d’origine supposée différente, européenne, subsaharienne, asiatique, et maghrébine. Résultat : dans 62 % des cas, le cas clinique a été considéré comme une urgence vitale quand l’image associée était celle d’un homme, contre 49 % pour les femmes, et dans 58 % des cas quand le cas était associé à l’image d’une personne blanche contre 47 % pour une personne noire. Pour Myriam Dergham, pas de doute : « il existe encore des biais sur lesquels travailler ».
Le médecin, qui donne des cours à des étudiants en santé, (futurs médecins, sages-femmes, kiné…) analyse : « En tant que soignants, on est convaincu d’un idéal républicain, de soigner tout le monde de la même façon, c’est ce que l’on nous a enseigné lors de nos études, avec en tête, ce credo : ‘‘on paie selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins”. Et c’est presque une bonne chose que les soignants en soient convaincus. Alors se dire qu’on a des biais – sexistes, grossophobes, racistes – c’est très douloureux. Cela signifie se remettre en question, voir la société d’une autre façon, et reconnaître qu’on n’a pas tous les mêmes chances. D’un point de vue humain, c’est assez compliqué. Je pense à un médecin connu sur les réseaux sociaux qui déclare : “Quand je mets ma blouse, je ne vois plus les couleurs”. Ce n’est pas vrai. Les couleurs, on les voit, le genre, on le voit, les kilos on les voit etc. La question est plutôt : qu’est-ce qu’on fait de cela ? Comment ne pas juger ? Comment déconstruire nos jugements ? En médecine, on nous apprend à ne pas juger et discriminer, mais pas comment le faire. C’est un recul difficile à prendre car lors de nos études, nous avons tellement de choses à apprendre que les discriminations passent en second, car ce n’est pas là-dessus que nous sommes évalués ». Mais les cursus et les mentalités évoluent, et c’est ce à quoi entend participer Myriam Dergham auprès de ses étudiants : la première chose qu’elle fait avec eux, c’est d’ailleurs un « check des privilèges » pour leur faire prendre conscience de leurs éventuels biais.
L’institution, à la hauteur ?
Une étude menée au Québec2 dans plusieurs établissements de santé révèle que : « Dans certaines situations, c’est la logique “d’économie libérale”, où le “client est roi”, qui prédomine », y lit-on. Résultat : outre-Atlantique, si une infirmière est insultée, elle va avoir tendance à être remplacée pour « accommoder l’usager ». En France, le système de soins est différent, inscrit dans un profond universalisme. Si de telles situations sont néanmoins possibles, on peut aussi envisager que ce serait, non pas forcément pour « satisfaire » l’usager, mais peut-être pour protéger les soignants de ces attaques ? Reste que ces expériences sont marquantes. Assia se rappelle une femme venue aux urgences pour une appendicite. En s’adressant à l’infirmière, elle lui demande, inquiète : « C’est vous qui allez m’opérer ? ». Assia la « rassure » et lui dit que non. « Mais ce soir-là, les médecins étaient tous maghrébins. Alors je lui ai expliqué que si l’on attendait, cela pouvait s’aggraver en péritonite et que dans le pire des cas, elle pourrait en mourir. Elle a fini par accepter. Mais j’ai ruminé et ça m’a fait mal », confie-telle. Comme le souligne une étude de l’Institut français des relations internationales (IFRI)3, « les soignants font le plus souvent abstraction de ce racisme pour pouvoir faire leur métier et soigner tous les patients ».
Il y a quelques années, Jacinthe fait aussi face à un événement pour le moins étrange. Deux collègues qui encadraient une étudiante en soins infirmiers sollicitent un rendez-vous avec la cadre du service car le stage se passe mal. Jacinthe est pressentie pour prendre le relais. Lors de l’échange, la cadre aurait dit : « Je ne veux pas d’une Noire pour encadrer une Noire. Je veux du panachage ». Jacinthe est choquée : ce qui doit primer, ce sont les « compétences et expérience », pas la couleur de peau. Elle en fait part à son chef de service et attend encore un retour. L’étude de l’IFRI stipule encore que : « La discrimination raciale qui prend plusieurs formes à l’hôpital (entre personnels, entre personnels et usagers) n’apparaît que rarement comme une priorité dans la réflexion et l’action des gestionnaires des établissements (direction, RH) ». En effet, « les incidents qui concernent les AS, les ASH ou les infirmiers restent au niveau des cadres et ne remontent pas comme des événements indésirables », assène Marguerite Cognet.
Du côté des syndicats, peu ou pas de cas sont connus. La CGT a dit ne pas en avoir relatés. Thierry Amouroux, du SNPI, n’a pas non plus de dossiers en tête. Mais cela ne signifie pas que le racisme est absent de l’hôpital, seulement que les cas peuvent être sous-reportés. En effet, « les situations de racisme ou de discrimination raciale ne sont qu’exceptionnellement portées en dehors du service, vers les membres de la direction des établissements, et encore moins fréquemment vers des instances extérieures aux établissements comme le Défenseur des droits. Le règlement “local” des expériences de discrimination raciale laisse les directions dans l’ignorance de l’ampleur du phénomène », précise l’étude de l’IFRI. Assia comme Jacinthe n’ont pas toujours reporté les faits subis, par conviction que cela n’aboutirait pas. « Pendant longtemps, l’hôpital s’est nourri de son image d’humanité. Si l’on prend les déclarations des professions de santé, elles se veulent égalitaires », rappelle Marguerite Cognet. La réalité est plus complexe. Mieux informer le personnel comme les usagers, mieux former les soignants à la lutte contre les discriminations, davantage impliquer les RH dans la lutte contre les discriminations, seraient des pistes intéressantes et… nécessaires. Comme le glisse Assia : « Si on retire les Noirs et les Arabes de l’hôpital, on ne peut plus soigner ».
Un dispositif de signalement mis en place à l’AP-HP
Actes de violence verbale, physique ou morale, agissements sexuels et sexistes, harcèlement moral ou de discriminations, à l’AP-HP les violences entre professionnels sont théoriquement appréhendées et réprimées, depuis septembre 2021. Un dispositif de signalement et d’enquête a été mis en place, accessible à tout professionnel de l’institution, qu’il soit victime ou témoin de comportements discriminatoires ou à caractère sexuel ou sexiste. « Ce dispositif garantit écoute, impartialité, neutralité et confidentialité. Dès lors qu’il y a signalement, la personne est écoutée, une enquête interne est menée pour analyser la situation et recueillir des éléments et appliquer, le cas échéant, des sanctions adaptées. Les personnes sont systématiquement accompagnées que ce soit au niveau local et/ou central. Des campagnes de communication et de prévention internes ont été menées pour sensibiliser et encourager la remontée de comportements de violence verbale, physique ou morale, d’agissements sexuels et sexistes ou de discriminations au travail », éclaire la communication de l’AP-HP. En avril 2024, 279 signalements avaient été effectués.
Fermeté et exemplarité : un modèle à suivre
Karima*, infirmière.
Infirmière pendant huit ans, j’ai été témoin à quatre ou cinq reprises de situations où des patients demandaient à changer de soignant, et il était évident, même si cela était exprimé à demi-mots, que c’était pour des motifs raciaux. À chaque fois, mes cadres de santé ont réagi avec une fermeté exemplaire. Ils ont systématiquement expliqué aux patients qu’ils ne toléraient aucune forme de discrimination et que les soignants étaient choisis pour leurs compétences et non pour leur origine. Cette attitude constante de soutien et de rappel des valeurs d’égalité et de respect devrait être systématique dans les services car elle crée un environnement de travail où les soignants se sentent protégés et valorisés, indépendamment de leurs origines.
*les prénoms ont été modifiés.
1 – Égalité à l’hôpital public : grand dessein et engagement au quotidien. CHU Média (chu-media.info)
2 – Racisme-et-discriminations-soins-infirmiers.pdf (sherpa-recherche.com)
3 – La diversité à l’hôpital : identités sociales et discriminations. IFRI
Delphine BAUER
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins


 Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).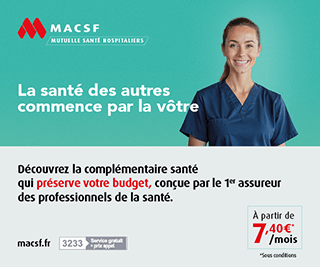








Vous devez être connecté pour poster un commentaire.