
On pourrait se croire dans une banale salle de soins, si ce n’est la clameur lointaine des détenus et le crépitement des talkies-walkies. Au-delà de la fenêtre inondée de soleil, un mur coiffé de barbelés barre l’horizon. Le brassard du tensiomètre au bras et la mine pâle, Marco* vient de passer sa première nuit en prison. Du haut de ses 27 ans, il a l’air d’un gosse apeuré. « Tout s’écroule, remarque Sylvie, infirmière à l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires) de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (78). D’autres pleurent, sont apathiques ou agressifs. »
Les infirmiers sont le premier contact des détenus avec l’unité sanitaire. 48 heures au plus tard après l’incarcération, ces derniers bénéficient d’un bilan complet. Un moment privilégié pour installer une relation de confiance. Antécédents médicaux, psychiatriques, radio dentaire, dépistages… Tout est passé en revue, avant que le médecin les reçoive. Ces patients ont droit à la même prise en charge que tout citoyen.
Outre les maisons d’arrêt, comme celle de Bois d’Arcy, où sont enfermés les personnes en attente de procès et les condamnés à des peines inférieures à deux ans, les soignants exercent en établissements pour longues peines, tels que les centres de détention. Ils s’y répartissent entre UCSA – pour les soins somatiques – et SMPR (service médico-psychologique régional) pour les soins psychiques. Des psychologues, des professionnels paramédicaux (kinésithérapeutes, psychomotriciens…) et des médecins spécialistes (dentiste, infectiologue…) y interviennent ponctuellement.

Les unités sanitaires sont par ailleurs organisées en trois niveaux. Les soins ambulatoires et les hôpitaux de jour psychiatrie sont implantés dans les murs des prisons. Troisième niveau, hors des murs, des UHSI et des UHSA (unité hospitalière sécurisée interrégionale, et spécialement aménagée, pour la psychiatrie) dédiées aux hospitalisations programmées, ont été progressivement créées depuis une dizaine d’années à l’hôpital.
Entre le détenu et le soignant, le surveillant
Centre de détention de Nantes. Brigitte parcourt d’un pas rapide le dédale de couloirs, de grilles et d’escaliers. A peine plus larges qu’un homme, les portes des cellules s’ouvrent sur une odeur indistincte de renfermé et de tabac froid. Accompagnée d’un surveillant, l’infirmière de l’UCSA distribue leurs traitements aux détenus placés à l’isolement et au quartier disciplinaire. Sans jamais se départir de sa bonne humeur.
Les infirmières assurent aussi des consultations, sans les gardiens cette fois. Afin de canaliser le flux des consultations et de responsabiliser les détenus, les patients doivent d’abord écrire ou utiliser le biais de dessins, car 10 % des détenus sont illettrés, et déposer leurs lettres dans des boîtes placées en détention.

Mais chaque jour, plusieurs renoncent à leur rendez-vous ou ne peuvent s’y rendre. Entre le détenu et le soignant, il y a en effet deux intermédiaires – les surveillants de l’unité sanitaire et ceux des étages – et la concurrence des activités de la prison : parloirs, douches, ateliers, cour de promenade… Dans un contexte de sous effectif chronique des surveillants et de surpopulation en maison d’arrêt, où les détenus sont enfermés en cellule 22 heures sur 24, les consultations sont difficiles à organiser.
Administration pénitentiaire et santé sont indépendantes depuis la loi de 1994 qui a confié aux hôpitaux les missions de soins et de prévention. Les soignants sont volontaires sur ces postes et salariés de l’hôpital de proximité. Mais l’organisation des soins « reste tributaire de celle de la pénitentiaire et de ses horaires », conclut Marie-Laure, infirmière à l’UCSA de Bois d’Arcy.
Santé et prison : le choc des cultures
La santé croise sans cesse les contraintes sécuritaires de cette administration. « Nous avons des regards et des orientations totalement différents », note Sarah, infirmière au SMPR de la prison des Baumettes, à Marseille. En cas d’urgence vitale, l’évacuation par le Samu est rapide. « Sinon, on doit parfois se bagarrer », lorsqu’un patient a besoin d’un examen complémentaire ou d’une consultation spécialisée dans un service classique de l’hôpital. Car toute extraction comporte un risque d’évasion.

Pour les coordonner, secrétaires médicales et infirmières jonglent entre la prescription du médecin, le bon vouloir de la prison, les disponibilités de l’hôpital et des surveillants pénitentiaires affectés aux escortes, voire de la police.
Ce choc des cultures professionnelles s’exprime aussi dans la difficulté à préserver le secret médical. Comment évoquer le mal-être d’un détenu, ou une maladie contagieuse qui nécessite aussi de traiter le codétenu ? Transmettre la juste dose d’information requiert une éthique solide.
Omniprésents, les surveillants sont les premiers interlocuteurs des détenus. Mais leurs grilles de lecture divergent. « Il arrive que nous ignorions des trucs graves, tel un détenu qui se cloitre dans sa cellule et ne se nourrit plus. On ne nous signale que ceux qui sont agités », regrette Sarah.
D’un autre côté, les gardiens sont placés dans des situations qui les dépassent ou les effraient. « Le VIH les fait flipper. Et ils sont très ennuyés par la maladie mentale et le risque suicidaire, qu’ils ont à gérer en détention… Je comprends leurs questions. J’essaye de leur donner des clefs de compréhension, sans indiquer le diagnostic. C’est subtil. Globalement, nous devons mener un travail pédagogique. »
Travailler enfermé

Une soudaine agitation naît à l’entrée de l’UCSA de Bois d’Arcy. Des invectives fusent. Une surveillante appelle du renfort. L’incident est vite contenu. « Les détenus sont intolérants à la frustration », commente Marie-Laure, infirmière. Sécurité oblige, les soignants sont souvent équipés d’alarmes. Ils veillent à ne laisser traîner aucun instrument. « Nos patients sont filous : il est arrivé que l’on nous pique de l’alcool à 90° ».
Les prisons sont des huis-clos où tout s’exacerbe. Le bruit, la tension permanente, l’instabilité des humeurs et la pression des patients finit par éprouver les soignants. « Ils nous demandent d’être toujours présents et dans l’empathie. On donne énormément et on se vide un peu », raconte Mathieu, infirmier dans l’UHSA de l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif (94). Les groupes d’analyse des pratiques, la solidarité des équipes et des sas de décompression – dans et hors les murs – se révèlent indispensables.
Emilie Lay

Pour recevoir ActuSoins magazine chez vous (trimestriel), c’est ICI
Karim*, incarcéré à Bois d’Arcy
Libérable en août, ce détenu souffre d’une entorse grave de la cheville. « Je suis tombé dans l’escalier de l’UCSA alors que je me dépêchais d’aller au sport à cause des blocages. » En effet, dès qu’un groupe de détenus circule en maison d’arrêt, les autres mouvements s’interrompent, pour prévenir les émeutes.
« Je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça. On m’a dit que cela allait être long. Cela m’inquiète… » Il jette un regard las sur son attelle. La douleur, ça me tue. Je dors mal, j’ai perdu plusieurs kilos en trois semaines. Sur mes béquilles, j’arrive au moins 10 minutes en retard aux parloirs. »
J’effectue des démarches auprès d’un employeur, en vue de ma sortie, mais cette entorse me pénalise. On me laisserait sortir pour faire quoi ? ». Depuis notre venue, Karim a finalement obtenu sa remise de peine.
Sarah, infirmière aux Baumettes : « place au dialogue »
Dans l’unité d’hospitalisation de psychiatrie des Baumettes (Marseille), encore située au sein des murs de la prison, Sarah, infirmière de nuit, a retrouvé du calme et du sens. « Quand je délivrais la méthadone en détention, je passais mon temps à apaiser des patients, menacés par les codétenus dans une cellule de 9 m². On donnait des anxiolytiques, au lieu de travailler sur l’addiction. Il me semblait n’être là que pour colmater les brèches ouvertes par la prison. » Pour supprimer la souffrance psychique, l’infirmière consacre désormais beaucoup de temps à discuter au fenestron avec ses patients.
En dépit de ses exigences, l’exercice en milieu carcéral accorde une large place au dialogue. Il confronte à une « altérité enrichissante. On y réalise aussi que tout un chacun peut dérailler à un moment de sa vie. En obligeant à de l’ouverture et de la bienveillance envers n’importe qui, le soin rend le soignant meilleur. »
* Les prénoms ont été changés


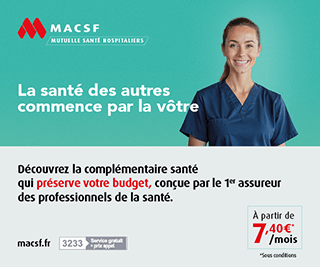








Gaelle Carru ça peut t’interesser
Je vais a l’UCSA de Muret pour le pré-pro ?
Haha merci ! ?
Elodie Morel
Mp LaLou Lalou Julie M. Tancrédi
Merci beaucoup je vais regarder
Bwaaaaa je veux y retourner !!!!!
Intéressant cet article !
Mais je ne suis plus si sur de vouloir y travailler finalement ?
Michael Galvez apprend le truc par coeur ou relie le PowerPoint
Merci poulette ! ??