
Une coordination autonome, en marge des syndicats
Quel moyen d’action choisir ? Comment mobiliser une profession très peu syndicalisée ? (car seulement 7% des infirmières le sont). Ne se reconnaissant dans aucune organisation existante, des infirmières et infirmiers mettent en place une Coordination Infirmière Ile de France. Cette nouvelle forme de syndicalisme permet de rassembler l’ensemble des infirmières, (syndicalisées ou non) autour de revendications communes : l’abrogation de la loi Barzach bien sur, mais aussi une hausse des salaires immédiate de 2000 francs, une reconnaissance de leur statut, des postes supplémentaires, et l’amélioration de leur conditions de travail. En septembre, le mouvement parti de Paris prend très vite une dimension nationale.
Ni bonnes, ni connes, ni nonnes… ni syndiquées
Malgré une très forte mobilisation (90% des infirmières grévistes), la coordination se voit exclue de la table de négociations, par les syndicats eux-même. La CFTC, la CFDT, FO et la CGC, qui ne représentent pourtant que partiellement la profession, refusent de s’associer à la coordination. Ils ne lui reconnaissent aucune légitimité. De son côté, la coordination continue de réclamer son autonomie et souhaite obtenir la reconnaissance des pouvoirs publics.
Il faudra attendre la grande manifestation du 13 octobre 1988 pour que les infirmières, portée par l’opinion publique, soient enfin reçues par le ministère.
Ce jour là, dans la matinée, ce sont 100.000 « blouses blanches » qui défilent dans les rues pour se faire entendre. « Ni bonnes, Ni connes, Ni nonnes ». Le slogan qu’affichent les banderoles affirme clairement le « ras-le bol » de ses professionnelles qui veulent en finir avec l’image traditionnelle de l’infirmière bonne sœur. La CGT qui s’est ralliée au mouvement défile à leur côté mais sans arborer d’étiquette. Dans l’après-midi du même jour, les autres syndicats ne rassembleront, quant à eux, que 15.000 personnes.
Entendues mais pas reconnues
Le 23 octobre, après un mois de conflit, Nicole Bénévise, porte parole de la coordination infirmière, annonce au journal télévisé d’Antenne 2, la fin de la grève et « demande aux syndicats de ne pas signer d’accords avec le gouvernement sans que la base soit consultée ».
Mais les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille. Le lendemain, l’accord est signé. Ces querelles affaiblissent le mouvement dès la fin novembre. Des actions continueront d’être menées jusqu’en 89, année de dissolution de la coordination. Une coordination qui n’a jamais vraiment réussi à établir un véritable dialogue avec un gouvernement qui privilégie les syndicats.
Cette prise de parole, autonome et spontanée, aura quand même payé. Le premier résultat a été l’abrogation du décret Barzach. S’ajoute à cette première victoire d’autres acquis très importants pour le métier : l’amélioration des perspectives de carrière et surtout, une sérieuse revalorisation des salaires des infirmières de 550 francs en début à 1500 en fin de carrière.
La coordination Nationale des Infirmières de 88 témoigne surtout d’une remise en cause des syndicats traditionnels : « Les infirmières françaises ont véritablement construit un nouveau modèle de lutte, et ce modèle est « subversif »(2).
Depuis qu’en 1991 la coordination s’est constituée en syndicat, elle ne mobilise plus autant : « l’engagement syndical est encore trop faible, ce qui est sans doute une des causes essentielles du manque de reconnaissance salariale » explique Nathalie Depoire, présidente actuelle de la CNI.
Pourtant, les revendications infirmières restent les mêmes qu’en 88 : amélioration des conditions de travail (qui s’avèrent être de plus en plus dures), revalorisation de leur qualification (avec la mise en place d’un cursus universitaire licence-master-doctorat), augmentation des salaires, etc.
Mais « la forte démobilisation du personnel, les effectifs très limités (nécessaire pour assurer un service minimum), le faible pouvoir d’achat des salariés, rendent difficile une telle mobilisation, même si rien n’est impossible» conclue Nathalie Depoire.
Anne-Sophie Popon
(1) et (2)Daniele Kergoat, Françoise Imbert, Hélène Le Doaré et Daniele
Sénotler (dir.) : Les infirmières et leur Coordination, 1988-1989. Paris,
Éditions Lamarre, 1992, 192 p.
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |




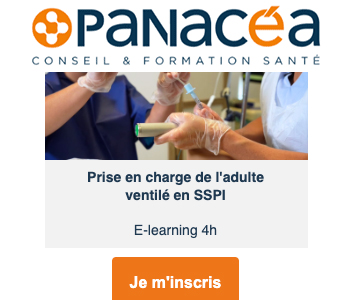
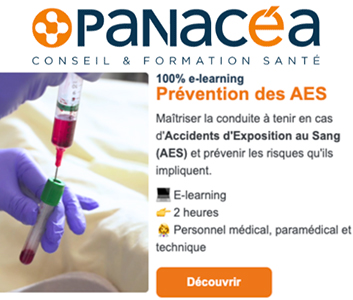



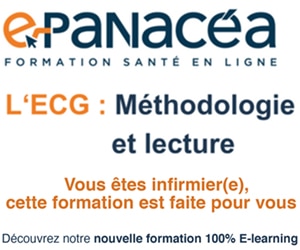
j’ètai en 3e annèe très fière d’assurer les soins pendant que mes ainèes dèfendaient mon avenir professionnel dans la rue :y’avait une solidaritè immense et je pense pas avoir laissè les malades en danger au contraire on a ètè responsables et rigoureuse très tot avant d’etre en poste
gt toute jeune mais je m’en souviens et cela ne m’a pas empêcher de faire mes études d’infirmière en 1990 ….. mais c vrai qu’on se demande si de telles manifestations seraient encore possible de nos jours …… :o(
j’étais dans la rue aussi en 88 (en 92 aussi) et j’ai encore des cartes avec “on n’est pas des bêtes !” j’étais à Grenoble et le mouvement été suivie par toutes et le salaire a tout de même fait un bond de 1000F… on n’a pas fait ça pour rien…
De beaux souvenirs… Mais pour quels résultats, en ce début du XXIe siècle ???
https://www.facebook.com/groups/NiBonnesNiNonnesNiPigeonnes/ parce qu’il y a bel et bien des infirmiers et aides soignants qui sont prêts a se battre et qui sont regroupés pour essayer de faire quelque chose ensemble
oui moi aussi j y etais infirmiere a l époque en clinique a Rennes 35000 mais je ne pense pas que les choses ont avancées pour le salaire et les conditions des infirmiéres
on s’est fait tapé dessus par les crs,j’ai filé par une bouche de métro,ah j’oublie les jets d’eau!
et oui a l’époque on se bougeait, auj. il n’y a plus que.. des moutons hiver 88 j’y étais dans la rue et plus d’une fois !!
Malles on se mobilise
https://www.facebook.com/groups/NiBonnesNiNonnesNiPigeonnes/