Plus de huit agents hospitaliers sur 10 (85%) ayant des horaires en 12 heures sont satisfaits de ce dispositif, mais 69% des représentants du personnel y sont défavorables, selon une étude de l’Association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux (Adrhess), présentée lors des Rencontres RH de la santé.

Il a rappelé que cette organisation du travail, “présente depuis longtemps dans les services de réanimation”, s’étend progressivement dans les autres secteurs de l’hôpital, mais que très peu d’études ont été menées sur le sujet.
Une enquête menée en 2013 dans 49 établissements franciliens avait montré que 37 d’entre eux avaient au moins un service concerné par le travail en 12h, a-t-il rappelé .
Afin d’avoir un panorama plus large de cette problématique, l’Adhress a interrogé entre juin et août les directeurs des ressources humaines (DRH) sur leur perception des horaires en 12h dans les services hospitaliers.
Un échantillon de 600 établissements a été sollicité par courrier électronique. Parmi eux, 136 établissements de toute taille, dont huit CHU et 45 CH de plus de 70 millions d’euros de budget, ont participé à l’étude.
Des “douze heures” dans 98 % des CHU
Une organisation en 12h a été mise en place dans 71 % des établissements répondants. L’intégralité des CHU répondants et la quasi-totalité (98 %) des CH de plus de 70 millions de budget ont mis une telle organisation en place. Un résultat “assez important” et “étonnant”, a commenté Matthieu Girier, chargé de communication de l’Adrhess et DRH aux CH de Lens et Hénin-Beaumont.
“La situation est plus contrastée parmi les établissements de moins de 70 millions d’euros de budget, tous statuts confondus”, a-t-il poursuivi. Plus de 75 % des établissements dont le budget est compris entre 20 millions et 70 millions d’euros ont des services en 12h, contre 36 % des établissements de moins de 20 millions d’euros de budget et 32 % des CHS.
La motivation des équipes demeure le premier motif de mise en oeuvre d’une telle organisation et seuls six établissements sur 136 l’ont mise en place sur la seule initiative de la direction, relève l’étude.
Ces projets ont majoritairement (69 %) reçu un accueil défavorable des représentants du personnel (37 % défavorables, 32 % plutôt défavorables). A l’inverse, les DRH se sont majoritairement montrés favorables (14% favorables, 40% plutôt favorables).
Plus de 76 % des établissements ayant mis en place cette organisation ont entrepris d’évaluer le dispositif, indique l’enquête. Ces études ont permis de révéler la satisfaction des personnels (85 %) et le très faible nombre d’équipes ayant souhaité revenir à un fonctionnement plus classique en trois équipes (4 %).
“Compenser le stress au travail”
Le travail en 12h est particulièrement apprécié du personnel car il permet de “mieux accepter le stress et l’insatisfaction du travail”, a expliqué Fanny Vincent, doctorante en sociologie à l’université Paris-Dauphine. Elle prépare une thèse sur le travail en 12h et a passé six mois au sein de différents services ayant mis en place ces horaires.
Le nombre de jours de repos occasionnés par cette organisation “donne aux agents l’impression de ne pas être tout le temps à l’hôpital”, a-t-elle observé. Dans un monde hospitalier où les horaires décalés sont fréquents, cela leur permet aussi “de retrouver enfin une vie sociale”.
Par ailleurs, “quitte à ce que leur journée soit ‘gâchée’ par leur service, ils préfèrent travailler 12h” et ensuite avoir des jours de repos, a-t-elle déclaré. Jours de repos qui leur permettent en plus de revenir plus facilement à l’hôpital en cas de besoin.
Véronique Rivat-Caclard, coordonnateur général des soins au centre hospitalier public (CHP) du Cotentin, a relevé d’autres avantages au travail en 12h. La demande des agents “est un élément moteur”, a-t-elle indiqué, car cette organisation leur permet de “mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle”.
Cette organisation permet aussi une “meilleure adéquation avec la présence médicale” et une “meilleure autonomie dans la répartition de la charge de travail des agents”. Par exemple, les agents travaillant le matin ne sont pas sous pression pour finir toutes les toilettes avant 13h, a-t-elle dit.
Les transmissions : le point faible
Le “point faible” du travail en 12h est “le temps et le mode de transmission”, a averti Véronique Rivat-Caclard. Cette nouvelle organisation “diminue le nombre de transmissions, mais diminue aussi le temps qui leur est accordé”.
L’outil informatique peut venir en soutien, a-t-elle indiqué. “Il ne remplace pas les transmissions, mais permet d’avoir des données recueillies au fil de l’eau, voire des synthèses”. Ces documents sont des “guides” qui permettent de “gagner du temps” à la transmission, a-t-elle souligné. La transmission écrite doit être privilégiée, ont aussi rapporté des DRH présents dans la salle.
Véronique Rivat-Caclard a aussi expliqué que, si la continuité est améliorée sur la journée, ce n’est pas le cas sur la durée du séjour, avec des agents parfois absents plusieurs jours.
Sur la pénibilité et la fatigue au travail, elle a rappelé l’absence d’études, ainsi que les difficultés liées à des situations particulières: grossesses, postes adaptés ou fin de carrières. L’auditoire a ainsi fait part de son inquiétude sur la santé des agents travaillant 12h par jour “quand ils arriveront à 45 ans-50 ans”.
Rédaction ActuSoins, avec APM
A relire :
Les 12 h pour les infirmières de Tenon : c’est bientôt fini (recours de la CGT contre le rythme en douze heures qui est actuellement dérogatoire en termes de droit du travail)
Fanny Vincent, citée dans l’article, nous répond :
Je souhaiterais intervenir pour restituer le contexte de cet article et rétablir la vérité quant aux propos déformés qui me sont attribués et qui donnent lieu à des interprétations erronées.
Tout d’abord j’ai été sollicité par Jean-Marie Barbot, président de l’AdRHess pour intervenir lors des rencontres RH de la santé, à titre universitaire, pour apporter, en toute modestie, un regard “extérieur” et neutre sur les 12h. Mon travail est un travail de doctorat, qui n’a pas vocation à faire des recommandations sur les 12h et encore moins à en faire l’apologie comme on a l’air de m’en accuser.
Mon propos lors de la table-ronde sur “la controverse sans fin des horaires en 12h” portait essentiellement sur les usages et les appropriations que les soignant-e-s désireaux-ses ou satisfait-e-s de leur travail en 12h en avait, principalement du point de vue de l’équilibre entre le travail et le hors travail.
Les questions qui cadraient mon intervention étaient les suivantes : Comment expliquer le développement d’horaires en 12h dans les services des hôpitaux publics ? Dans quelle mesure le contexte de travail fournit-il des clés d’explication au 12 heures ? Dans quelle mesure les métamorphoses sociales du rapport au temps et du rapport au travail nous permettent-elles d’appréhender le 12 heures comme un phénomène dérogatoire certes, mais en voie de normalisation dans un certain nombre de services hospitaliers ?
Mon propos se basait donc sur une perspective à la fois compréhensive (comprendre les motivations des soignant-e-s) et critique (quels effets cela produit-il ? – encore une fois en termes de “conciliation” vie professionnelle/vie privée puisque c’était ici mon propos).
J’ai dans un premier temps expliqué que le contexte de travail à l’hôpital était aujourd’hui tendu (du fait d’un certain nombre de réformes et de bouleversements organisationnels affectant l’hôpital parmi lesquels la doctrine managériale qui s’impose à l’hôpital aujourd’hui, et l’insuffisance du nombre de postes créés au titre des 35h notamment) et que les soignant-e-s en pâtissaient dans leur travail ( dans lequel certain-e-s ne se reconnaissent plus, travail intense pour lequel ils/elles disent n’avoir plus le temps, fatigue, manque de reconnaissance, etc.).
J’ai ensuite dit : “Alors quitte à ce que le travail ne soit pas reconnu et quitte à ce que la journée de travail, en 8h ou en 12h soit « gâchée » dans tous les cas par la fatigue que le travail provoque, ou « gâchée » par les rythmes atypiques attachés à ces métiers hospitaliers (on est décalé par rapport au reste de la population me disent certain-e-s soignant-e-s ; en effet les horaires qui s’imposent aux soignant-e-s de l’hôpital ne sont pas ceux de la société), autant rester 12h. C’est l’idée de concentrer le temps du travail qui s’est imposée ; quitte à venir travailler, autant venir pour 12h, pour de bon, et ne pas avoir à multiplier les jours au travail qui donnent l’impression d’ « être tout le temps à l’hôpital »”.
Je conviens que le terme “gâché“, que j’ai mis entre guillemets n’est pas très heureux, mais je n’ai pour l’instant pas trouvé d’autre terme transcrivant mieux cette idée.
Puis, j’ai ensuite dit, “les jours de repos supplémentaires dégagés avec les 12h peuvent sembler faciliter l’acceptation du temps occupé par le travail. Ce temps « de repos » gagné agit alors comme une compensation de la fatigue et de l’insatisfaction que peut dégager le travail, ainsi que du temps que l’on y passe. Il faut ainsi lire les 12h comme une solution que les soignant-e-s en 12h ont l’impression d’avoir trouvée pour maîtriser le temps du travail.”
J’ai encore dit bien d’autres choses mais ce serait ici trop long de tout retranscrire. Je reste à la disposition de ceux/celles qui le souhaitent pour échanger à ce sujet.






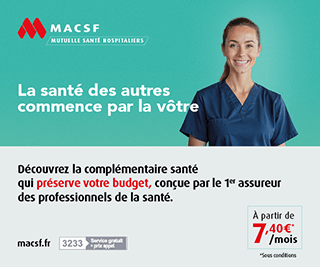




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.