Rythmes trop intenses, manque de moyens et de reconnaissance… Les infirmiers en psychiatrie sont en souffrance. ActuSoins leur donne la parole.
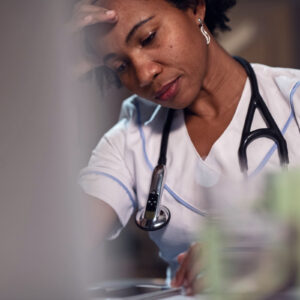
« Dans le métier, il y a ceux qui mettent des œillères pour tenir et il y a ceux qui souffrent et partent ». Attablée à une terrasse parisienne, Julia, 42 ans, préférerait être en mesure de travailler. Mais depuis plusieurs mois, elle est en burn out. Pourtant, elle a donné de sa personne pendant dix-sept ans, ne comptant ni ses heures, ni l’énergie déployée. Jusqu’à cette journée où une remarque de sa cheffe de service la fait craquer. Ce que Julia a aimé dans ce métier est devenu la raison pour laquelle elle l’a quitté : son intensité s’est transformée en charge insurmontable. Au début de sa carrière, « la psychiatrie était la discipline où nous étions les plus écoutés par les médecins », se souvient-elle. Plus aujourd’hui, alors que pendant le Covid, « on a bossé comme jamais. On voyait les patients, évaluait leur état. On tenait les murs ».
Aziza, qui travaille depuis trois ans, se sent déjà fatiguée. Pendant la pandémie, l’étudiante en soins infirmiers est affectée dans les services psy Covid. Une fois diplômée, elle est embauchée dans les services les « plus durs ». Mais l’esprit collaboratif si nécessaire pour tenir n’est pas toujours au rendez-vous : elle écrit même un courrier au député de la circonscription, dans lequel elle dénonce les fermetures de chambres et les insultes fréquentes. Les violences physiques, aussi, viennent régulièrement émailler le quotidien.
Les deux infirmières sont inquiètes et dénoncent une « situation alarmante » qui se dégrade rapidement.
Cet article a été publié dans le n°52 d’ActuSoins magazine (avril 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Détérioration des conditions de travail
En cause d’abord, les horaires en douze heures. « La discussion de la prise en charge des patients fait partie du travail. Mais d’une semaine à l’autre ce ne sont pas les mêmes équipes lors des réunions. Parfois elles ne se croisent jamais. Cela peut amener à des décisions totalement différentes, voire des clivages », raconte Julia. Autre danger, souligné par François Martineau, infirmier en psychiatrie et membre du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) : « en psychiatrie, les gestes sont tournés vers la relation, le lien. Il ne faut pas des mains, il faut des têtes, résume-t-il. Or après douze heures à côtoyer la folie, on fait les choses plus mécaniquement ». Ce shift dérogatoire, rappelle-t-il, devrait donc « rester exceptionnel » alors qu’il s’impose souvent en règle.
Le manque de personnel est par ailleurs flagrant. Quand Julia arrive dans son établissement, elles sont six infirmières. Elles ne sont plus que trois actuellement. À titre d’exemple, sur son groupement, il n’existe qu’une équipe addictologie pour quatre structures (qui comportent 5 000 personnels). « Dans mon service, nous avons 30 patients pour quatre infirmières et deux aides-soignantes. Nous n’avons pas assez de personnel pour développer des activités pour les patients », raconte Aziza.
Problèmes de recrutement
Bérénice exerce comme infirmière référente dans un établissement privé. Après le Covid, des initiatives ont été mises en place pour favoriser le bien-être soignant. Son poste, tout en transversalité, permet d’éviter la déperdition d’informations et ainsi, d’assurer un meilleur suivi des patients. Elle évoque aussi des « mini-staffs », des réunions auxquelles les infirmières sont conviées et qui permettent de faire remonter leurs problématiques. « C’était très attendu », confirme-t-elle. Mais malgré cela, le service « fait face à des problèmes de recrutement » et a recours à des intérimaires et vacataires, « qui connaissent moins bien le fonctionnement de la structure ». « Quand ce sont des intérimaires, c’est du gardiennage plus que du soin », estime carrément Julia. Privé ou public, même combat.
Pour François Martineau, il faut rendre « la profession désirable ». Cela signifie des revalorisations salariales et plus de moyens humains. Et surtout, améliorer la prévention : « la psychiatrie, c’est 10 % à l’hôpital et 90 % en ville ». Il encourage donc la prise de contact des structures psychiatriques avec les autres acteurs de la santé présents sur le territoire : CMP, foyers, hôpitaux de jour, PMI, MDS, services de police municipale ou nationale… En somme, la psychiatrie n’est pas un monde à part.
La psychiatrie, parent pauvre de la médecine ?
Pour Julia et Aziza, la psychiatrie est pourtant le « parent pauvre de la médecine » alors qu’un cinquième de la population est concernée (troubles anxieux, troubles dépressifs…) et que la demande explose. « On sent une volonté du gouvernement de faire des économies, puisque la psychiatrie représente le premier pôle de dépenses de la sécurité sociale. Tout montre qu’on va vers une privatisation grandissante », analyse Aziza.
La fermeture de lits est une réalité dans de nombreux services, y compris aux urgences. Les cas de patients contentionnés, à qui l’on pose une sonde urinaire en attendant une prise en charge, se multiplient. « La psychiatrie n’est pas un secteur à part de la santé, plaide François Martineau. Certaines pratiques doivent être abandonnées : la contention ne peut être que physique – réalisée avec nos bras – et les soignants en services somatiques devraient être mieux formés aux spécificités des patients psy. Ces patients vont aux urgences, ont des problèmes de diabète ou quand ils vieillissent, vont en Ehpad. Il faut éviter de les maltraiter par méconnaissance de leurs pathologies et de ce qu’elles entraînent ».
Les formations, initiale et continue, devraient donc mieux intégrer les questions psychiatriques, afin d’éviter toute maltraitance.
À l’Hôpital de Ville-Evrard, la thérapie familiale porte ses fruits
Malgré un secteur en souffrance, des initiatives innovantes locales voient le jour. À l’hôpital de Ville-Évrard (Neuilly-sur-Marne), par exemple, l’implication de certaines familles dans les décisions suscite une satisfaction notable des professionnels de santé.
« Je suis hyper chanceuse ». Ces mots, rares en psychiatrie, témoignent de l’enthousiasme de Johanna Lambertini, infirmière à l’hôpital de Ville-Évrard. Avant d’arriver dans l’Unité coquille, qui accueille les familles d’enfants autistes, elle a exercé en pédopsychiatrie en unité intra-hospitalière, puis auprès d’adolescents. Mais « j’ai sérieusement pensé à me reconvertir », confie-t-elle. En psychiatrie, elle a trouvé si dur de voir des enfants séparés de leurs parents lors de leur hospitalisation… Ici, tout se passe autrement. « Nous incorporons les familles dans le soin. Cela me paraît évident maintenant ! ». En effet, dans l’Unité coquille – une expérience inédite – quatre familles, surtout des mamans, sont reçues pendant six mois pour une thérapie multifamiliale. « Nous ne nous positionnons pas comme des sachants. Nous voulons que les solutions puissent émerger des familles elles-mêmes », explique Johanna Lambertini. Lors de ces rencontres hebdomadaires, l’infirmière aide à créer des liens, à faire tomber les barrières de la pudeur ou de la timidité et parfois, elle questionne les familles sur leurs pratiques, sans jamais « plaquer » une solution à leurs soucis.
Ici, elle a « l’impression de reprendre soin », d’avoir le temps de « penser » grâce à une équipe pluridisciplinaire dans laquelle elle a toute sa place. « J’apprends aussi à déconstruire tout ce que j’ai appris : en cassant les barrières entre les familles et les soignants, en laissant le temps aux familles de faire leurs expériences plutôt que d’imposer une alternative. Je mets du sens dans mon travail et je suis écoutée ». Même satisfaction pour Marina Machado, infirmière en unité mobile de psychiatrie néonatale, un espace d’accueil, de prévention et de soins des troubles précoces de la relation parents – bébé en partenariat avec la maternité de Montfermeil. Cette approche de suivi à long-terme, démarrant dès la grossesse et allant jusqu’au 18 mois de l’enfant, agit comme une véritable soupape pour les familles ayant traversé des traumatismes, faisant face à des troubles comportementaux ou éprouvant des difficultés dans les liens d’attachement. Elle permet aussi à l’infirmière de se sentir épanouie dans la « dimension du soin ». « Je ne remettrais pas les pieds dans mon ancien service », affirme-t-elle, heureuse de répondre aux besoins croissants des familles du 93, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et de pouvoir bénéficier des formations qu’elle demande régulièrement pour acquérir de nouvelles compétences. « On sent qu’on fait la différence », se réjouit-elle.
Ces pratiques innovantes s’appliquent aussi à l’unité Troubles du comportement alimentaire de l’adolescent, explique Juliette Sinet, infirmière de la structure. « Nous travaillons de manière horizontale », ce qui confère à l’équipe « une liberté dans les décisions ». L’expérience « riche et rare » fait des émules : le service est régulièrement contacté pour être dupliqué ailleurs en France.
Delphine BAUER
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins



 Cet article a été publié dans le n°52 d’ActuSoins magazine (avril 2024).
Cet article a été publié dans le n°52 d’ActuSoins magazine (avril 2024).


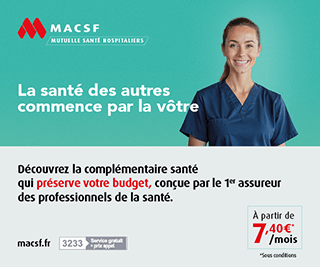




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.