Qu’ils soient libéraux, hospitaliers ou encore à la retraite, certains infirmiers ont fait le choix, en parallèle de leurs activités, d’intervenir en tant que soignants lors d’événements sportifs. Leur rôle : mettre à disposition des sportifs et du public leurs compétences pour soigner petits bobos et gros traumas. Article paru dans le n°34 d’ActuSoins Magazine (septembre 2019).

Les supporters du PSG commencent à entrer au Parc des Princes. Ce soir, c’est un match en retard qui se joue à partir de 21 heures.
Mais dans l’infirmerie principale, Marie-Lou, infirmière (IDE), prépare les sacs pour les infirmiers depuis 17 h 30 et réalise l’inventaire du matériel médical, mis sous clef, avec le logisticien d’International Service Medical Assistance (ISMA), structure qui organise la prise en charge médicale du Parc des Princes.
Au stade, quatre infirmeries sont réparties de part et d’autres du site. Un maillage cohérent, efficient et efficace.
Dans chacune d’elles : un médecin et/ou un infirmier avec une équipe de secouristes de la Protection civile, de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) ou encore de la Croix-Blanche pour les personnes en situation de handicap.
« Dans le stade, ce sont les agents de sécurité qui généralement nous informe d’un besoin d’intervention auprès d’un spectateur, explique Marie-Lou. Les secouristes amènent la personne jusqu’à l’infirmerie la plus proche. Mais le médecin et les secouristes peuvent aussi être amenés à intervenir dans l’intégralité du stade. Le délai d’intervention est en moyenne de moins de trois minutes. »
Ce soir, la situation reste calme. Un jeune homme a été pris en charge pour une allergie aux arachides et une jeune femme pour un malaise.
Une prise en charge rapide

« Nous sommes principalement présents pour les spectateurs qui vont faire des malaises, des entorses ou qui sont en état d’ébriété », souligne Sandra, infirmière chez ISMA depuis 2014.
Mais l’équipe médicale peut aussi être amenée à intervenir auprès des joueurs lorsque le pronostic vital est engagé.
L’intervention auprès des sportifs est très protocolée, sauf en cas d’arrêt cardiaque ou respiratoire. « Sur certains événements sportifs, nous pouvons avoir un lien plus direct avec les sportifs sur des petits traumatismes parce que la demande vient de l’organisation, rapporte Gilles, infirmier chez Isma depuis seize ans. Nous avons le matériel de base des urgentistes pour la prise en charge immédiate et, ensuite, nous évacuons au besoin vers l’hôpital le plus proche en fonction des recommandations de la régulation via le Samu ou les ambulances présentes sur place. »
Lors des interventions, l’Ide reste dans son rôle propre. Il travaille dans le cadre de son décret de compétences et sur prescription médicale. « Il nous faut toujours l’aval du médecin pour faire un acte, souligne Sandra. Sur un arrêt cardiaque, bien entendu, je ne vais pas attendre un écrit pour faire la perfusion et donner l’adrénaline au patient. J’anticipe et ensuite on régularise avec la prescription. C’est un peu comme avec le Samu, nous savons ce que nous avons à faire. » L’Ide donne les médicaments prescrits par le médecin et sert aussi de chef d’orchestre pour l’intervention des secouristes.
« Au Parc des Princes, il y a environ 47 000 personnes, soit la population d’une ville moyenne, il peut se passer n’importe quoi », indique Audrey, également infirmière chez ISMA.
Les équipes médicales communiquent par un canal radio médical pour s’assurer de la confidentialité des échanges mais elles ont aussi accès au canal ″sécurité″. « Les talkies-walkies permettent à chacun d’être en contact avec le médecin manager du parc », souligne Marie-Lou.
Un équilibre entre plusieurs activités

Marie-Lou, aujourd’hui Infirmière à la retraite, a travaillé en réanimation pendant plus de trente-cinq ans. Sa rencontre avec le monde de l’événementiel s’est faite par hasard. « Je soignais une personne d’ISMA qui m’a demandé si je souhaitais rejoindre l’équipe, ce que j’ai accepté », témoigne-t-elle.
Pourquoi ? « C’est une activité que je ne connaissais pas du tout et je voulais voir ce que je valais sans le matériel et les scopes des services hospitaliers qui nous signalent lorsqu’un patient ne va pas bien », explique-t-elle.
De son côté, Sandra, infirmière depuis 2011, a commencé à exercer aux urgences mais, après quatre à cinq ans d’exercice, elle a ressenti un « besoin d’autre chose ». « A la base, je voulais faire de l’humanitaire, mais j’ai été mise en contact avec ISMA et j’ai été recrutée en 2014. »
Cette infirmière a toujours été attirée pour les prises en charge en urgence. C’est d’ailleurs ce type de profil qui est recherché par ISMA. « Il faut savoir travailler dans des conditions autres que celles de l’hôpital », rapporte-t-elle.
Participer à des événements sportifs, pratiquer son métier dans d’autres conditions, rencontrer d’autres équipes médicales et des bénévoles secouristes : c’est ce qui la séduit dans ce mode d’exercice.
Infirmier libéral (idel), Gilles organise son planning en fonction des événements et des besoins d’ISMA. « Je reconnais que ce n’est pas forcément évident pour mes collègues libéraux de travailler avec moi. Mais en fonction de l’activité, on arrive à s’organiser », précise-t-il.
Avant de pratiquer en libéral, il travaillait aux urgences. « J’ai toujours été orienté vers cette pratique et ISMA me permet de continuer à m’entraîner sur ce type de prises en charge et d’être formé », raconte cet infirmier libéral qui apprécie de ne pas rester « enfermé » dans une seule pratique.
« Les méthodes de travail que j’ai acquises avec ISMA nourrissent ma pratique d’infirmier libéral et vice versa, ajoute-t-il. Le statut de libéral me donne une capacité à travailler seul, en toute autonomie, ce qui est intéressant pour les prises en charge. L’équilibre me convient. »
Une intervention sur les sportifs lors des rallyes raid et courses cyclistes

De son côté, l’entreprise organisatrice d’événements sportifs ASO fait appel à Mutuaide, une entreprise d’assistance, pour organiser le service médical de différents événements comme le Rallye Dakar ou le Tour de France.
Colette, infirmière anesthésiste (Iade), travaille depuis 2010 avec cette structure. « Cela m’intéressait de couvrir des événements sportifs et d’avoir l’opportunité de partir en France et à l’étranger », explique-t-elle.
Pour le rallye raid automobile, elle part généralement trois semaines avec une équipe médicale composée d’une cinquantaine de personnes : médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes, anesthésistes, chirurgiens, radiologues… C’est à peu près identique pour l’événement cycliste. « Dans les deux cas, mon rôle est similaire, je réalise des soins sur les sportifs. »
Pour le rallye automobile, les soins sont apportés pendant la course et à l’intérieur du bivouac sur les sportifs et sur les accompagnants comme les manutentionnaires, les carrossiers, les cuisiniers.
Pendant la course, c’est le poste de contrôle qui reçoit l’alerte et envoie les moyens nécessaires à la prise en charge de la personne, comme un hélicoptère ou un moyen terrestre.
« Avec notre équipement, nous pouvons effectuer des échographies ou encore des radiographies, souligne Colette. Nous avons cette logistique que les autres n’ont pas. » Les infirmiers travaillent généralement en binôme avec un médecin urgentiste ou anesthésiste dans les postes médicaux avancés. Si la blessure est grave, la personne est directement envoyée dans un hôpital répertorié en amont.
Pour la course cycliste, les sportifs disposent de leur propre équipe médicale pour toute intervention en dehors de la course. Mais pendant la course, c’est l’équipe de Mutuaide qui intervient, « pour des questions d’organisations, explique Colette. Il faut que ce soit fluide, régulé. L’ensemble de l’équipe médicale avance dans la course, dans la caravane et en cas de chute ou de besoin d’intervention, le chef médical décide de la procédure. »
« Notre intervention est parfois difficile en montagne, ajoute-t-elle, notamment lorsque les coureurs ont des sommets à gravir car le peloton se divise énormément. Mais nous sommes organisés avec nos radios pour connaître l’évolution de la course. »
Pourquoi cet engagement ? « Travailler pour ce type d’événement est très excitant, reconnaît Colette. C’est une vie complètement différente. Pour moi, ce sont des vacances psychologiques. Je décroche complètement de mon quotidien. Je n’ai pas de téléphone, je me retrouve dans un endroit que je ne connais pas et je vis le moment présent. C’est le plus grand bénéfice personnel que je puisse trouver. »
En plus, d’un événement à l’autre, les équipes se retrouvent. « Nous nous connaissons bien. Mais il faut être organisé et tout le monde doit être dans la même énergie. »

Yves Dia, Iade, intervient lui aussi avec Mutuaide depuis une quinzaine d’années. « Généralement, nous avons tous plus ou moins le même profil. Nous aimons l’urgence et souhaitons travailler hors des murs de l’hôpital. Avec ce type d’intervention, nous sommes dans un cadre qui est moins figé. C’est ce qui me plaît, avec en plus, le côté sportif et les paysages… », relate-t-il.
L’ambiance aussi est différente puisque le sportif blessé veut généralement repartir aussi vite que possible : « nous avons ainsi la pression de la course ». Autre avantage : l’esprit d’équipe. « C’est d’autant plus important, que les interventions sont intenses pendant toute la durée de l’événement sportif mais cela casse la routine, reconnaît Yves. C’est peut être aussi ce que nous recherchons. »
Des consultations à Rolland Garros
Frédérique intervient, quant à elle, lors du tournoi de Rolland Garros depuis 1997 avec une équipe d’une douzaine d’infirmiers. « Sur place, il y a deux infirmeries, une pour le public et une pour les sportifs », explique-t-elle.
Les infirmières sont employées par la Fédération française de tennis, en CDD de trois semaines, tous les ans. L’infirmerie est ouverte lors des qualifications, donc une semaine avant le début du tournoi. « Dans le cadre de Rolland Garros, nous sommes parées à l’urgence, mais notre travail principal consiste à faire de la consultation », explique-t-elle.
Les Ide accueillent les joueurs qui se présentent à l’infirmerie. Elles inscrivent leur identité, leur date de naissance, leur pays, la raison de la consultation et les médicaments prescrits par le médecin, sur un registre pour des questions de traçabilité en lien avec le dopage. Lorsque le sportif est pris en charge par le médecin, l’infirmière peut être sollicitée si des injections ou des pansements sont à effectuer. « Nous n’avons aucune autonomie par rapport au médecin », indique Frédérique.
L’infirmerie des sportifs est ouverte de 8 h à 22 h. Certains joueurs ont leur propre équipe médicale et ne viennent jamais à l’infirmerie. Pour les autres, « à cette période de l’année, ils sont nombreux à consulter pour un rhume des foins ou pour des problèmes d’allergies ou encore des gastroentérites, car d’un tournoi à l’autre, il peut y avoir des épidémies », rapporte Frédérique. Il peut aussi s’agir de consultations médicales de traumatologie, en cas d’entorses ou de fractures.
Pourquoi un tel engagement ? « Je suis fan de sport et de tennis et cette activité me permet de côtoyer des premiers joueurs mondiaux. Ils nous reconnaissent d’une année à l’autre, c’est un moment qui sort de l’ordinaire. »
Et d’ajouter : « c’est une médecine qui n’a rien à voir avec celle que je fais au quotidien puisque je m’occupe de patients en fin de vie. Rolland Garros me donne une bulle d’air. Mais il faut savoir faire la part des choses et se rappeler que nous intervenons sur des grands sportifs. Parfois, cela peut paraître aberrant de faire un scanner pour un petit doigt de pied. Mais il faut avoir conscience que c’est leur métier. Il faut rentrer dans le jeu ! »
Laure Martin

Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Le recrutement des infirmiers
Devenir infirmier sur des événements sportifs vous intéresse ? Le recrutement des différentes entreprises est précis. « Il faut savoir que nous ne sommes pas l’employeur principal des infirmiers, explique le Dr Olivier Ploix, directeur des opérations chez ISMA. Ces derniers ont quasi tous une autre activité professionnelle en parallèle. » ISMA couvre douze sites à l’année, dont Bercy (concerts, football, rugby, handball, basketball, boxe, catch, tennis, volley), des stades, des salles de spectacle et la Fédération française de football sur l’ensemble de la France.
Quels types d’infirmiers sont recrutés ? « Nous demandons une expérience en réanimation, en SMUR et/ou aux urgences, indique-t-il. Plus ils ont d’expérience mieux c’est, car nous travaillons dans le domaine de la médecine d’urgence. » Lorsque les infirmiers intègrent ISMA, ils travaillent un certain temps en binôme afin d’acquérir les méthodes de fonctionnement, avant de pouvoir intervenir seul.
Le recrutement exige un niveau de compétences élevées et, dès lors qu’ils sont embauchés, les recruteurs partent du principe que les soignants sont opérationnels. « Nous recevons trois à quatre demandes d’infirmiers par semaines et une demande de médecin par mois environ », rapporte le Dr Ploix.
Les candidats doivent avoir un certain état d’esprit et des compétences : autonomie, discernement, connaissances techniques, bon relationnel et savoir-vivre. « Malgré la sélection initiale par CV ou par recommandation, lorsque nous envisageons un recrutement, nous savons que nous n’avons qu’une chance sur trois de le réussir, souligne le Dr Ploix. Il y a une période d’essai que nous faisons démarrer à la première vacation, c’est un test pour eux comme pour nous. »
ISMA travaille avec 197 médecins et 93 infirmiers. « Ils travaillent sur volontariat, mais nous leur demandons de faire quatre interventions par an au minimum pour que cela ne soit pas un frein à leur exercice principal », indique le Dr Ploix.
Iade en priorité
Le Dr Florence Pommerie, directeur médical de Mutuaide Assistance, branche sport, recrute principalement des Iade pour intervenir sur les Rallyes raid Dakar, du Maroc, de la Route de la Soie, sur le Tour de France ou encore pour des compétitions de ski. « Quand nous médicalisons des événements sportifs, c’est pour des urgences, donc des accidents, indique-t-elle. Il nous faut des médecins et des infirmiers habitués à travailler en urgence, qui, sous couvert de protocoles, peuvent agir seuls, intuber, piquer. »
La meilleure formation ? Le SMUR car « les infirmiers ont alors l’habitude de travailler à l’extérieur, avec des ″spectateurs″». Le Dr Pommerie souhaite que les infirmiers soient débrouillards et sportifs car « nous sortons des sentiers battus, nous dormons dans des tentes ».
Il faut aussi aimer travailler en groupe, la vie en communauté, les voyages et parler l’anglais. « Certains postes sont par ailleurs réservés aux hommes car, lorsqu’il faut porter un motard ou un pilote de camion, je ne fais pas dans la parité, reconnaît le Dr Pommerie. Je mets les bonnes personnes aux bons endroits. » Le recrutement se fait beaucoup par cooptation et par candidatures spontanées. Lorsqu’elle constitue les équipes, elle garde toujours un pool d’anciens et varie de 20 % avec des nouveaux. Une formation a lieu en interne afin de permettre aux soignants d’appliquer les mêmes directives.
A Rolland Garros, c’est le médecin principal qui assure le recrutement. Au fur et à mesure que certains s’en vont d’autres viennent. « Mais nous sommes une vieille équipe avec pour certaines une présence depuis trente ans environ », explique Frédérique. Parmi les critères : connaître les règles du tennis, le déroulement d’un tournoi et parler anglais. L’équipe est composée d’une douzaine d’infirmières et de quatre à six médecins.
L.M



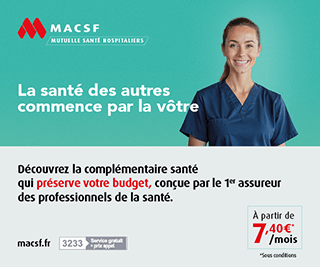







Vous devez être connecté pour poster un commentaire.