À l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon, le Centre de références des infections ostéoarticulaires complexes (CrioaC) traite des patients en impasse thérapeutique à l’aide de virus trouvés dans l’environnement.

« Vous êtes rôdé, souhaitez-vous d’autres explications ? » demande Koudedia Fall, infirmière, à Alexandre Vuitton. C’est la troisième semaine consécutive que ce patient de 51 ans fait la route depuis le Jura, où il vit. Il attend sourire aux lèvres que l’on vienne le chercher pour l’intervention qu’il doit subir. Comme chaque jeudi, c’est le branle-bas de combat dans cet hôpital de jour perché sur les hauteurs de Lyon. « Travailler ici est en général beaucoup plus calme qu’en hospitalisation : mais le jeudi, c’est la folie ! » rigole Irmine Achikpa, infirmière ici depuis dix ans. L’hôpital de la Croix-Rousse étant un centre de référence pour les infections ostéoarticulaires, l’établissement voit affluer les cas d’infections les plus complexes, qui pour une grande partie impliquent des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Or la journée du jeudi leur est réservée : l’équipe du Pr Ferry, l’infectiologue qui coordonne le centre, se réunit avec une équipe pluridisciplinaire pour imaginer la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Les différents médecins rendent ensuite visite à chaque patient. Parmi les options envisagées pour venir à bout de ces infections tenaces, figure un traitement encore balbutiant dont le service est pionnier en France : la phagothérapie, fondée sur les bactériophages, ces virus naturels qui ne s’attaquent qu’aux bactéries.
C’est de ce protocole que bénéficie Alexandre Vuitton depuis plusieurs semaines : aujourd’hui, il va recevoir sa dernière injection, en espérant que les phages éradiquent ou du moins endiguent durablement le staphylocoque doré qui a colonisé son genou. Comme souvent dans ces situations, la bactérie s’est développée autour d’une prothèse, posée en 1996 : alors âgé de 24 ans, il échappe de peu à l’amputation à la suite d’un ostéosarcome. Sa vie suit son cours, jusqu’à fin 2022 : en rejoignant la salle de bain depuis son lit, une violente douleur dans le genou le saisit. Alors installé au Vietnam depuis douze ans, il est rapatrié en urgence après avoir frôlé la mort, selon ses termes. « Tous mes organes lâchaient les uns après les autres ». S’enchaînent alors lavements chirurgicaux et traitements antibiotiques : l’infection recule avant de récidiver le 20 décembre 2023, « un an jour pour jour après la première crise ».
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Impasse thérapeutique

Aux Hospices civils de Lyon, Tristan Ferry lui propose alors de tenter la phagothérapie, que l’hôpital pratique au compte-goutte depuis presque dix ans : le traitement n’étant pas encore autorisé en France, il n’est prodigué que dans des cas d’impasse thérapeutique et de façon très encadrée. « Ce sont des patients qui ont parfois le moral dans les chaussettes, sous antibiotiques depuis des années, donc ils fondent forcément beaucoup d’espoir dans le traitement », constate Irmine Achikpa. « Il faut parfois leur réexpliquer le fonctionnement du traitement. Même si le Pr Ferry prend beaucoup de temps pour le faire, c’est beaucoup d’informations et je leur conseille souvent de venir avec un proche qui puisse être témoin des échanges ! » Pour l’infectiologue, ce rôle d’interface que jouent les infirmiers « est indispensable pour faire remonter les questionnements et inquiétudes » qui entourent ce type de traitement méconnu.
Pourtant, la phagothérapie n’est pas nouvelle : elle est découverte depuis plus d’un siècle ! Pour le comprendre, il faut revenir en 1917 : les antibiotiques n’existent pas encore et le Français Félix d’Hérelle, biologiste à l’Institut Pasteur, s’aperçoit que certains virus présents dans l’environnement – les lacs, les égouts… – ont la capacité de tuer des bactéries.
« Ces phages, dits lytiques, reconnaissent certaines bactéries, y introduisent leur patrimoine génétique, s’y multiplient et produisent une enzyme, la lysine, qui fait exploser la bactérie, explique le Pr Ferry, féru du sujet. Les centaines de nouveaux phages libérés vont infecter les bactéries voisines. » Quelques années plus tard, en 1928, la pénicilline est découverte : c’est la ruée vers les antibiotiques et leur production, que l’Europe de l’Ouest investit massivement dans le cadre de l’effort de guerre. La phagothérapie, plus longue à développer, est laissée de côté. Seul l’est de l’Europe continue de l’utiliser : en Géorgie, l’institut Eliava, dédié à la phagothérapie, subsiste encore à ce jour et des phages sont vendus dans toutes les pharmacies du pays. L’histoire raconte même que ces virus auraient donné l’avantage dans la Bataille de Stalingrad aux Russes, qui ont pu grâce aux phages combattre l’épidémie de choléra, contrairement aux Allemands.

Aujourd’hui, le regain d’intérêt s’explique par l’urgence de trouver des solutions à la vague d’antibiorésistance qui s’abat peu à peu sur l’Europe et engendrera, selon les prévisions de l’OMS, « davantage de morts que le cancer en 2050 ». Un « tsunami à vitesse lente », pour le Pr Ferry, qu’il voit progresser depuis qu’il a pris la tête du CrioaC il y a dix ans. « Dans notre unité d’hospitalisation, la moitié des patients souffrent d’infections dues à des bactéries multi-résistantes » constate-t-il. En cause, « la mondialisation des échanges, les voyages, l’industrie », qui facilitent la migration de ces bactéries dont le patrimoine génétique s’est adapté. Dans une Europe vieillissante, elles trouvent au sein de nos populations des hôtes favorables à leur développement : la pose d’implants et de prothèses pour accompagner le prolongement de l’espérance de vie facilite l’introduction des bactéries.
Avance à tâtons

Voyant son impuissance face à ces cas délicats et connaissant le principe de la phagothérapie, Tristan Ferry se tourne en 2014 vers Phaxiam, alors Pherecydes Pharma, la seule start-up en France et l’une des seules au monde à développer des phages. « Peu se lancent sur le marché, car les phages étant collectés dans le vivant, on ne peut pas les breveter comme n’importe quel médicament : seule la méthode de purification peut l’être ». Un partenariat se noue et l’industriel commence à fournir en phages l’hôpital – selon les phages et les cas, la procédure diffère : elle s’inscrit soit dans un cadre d’autorisation d’accès compassionnel (AAC), validé par l’ANSM et remboursé, soit hors AAC où le traitement est délivré gracieusement, soit dans le cadre d’un essai clinique mené avec Phaxiam (en phase II). Lorsqu’aucun de leurs phages ne convient, le Pr Ferry en cherche ailleurs – en Belgique, ou aux États- Unis, par exemple.
Les virus, doivent être parfois, selon leur provenance, contrôlés en amont « pour vérifier les endotoxines qui pourraient donner de la fièvre au patient en cas de purification insuffisante », explique le Dr Briot, pharmacien hospitalier. Le matin de leur administration, ils sont préparés à la pharmacie : en général injectés en cocktail de deux ou trois phages, ils sont mélangés et dilués dans du chlorure de sodium, « puis amenés et injectés directement, précise Sylvie Perret, infirmière, sauf le weekend où on les conserve trois jours maximum au frigo », à 4 °C. Dans cet hôpital de jour, les injections se font souvent sous échographie, en salle de radiologie : ce matin, c’est le Dr Jade Miailhes qui se charge de l’intervention de M. Vuitton. « On voit à son arrivée avec le patient s’il souhaite que le médecin lui propose une prémédication, du type antalgique car ce peut être très douloureux ». C’est ce qu’a demandé ce monsieur de 51 ans, après avoir beaucoup souffert lors de son premier traitement.

En une dizaine de minutes, la radiologue réalise une ponction pour analyser le liquide présent dans l’épanchement, et injecte le précieux mélange. Selon le mode d’administration, le geste peut être réalisé par les infirmiers. « Cela arrive en médecine conventionnelle, précise Sylvie Perret. Lorsque je travaillais en hospitalisation, j’ai parfois réalisé des aérosols de phages pour une personne atteinte d’une grave infection pulmonaire. Nous nous chargeons aussi des injections intraveineuses, qui se font sur plusieurs jours consécutifs ». C’est ce qu’a subi M. B, qui souffre d’une infection récalcitrante à pseudomonas, aujourd’hui en visite de contrôle. « La cicatrice est belle, mais il est encore un peu tôt pour savoir si les petites bestioles ont fait effet », dit le Pr Ferry à cet ex-agriculteur de 76 ans.
À la suite du traitement en effet, les patients reviennent régulièrement pour effectuer des contrôles et évaluer l’évolution de l’infection : « ils sont souvent intégrés à des protocoles de recherche, donc les médecins ont besoin d’autres informations, on doit parfois remplir jusqu’à dix tubes supplémentaires en prise de sang ! », poursuit Sylvie Perret. « Et nous surveillons aussi le pansement et sa coloration ». Car nombre d’inconnues demeurent autour de la phagothérapie : dosage, mode d’administration, antibiotiques associés… « C’est encore empirique » explique le Pr Ferry. D’autant que « l’avenir du phage dans l’organisme reste un mystère », ajoute le Dr Briot. « À l’inverse d’autres médicaments qui voient leur présence diminuer dans le corps au fil du temps, la phagothérapie fonctionne grâce à l’autoréplication du virus ». En 2022, 70 % des patients traités par phagothérapie dans le service ont connu une amélioration de leur état. « Nous avons bon espoir que ces promesses se confirment », conclut Sylvie Perret.
Nolwenn JAUMOUILLE
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |


 Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).
Cet article a été publié dans le n°53 d’ActuSoins magazine (juin 2024).






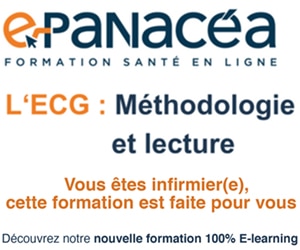
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.