La schizophrénie porte en elle « le germe de la peur sociale », puisque le diagnostic « véhicule encore l’image d’une maladie incurable », facteur d’exclusion sociale, reliée à une « peur ancestrale du fou dangereux ». L’historien Hervé Guillemain, spécialiste de l’histoire des maladies mentales, tempère ces préjugés, car nombre de personnes mènent une vie satisfaisante », en vivant avec les troubles avec ou sans traitement…. »
Sans traitement ? En effet, « le modèle biomédical bien défini n’est plus très opérationnel quand on parle de santé mentale ». C’était précisément l’objet du débat : remettre en question la pertinence de la classification des maladies mentales, avec l’exemple de la schizophrénie.
Lorsqu’il se lance dans son projet de livre, « Schizophrènes du XXe siècle (éd. Alma) en 2010, Hervé Guillemin souhaite revenir aux racines et « aux effets des représentations » de la schizophrénie. Résultat : l’histoire du XXIe siècle est encore « redevable » d’une histoire qui débute à la fin du XIXe siècle, notamment avec une réponse institutionnelle inadaptée apportée à la maladie. Les débats sur la pertinence d’une classification précise existaient déjà à l’époque. A travers cinq dates, Hervé Guillemain revient sur la teneur des discussions, encore très actuelles.
Représentations et classifications
Dans les années 30, les patients souffrant de schizophrénie sont diagnostiqués « déments précoces », et perçus comme des malades incurables. La première classification mentale à vocation statistique aura lieu pendant la Seconde Guerre Mondiale. En attendant, d’intenses débats ont lieu en 1904, lors du Congrès de psychiatrie de Pau, dans un contexte où la psychiatrie européenne tente d’acquérir le statut de science en essayant de définir les pathologies mentales. Pour certains psychiatres, l’évaluation de la schizophrénie relève davantage de la « définition littéraire que scientifique ».
Mais dans la plupart des cas, la maladie se rattache au destin le plus sombre, « enfermant les patients dans des tragédies personnelles ». Dans leurs diagnostics, certains médecins hésitaient entre mélancolie et démence précoce, avec des conséquences immenses : le premier état était passager, l’autre incurable, favorisant un traitement institutionnel inadéquat. Dans ce contexte « classer les troubles mentaux aidait la profession à devenir scientifique, mais représentait une entrave pour les patients », conclut-il.
En 1923, les nouveaux manuels apprennent aux étudiants en médecine à reconnaître la schizophrénie, mais en lui attachant des images stéréotypées qui véhiculent une image artificielle du corps du malade. Les sujets sont perçus comme des « simulateurs ». D’un diagnostic « flou » dans les années 1870, l’on passe, dans les études cliniques de Bénédict Morel, à une maladie « pure », la démence précoce catatonique, qu’on commence à appeler schizophrénie. « L’on perd alors la richesse des individualités, mais cela est plus rassurant et facile pour les jeunes psychiatres », estime Hervé Guillemain.
C’est ce que subira précisément Agata, une jeune femme origine d’Europe de l’Est, cas sur lequel s’est penché Hervé Guillemain. Diagnostiquée schizophrène à 40 ans, elle subira le contrecoup d’une définition « pure » de sa maladie et sera transférée du jour au lendemain en Haute Saône, dans l’asile de Saint-Rémy, loin de la vie qu’elle s’était évertuée à se construire.
Derrière, une façon aux autorités administratives de mieux gérer les flux de patients (dont beaucoup de patientes) et de « se délester d’une population devenue trop nombreuse ». Car si la schizophrénie est alors perçue comme universelle, les archives révèlent une autre histoire : majoritairement des femmes, immigrées, exploitées. Il s’agissait « d’administrer la folie à moindres frais. »
L’arrivée de traitements
Trente ans plus tard, en 1968, la psychiatrie s’est dotée de traitements médicamenteux ou nécessite le recours à la malariathérapie (traitement par la fièvre). La psychochirurgie existe depuis les années 40. Mais devant la relative non efficacité des thérapies, les autorités médicales les ont redéfinis comme des « résistants aux traitements »…
En plus d’autres « résistances » à l’Armée, au travail ou à leur famille (en cas de conflit ou d’opposition marquée aux institutions). Les neuroleptiques sont désormais donnés par le biais d’injection-retard, « meilleur moyen » de gérer des patients soit-disant passés maîtres de l’évacuation des traitements. Mais les voix dissonantes contre ces camisoles chimiques se font entendre, les effets secondaires, terribles, empêchent les patients, sortis des institutions, de reprendre le travail, et donc une vie « normale ». La première association de patient se charge d’éplucher les ordonnances (effets secondaires et médicaments correctifs des effets secondaires) et donne enfin la parole aux malades.
1976 marquera les premières remises en question de la classification mentale de la schizophrénie, perçue désormais plutôt comme une « identité personnelle ». Car il apparaît que les classifications des maladies mentales ne se font pas sans conséquences sur la vie réelle des malades.
Eviter les étiquettes
A travers ces dates-clés, Hervé Guillemain se demande donc comment « éviter les étiquettes » qui assignent les patients. La prise de parole des malades a posé l’un des premiers éléments d’une refondation de la schizophrénie.
Cette vision historique critique de la définition de la schizophrénie a été confirmée par la psychiatre Déborah Sebbane, praticien hospitalier au CHU de Lille, docteure en santé publique et vice-présidente du CCOMS (centre collaborateur de l’OMS), qui mène une réflexion depuis des années sur la nécessité de renommer la schizophrénie… et de la reclassifier ?
Si depuis la première définition clinique émise par Eugen Bleuler en 1908, évoque « une rupture au sein du fonctionnement psychique comme un invariant » de la maladie, avec une dimension symptomatique, un impact sur le fonctionnement de la personne (évaluation cognitive, handicaps…), il n’existe aujourd’hui « aucune prise en compte du statut socio-économique ou sur la qualité de vie », précise Déborah Sebbane.
La psychiatre pose donc la question de la …ou des schizophrénie(s) ? Compte tenu « de la grande variabilité inter et intra-individuelle, la grande hétérogénéité et des modifications se produisant au cours du temps », le pluriel semble faire de plus en plus consensus.
Concernant la classification, deux grands systèmes existent, le CIM (classement international des maladies) dans une perspective très internationale, avec volonté d’influence le système public en santé mentale. Impliquant les usagers mais aussi les aidants, sa vision est très démocratique. De l’autre côté, le DSM est une boîte à outils, utilisant un langage commun entre professionnels, et parle désormais « du trouble du spectre de la schizophrénie ».
La classification du diagnostic dépend de trois critères indispensables : fiabilité (est-il reproductible?), validité (le diagnostic doit s’adosser à une méthode scientifique collant le plus près possible au phénomène observé) et utilité (afin d’être davantage plus centré sur l’utilisateur, et qu’il soit pertinent pour le personnel et l’usager)
Pour la schizophrénie, « les frontières sont très poreuses », puisqu’il « n’existe pas de validité, de traitement, de cause, d’évolution propres à la schizophrénie », a précisé la psychiatre. D’où la nécessité du lancement d’un processus de révision participative à l’initiative du CIM-CCOMS.
Le monde assiste à la mort lente de la définition « classique » de la schizophrénie, comme en est persuadé le psychiatre hollandais Jim van Os. Remise en question dans sa définition dès 1979, la schizophrénie cherche à s’humaniser en passant par un diagnostic « transparent, collaboratif et informatif » : il doit être utile au rétablissement du patient, correspondre au vécu et à l’expérience du patient, permettre l’empowerment des patients… En somme, il s’agit de changer le regard sur la schizophrénie et de sortir d’une vision « incurable » venue tout droit du XXe siècle.
Delphine Bauer
Lire aussi sur ActuSoins.com :
Classification des maladies mentales : le DSM remis en question (2011)
31e édition du prix Prescrire : la dignité comme fil rouge (octobre 2016)
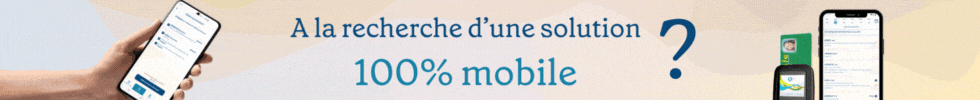














Vous devez être connecté pour poster un commentaire.