
Certes, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a fourni d‘“incontestables progrès” mais plusieurs points d’amélioration s’avèrent encore indispensables, aux yeux de la Cour. A commencer par le dispositif d’hospitalisation, comme l’atteste le faible usage des capacités en lits somatiques.
Autre point noir : le caractère incomplet de l’offre psychiatrique alors qu’« au moins un trouble psychiatrique » est identifié chez huit détenus sur dix et que le taux de schizophrènes serait quatre fois plus important qu’à l’extérieur, selon la dernière étude disponible, qui remonte à 2003.
La Cour pointe globalement le manque de coordination entre unités sécurisées et unités sanitaires, le flou persistant sur la vocation de l’Établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF, Val-de-Marne), ainsi que les retards pris dans le programme de construction d’Unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Sans omettre une offre de soins ambulatoires hétérogène, “une démarche de santé trop souvent dépendante du fonctionnement pénitentiaire”, etc.
Même si les équipes sanitaires ont presque doublé entre 1997 et 2012, il reste difficile de recruter des personnels soignants en prison, dans des locaux souvent délabrés. Les places d’hospitalisation réservées aux détenus restent faibles (182 lits pour 77 883 détenus), surtout en psychiatrie, et la situation des handicapés en détention est « préoccupante ».
La Cour des comptes demande que a médecine carcérale soit clairement identifiée dans la prochaine loi de santé attendue cet été. Elle préconise un renforcement de l’offre psychiatrique, la généralisation des protocoles cadres équipes médicales/administration pénitentiaire, l’accroissement du rôle des ARS par la généralisation effective des commissions régionales santé/justice. Enfin, elle préconise d’étudier l’inclusion des soins aux détenus dans le champ de la Couverture maladie universelle (CMU) et de sa protection complémentaire (CMUC).
Par ailleurs, la Cour des Comptes s’en prend à la gestion des partenariats public-privé, une option choisie pour 18 hôpitaux ( 24 projets et 613 millions d’euros). Le constat est sans ambage : des procédures engagées dans la “précipitation“, sur des projets disparates sans que les outils juridiques d’accompagnement et de pilotage soient disponibles; des avantages mal exploités avec “un dialogue souvent déséquilibré au profit du preneur“.
Rédaction ActuSoins, avec Hospimedia
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus |
|
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus |
|




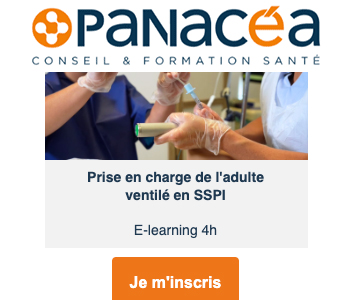



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.