Les infirmières ne comptent que 5 % de syndiquées dans leur rang. Un désintérêt aux multiples explications et aux conséquences non-négligeables.

Pour les infirmières, combat ne rime pas avec syndicat. Depuis quelques années, leur taux de syndicalisation stagne autour de 5 %. Un pourcentage égal à celui des salariés du privé, mais trois fois moins élevé que celui des salariés de la fonction publique.
Une absence de culture militante
Face à ce manque d’engagement, les syndicats se révèlent perplexes. «Venant d’une profession impliquante, c’est incompréhensible. Ce n’est pas lié à la féminité du métier. Dans d’autres secteurs féminins, les taux de syndicalisation sont beaucoup plus élevés. C’est notamment le cas pour les aides-soignantes syndiquées à 30 % ! Les infirmières, elles, sont dans une attitude consumériste vis-à-vis des syndicats. Nous avons des adhérentes mais très peu de militantes», raconte Thierry Amouroux, président du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI).
«Ce n’est pas dans la culture infirmière de revendiquer. Les infirmières sont peut-être davantage habituées à prendre soin des autres que d’elles-mêmes. La connotation politique peut également les gêner», avance Nathalie Depoire, présidente de la Coordination Nationale Infirmière (CNI). Sentiment que les syndicats sont obsolètes, incapables de comprendre les vrais besoins des salariés, individualisation de la société… peuvent aussi expliquer cette désaffection.
Des syndicats en ordre dispersé
La mésentente des syndicats entre eux n’arrangent pas les choses. Deux grandes familles s’opposent. D’un côté se trouvent les syndicats – CGT, CFDT, FO, CFTC, SUD, UNSA – qui organisent la défense des travailleurs par branche d’activité. De l’autre campent les syndicats corporatistes – CNI et SNPI pour l’essentiel – qui limitent leur champ d’action au seul secteur des infirmières.
«Nous défendons l’intérêt général. Les problématiques comme les conditions de travail ou la non-reconnaissance concernent tous les métiers de l’hôpital. Notre regard est transversal. Il n’y a pas le problème des infirmières, il y a le problème des hôpitaux», explique Nathalie Cagneux, secrétaire générale de la Fédération Santé-Sociaux de la CFDT.
Mais si les infirmières ne l’entendent pas de cette oreille, comment alors les motiver à s’engager ? «C’est une vraie question, reconnaît la responsable de la CFDT. Aujourd’hui, nous ne répondons pas à leur demande. Et même si nous n’avons aucune valeur qui nous amène vers l’intérêt catégoriel, nous nous interrogeons sur comment répondre davantage à leur identité professionnelle».
Une question que les syndicats corporatistes ne se posent pas. Le SNPI le clame : «il n’est pas normal de laisser des agents exerçants d’autres métiers parler au nom des infirmières.»
Alors, quand les deux familles se rencontrent, l’ambiance n’est pas vraiment à l’union. «Dans les salles de négociation, on nous reproche notre corporatisme. Mais les centrales, elles, s’intéressent davantage à leurs adhérents», regrette Thierry Amouroux.
Même son de cloche à la CNI. «Bien sûr, nous sommes critiqués. Mais je suis fière d’être corporatiste. A vouloir défendre tout le monde, on ne défend personne. On parle bien de ce qu’on connaît bien. Par exemple, les centrales n’avaient pas travaillé en amont sur le droit d’option. Pendant cette période, même les DRH nous envoyaient des infirmières en recherche d’informations. Mais comme nous donnons des renseignements sans imposer d’adhésion, contrairement à d’autres, cela ne nous a pas ramené d’adhérents», déclare Nathalie Depoire.
Le prix à payer pour les non-syndiquées
Reste que les syndicats s’accordent sur les conséquences de ce faible taux de syndicalisation. Revalorisation salariale a minima, reconnaissance en berne, conditions de travail dégradées… en seraient le prix à payer. «Les infirmières sont passées à côté de quelque chose. Il n’y a eu aucune réelle augmentation de salaire depuis 1988. Elles n’ont obtenu qu’une poignée d’euros avec le passage en catégorie A. Les aides-soignantes, mieux syndiquées, sont mieux défendues. Leur métier a beaucoup progressé», estime Thierry Amouroux.
Pour la présidente de la CNI : «Les autorités en profitent car elles savent que les blouses blanches ne se mobilisent pas. Avec le passage en catégorie A et le recul de l’âge de la retraite, elles ont fait payer aux infirmières leur propre augmentation !»
La CFDT enfonce le clou. «Les infirmières sont un peu transparentes. Et les autorités, considérant que les organisations syndicales sont insuffisamment représentatives, ont créé une autre forme de représentation : l’Ordre infirmier. Mais, contrairement aux syndicats, l’Ordre n’a pas pour but de défendre l’intérêt des infirmières», expose Nathalie Cagneux.
Pour une fois, le mot d’ordre des syndicats est à l’unisson : le salut de la profession passera par la mobilisation.
Sondage
[poll id=”3″]
Judith Korber




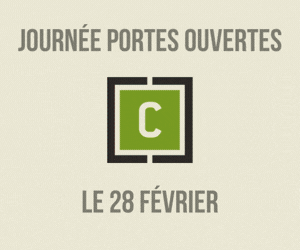




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.