
« Après des années à l’hôpital, je n’avais plus envie de faire de soins techniques. » Sylvie Maillochaud, 50 ans, diplômée en 1991, a exercé de nombreuses années, notamment en réanimation pédiatrique, en néonatologie, au planning familial… mais elle a finalement pris le tournant de la recherche et mis en place le poste d’infirmière de recherche clinique (IRC) du centre hospitalier Henri Laborit, à Poitiers, en psychiatrie.
Pour ce faire, elle a suivi une formation spécifique (voir encadré ci-dessous). Car s’il est clair que l’infirmière a un rôle clé à jouer en recherche clinique, elle doit nécessairement mettre à jour ses connaissances sur les questions bioéthiques, réglementaires, protocolaires, scientifiques…, liées à la recherche, peu d’informations étant délivrées à en formation initiale.
Vanessa Pibiri, cheveux courts à la Jean Seberg, nous accueille avec un grand sourire, avec à ses côtés Carole Mardesson. Toutes deux exercent à l’institut Curie, respectivement comme principale des IRC infirmières de recherche clinique pour l’équipe transversale et comme IRC au sein du Département d’essais clinique précoces et d’innovation. La première travaille en transversalité, sur le recueil d’informations sans thérapeutique, le remplissage de cahiers électroniques, la reprise d’informations, l’administration des traitements…. La seconde, accréditée pour travailler sur les premières phases de test (phases I), réalise beaucoup de missions de soins.
Najet Belghali exerce, elle, au Centre d’investigation clinique de Lyon (CIC), implanté dans le CHU. Avant de devenir IRC, elle a exercé vingt-cinq ans à l’hôpital de jour en chirurgie cardiaque. Une rencontre avec le professeur du CIC l’a mise au parfum de ce qui se faisait dans leurs murs. « C’est une petite structure, avec dix attachés de recherche clinique (ARC) qui ne sont pas des soignants, mais qui collaborent avec les investigateurs », explique-t-elle. L’expertise d’une infirmière était donc nécessaire. Après s’être formée au diplôme universitaire FARC (Formation des ARC) à Paris, Najet Belghali débute comme infirmière de recherche clinique au CIC, en 2009, enthousiasmée par la « dimension innovation en cardiologie, très enrichissante.»
Autant de facettes pour un métier polymorphe mais aussi un point commun : faire le lien entre les promoteurs d’une étude – des laboratoires privés mais aussi des promoteurs issus de la recherche publique – et les patients, avec un seul credo : la rigueur scientifique au service du progrès biomédical.
Combattre les clichés associés à la recherche

« La recherche au sein de la psychiatrie n’a pas bonne presse, encore aujourd’hui », reconnaît Sylvie Maillochaud, évoquant la fausse impression que les patients ont d’être encore considérés comme des cobayes. Il existe donc un gros travail de pédagogie à réaliser auprès des patients et de leurs familles, mais également auprès du personnel médical et paramédical. Les patients peuvent ressentir de l’appréhension, à cause de scandales passés. Récemment, la mort à Rennes d’un homme lors d’un essai clinique de phase I [en 2016] a marqué les esprits.
Mais Arnaud Vaumousse, en charge du département « home & site trial support » chez Euraxi Pharma, une entreprise spécialisée en accompagnement de projets dans le secteur de la santé, dont la réalisation d’essais cliniques, se veut très rassurant. D’abord, en France, la recherche est très réglementée, (voir encadré). Par ailleurs, des patients peuvent se montrer très enthousiastes, lorsqu’un un médecin leur propose de rentrer dans un protocole, notamment pour des maladies rares et la recherche de potentiels traitements novateurs.
« Les parents des enfants malades sont très demandeurs », souligne Arnaud Vaumousse. Ainsi, certains perçoivent les études comme une véritable opportunité thérapeutique. C’est aussi le cas en psychiatrie où un patient est inclus « quand toutes les options de médecine de ville ont été épuisées, la plupart du temps. Il faut présenter l’étude de façon positive, être rassurante, transparente et identifier les bonnes personnes à inclure », indique Sylvie Maillochaud.
« En psychiatrie, détaille-t-elle, il s’agit de techniques innovantes comme la stimulation cérébrale transcrânienne, dans le cas des addictions, des dépressions, des TOC… En revanche, nous réalisons assez peu de protocoles médicamenteux, car il a peu de recherches, contrairement au cancer. » Grande cause nationale, au coeur de plusieurs plans successifs, le cancer utilise en effet 45 % des sommes issues du secteur privé.
Protocoles de la dernière chance

Carole Mardesson, de l’institut Curie, le constate au quotidien : même médiatisé, le cancer effraie les malades ; il faut les rassurer. « En phase I, et même en phase II et III, les patients présentent la maladie à un stade avancé. Ils arrivent en pensant qu’intégrer un protocole représente leur dernière chance. On leur explique qu’ils ne vont pas guérir, mais ils qu’ils vont vivre avec leur maladie. » L’institut, reconnu internationalement, est labellisé pour permettre des first-in-man, c’est-à-dire des premières administrations à l’homme d’une molécule, « ce qui est assez rare », précise-t-elle.
Depuis son arrivée il y a plus de quatre ans, elle a participé à deux de ces types d’essai.
Le point commun de leurs patients ? D’une voix unanime, les infirmières de recherche clinique interrogées avancent qu’il existe toujours, de façon sous-jacente, un engagement qui les dépasse. Les malades se disent que si, eux, ne bénéficient pas directement des avancées, les prochains profiteront des avancées permises grâce à leur implication dans un protocole. « Même s’ils ont signé un consentement éclairé, les patients peuvent sortir quand ils le veulent ! » précise Vanessa Pibiri.
L’essentiel, rappelle-t-elle, étant que « les bénéfices soient supérieurs aux risques ». Ainsi, les patients sont au coeur des préoccupations des Infirmières de Recherche Clinique. « Nous devons faire au mieux, pour le bien-être du patient », résume Christine Acker, infirmière salariée chez Euraxi Pharma, dans un contexte où les associations de patients deviennent de plus en plus expertes. « Il faut faire du patient un acteur de sa santé », précise Arnaud Vaumousse.
Plus de relationnel et de la rigueur

Le credo de Vanessa Pibiri ? « De la rigueur et de l’adaptabilité. En recherche, il faut faire tout ce qui est écrit, et écrire tout ce qui est fait », afin d’assurer la traçabilité de tous les actes. « C’est cela qui va intéresser les investigateurs », afin d’estimer au mieux l’efficacité de leur molécule et son éventuelle toxicité. D’où l’importance de prises de données vitales et de la pharmacinétique qui concerne l’étude du devenir des médicaments dans le corps.
Parfois les prélèvements doivent être réalisés à des horaires très précis. C’est, en effet, grâce au travail réalisé en phase I que l’équipe va « mieux comprendre la cinétique, la galénique du médicament, sa demi-vie dans l’organisme, le résiduel, et avec quoi il se mélange ou pas, ce qui le potentialise ou l’inhibe », explique-t-elle.
Mais derrière les chiffres, le relationnel, est au cœur du travail des IRC infirmières de recherche clinique. « Les gestes techniques restent très légers », souligne Sylvie Maillochaud. Prélèvements sanguins, tests urinaires, prise des constantes font certes partie de son quotidien mais, assurer le relationnel avec les patients arrive loin devant.
Il y a également toute une partie administrative et réglementaire. « Nous menons des études sur le long cours, raconte-t-elle. Les protocoles peuvent durer plusieurs années. Il y a plus qu’une confiance qui se créée avec les patients. C’est de l’empathie ». Pour les patients, être suivis dans la durée par la même infirmière est un gage rassurant : « ils me connaissent, je suis leur interlocutrice privilégiée ».
A l’institut Curie, les patients sont informés de l’engagement que suppose l’inclusion dans un protocole. « Quand on explique les raisons des contraintes, on gagne leur adhésion », expliquent les deux infirmières, convaincues des bienfaits du dialogue. « Nous travaillons beaucoup sur la collaboration. Dans une des études, nous sommes en train de recueillir les effets secondaires gynécologiques. Et nous savons combien les médicaments peuvent en avoir. Je suis assez fière de me dire que je prends soin des femmes. Cela m’anime », détaille Vanessa Pibiri.
Etre IRC infirmière de recherche clinique, c’est aussi travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires. « En fonction du protocole, nous sommes amenés à travailler en étroite collaboration avec des médecins investigateurs dédiés à une spécialité, des techniciens d’essais cliniques, en charge de collecter les données et de remplir la base de données, en assurant une qualité et en veillant au respect de la règlementation, ainsi que les secrétaires chargées des rendez-vous », explique Najet Belghali. Ce que confirme Carole Mardesson, estimant que cela « est primordial pour optimiser la prise en charge des patients. » C’est une équipe complète, prête à réaliser les études cliniques de A à Z de la chaîne.
IRC Infirmières de recherche clinique, aussi en libéral

Arnaud Vaumousse nous fait faire un tour d’Euraxi Pharma, basée à Joué-les-Tours et située dans des bâtiments sobres remplis d’ordinateurs. Le gros des clients d’Euraxi-Pharma est formé de médecins qui veulent mettre en place des essais cliniques et d’entreprises de l’industrie pharmaceutique.
Si, au siège, se trouvent les services support, tout ce qui concerne la gestion des projets, la biométrie pour la gestion et l’analyse des données et le medical writing (rédaction des rapports d’étude clinique avant de les soumettre aux sponsors et aux autorités de santé), les IRC infirmières de recherche clinique, sont, elles, « home-based ».
Elles interviennent en centre de recherche ou en libéral et font de la recherche clinique ambulatoire, directement au domicile des patients, après formation. Une pratique encore rare en France mais qui a fait ses preuves outre-Atlantique.
Dans ce cas, le laboratoire qui sponsorise l’étude fait appel, par l’intermédiaire d’une structure organisée, à du personnel libéral. Euraxi Pharma compte un réseau de 70 à 100 Infirmières libérales (idels). Cela a une pertinence particulière dans le cas des maladies rares – leur coeur de cible à 80 % – comme certaines maladies pneumologiques, pathologies osseuses, maladies rénales ou encore le cancer du foie ou du pancréas.
« Dans les protocoles lourds et avec de nombreuses visites, jusqu’à 80 % des patients peuvent sortir du protocole pour des raisons logistiques, contre seulement 5 % avec le support de la recherche clinique ambulatoire », s’enthousiasme Arnaud Vaumousse. Pour ces idels, les missions sont variées : réservation des médicaments, transport, prélèvement, gestion du le lien entre le projet au quotidien et le centre investigateur… Elles sont disponibles à la moindre question du patient. Avec cette organisation, le patient et le projet sont gagnants : « si le patient part en vacances, grâce à notre réseau, nous allons trouver une autre infirmière dans son lieu de vacation », afin de ne pas interrompre le protocole.
Une expérience enrichissante
« Ce travail est très gratifiant, affirme Séverine Venel, IRC chez Euroxia depuis deux ans et demi. Quand on constate une amélioration chez le patient, on se dit que tout le travail fourni a servi à quelque chose. » Elle évoque notamment les enfants souffrant d’ostéosynthèse, qui, grâce à leur suivi en ambulatoire pendant trois ans, à raison d’une injection quotidienne, ont pu retrouvé une vie scolaire et sportive grâce à l’amélioration de leur mobilité et de leur autonomie. « C’est une source de fierté, car dans ces cas-là, il n’y a pas de jour férié ou de samedi-dimanche. C’est un investissement de tous les jours ! », ajoute-t-elle.
Même satisfaction chez Sylvie Maillochaud : « j’ai tendance à me réjouir pour les patients qui vont mieux. Mais les psychiatres me rappellent toujours à l’ordre : c’est du temporaire. La psychiatrie, ce n’est pas du somatique, on n’en guérit pas. Il ne faut pas oublier que les rechutes, ça existe ». En cardiologie, Najet Belghali « apprécie de contribuer, à [s]on niveau, au développement de médicaments qui pourraient traiter et changer la vie des patients, en participant à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ». Et la recherche sur les traitements et dispositifs interventionnels avance très vite en cardiologie.
Ce n’est pas Christine Acker qui dirait le contraire. Cette IRC strasbourgeoise cite cette anecdote : « j’ai travaillé sur une étude concernant un anticoagulant pendant des années… Et aujourd’hui, ma mère en prend ! La recherche, c’est du concret. » Cerise sur le gâteau : quand l’étude a été publiée, le médecin investigateur a noté l’ensemble des noms des infirmières de recherche, ces « petites mains » qui disparaissent souvent lors de la restitution des résultats. Une source de reconnaissance supplémentaire.
Delphine Bauer
Recherche : comment ça marche ?
En France (chiffres de 2011), la recherche est majoritairement financée par le secteur privé, à 69 % par les laboratoires pharmaceutiques, les promoteurs publics représantant les 31% restants. Selon la loi Huriet qui réglemente la recherche clinique, un promoteur est une personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain. Il doit soumettre son protocole aux autorités de santé compétentes (ANSM) pour les aspects réglementaires, au CPP (Comité de protection des personnes) pour les questions éthiques et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) si la recherche implique la constitution de données personnelles. Il assure le bon déroulé de l’essai clinique et rapporte aux autorités les éventuels événements indésirables graves.
Les études cliniques se déclinent en plusieurs phases : la phase I dure plusieurs mois, inclut peu de patients (entre 20 et 100) et vise surtout à étudier la tolérance du médicament. La phase II inclut davantage de patients (jusqu’à 100), dure également plusieurs mois et a pour but de confirmer l’activité préliminaire et pharmacologique à la dose recommandée à l’issue de la phase I. La phase III permet de comparer le nouveau médicament à un traitement standard, et peut inclure de 100 à plusieurs milliers de patients. En fonction des résultats, le promoteur pourra demander une autorisation de mise sur le marché (AMM). Enfin la phase IV, après obtention de l’AMM, dure de un à quatre ans et poursuit l’étude de la pharmacovigilance.
Infirmière de recherche clinique : une formation spécifique
A 45 ans, Sylvie Maillochaud a suivi un DIU FARC* (Formation des assistants de recherche clinique), ouvert aux détenteurs de bac +3. « J’avais quelques notions de psychiatrie, mais elles étaient légères. A mon arrivée au Centre Hospitalier Henri Laborit, j’ai du effectuer plusieurs périodes de stage dans un pavillon d’hospitalisation afin de me familiariser aux différentes pathologies psychiatriques mais également rencontrer les équipes avec lesquelles j’allais devoir collaborer », explique-t-elle.
Ainsi, le temps d’une année universitaire, elle passe une semaine par mois à Paris avec, à la clé, une épreuve écrite et orale. « Le rythme était intense, avec beaucoup de cours. Ce n’était pas facile de s’y remettre car on n’a plus la même mémoire et les mêmes automatismes », s’amuse-t-elle. Mais c’était indispensable. « Aujourd’hui, je me sers de cette formation tous les jours », assure-t-elle. Najet Belghali, du CIC de Lyon, souligne la possibilité de suivre également le DU FIEC (Formation des investigateurs aux essais cliniques) pour les bac +5.
Esprit réglementaire, notions de recherches sur les personnes humaines, lien avec le médicament, création de protocoles, autant de missions que Sylvie Maillochaud aurait été incapable de mener à bien sans ce socle de formation. Pourtant, l’expertise de ces infirmières n’est toujours pas valorisée. « Il n’existe pas de statut spécifique comme pour les puéricultrices ou les IBODE. Notre DU n’est pas du tout valorisé », estime-t-elle. Un constat partagé par Najet Belghali qui gagne 60 euros bruts de plus mensuellement depuis qu’elle est IRC, autant dire une goutte d’eau. « Il n’y a guère que dans le privé que l’expertise est valorisée financièrement », concède Arnaud Vaumousse.
Pour aller plus loin :
Formation des assistants de recherche clinique et des techniciens des études cliniques D.I.U.

Ils sont à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus | |
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus | |
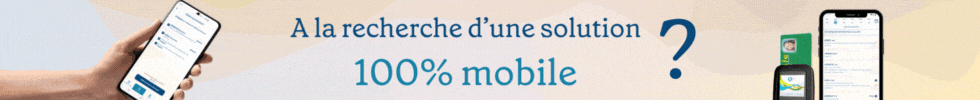













Soyez le premier à laisser un commentaire !