Plan blanc pour une nuit noire
C’était un vendredi soir, à 21 heures. Des soignants quittaient leurs blouses et leur fatigue pour entamer un week-end mérité, d’autres prenaient leur relais. Quelques minutes plus tard, ce 13 novembre, les terroristes commençaient leur ballet macabre. La mobilisation est totale. Trois infirmiers témoignent pour ActuSoins.
Saint-Louis, au cœur du carnage

Hôpital Saint-Louis, salle de réveil dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. © Pourya Pashootan / AP-HP
Véronique, pour rentrer chez elle, emprunte la rue Bichat. Surgi de nulle part, un jeune homme court dans sa direction : « Ma grand-mère est blessée ! Elle a reçu des balles ! ». Ni une, ni deux, l’infirmière en civil arrête un camion de pompier, réquisitionne un brancard et secourt la vieille dame, avant de rentrer alerter ses collègues. La première victime de cette nuit d’attentats est inscrite à 21 h 42 à l’hôpital Saint-Louis qui jouxte les deux restaurants ciblés.
Peu après, Anne Pouessel, sa cadre supérieure de santé, reçoit un appel de Jean-Paul Fontaine, le chef du service des urgences de l’hôpital du Xe arrondissement. « Tu peux venir ? » Elle quitte ses confitures, prend sa voiture et avale les quatre-vingts kilomètres qui la séparent du Canal Saint-Martin pour prendre son poste de coordination des infirmiers et aides-soignants. Éparpillés dans les restaurants et cafés environnant leur lieu de travail, un grand nombre d’entre eux se présente spontanément. « Je suis responsable du planning et j’ai dû en renvoyer un certain nombre chez eux. Il nous fallait de la réserve de personnel, au cas où une autre attaque survenait dans la soirée », explique cette cadre. Pour les soignants de Saint-Louis, c’est le choc : le Carillon est leur base arrière, l’endroit où ils décompressent après le travail.
Saint-Louis accueillera vingt-sept blessés par balle. « Les médecins sont descendus aux urgences pour aider à trier les blessés. Urgence absolue ou urgence relative, tout dépendait de la localisation de la balle, et eux seuls pouvaient le déterminer, raconte Anne Pouessel. Pendant ce temps, les infirmiers s’activaient : perfusions, antalgiques, pansements… Mais surtout, nettoyage des boxes. Jamais nous n’avions vu autant de sang dont l’odeur entêtante flottait partout ».
Cette nuit-là, tout l’hôpital est sur le pont. La direction et les cadres sont aussi revenus en urgence. Ils assurent la logistique : l’organisation des hommes, mais aussi la fourniture de lits-porte, de draps, de bouteilles d’eau. « Il régnait une atmosphère bizarre, très calme, très solidaire. Il n’y avait plus de place pour les conflits personnels », souligne-t-elle.
Alors que les patients sont encore au bloc opératoire, à une heure du matin, le téléphone commence à sonner sans discontinuer. Ce sont les familles, folles d’inquiétudes, à la recherche de leurs proches. « Certains appelaient de loin. D’autres se déplaçaient à l’hôpital, dans la nuit, puis le lendemain matin. Dans ce malheur, nous avions une chance : nous avions identifié tous nos patients, et pouvions répondre avec certitude à l’anxiété de ces parents », relate cette cadre de santé.
Puis, « les victimes, comme les personnels, ont commencé à décompenser. Notre hôpital, une référence pour le traitement des cancers, dispose d’un bon nombre de psys, appuyés par des équipes de Lariboisière », explique-t-elle. Viennent ensuite les réunions de « débriefing ». Plusieurs dysfonctionnements sont relevés, des points à améliorer pour la prochaine fois, en espérant qu’il n’y en ait pas. Le premier, lié au manque de personnel habituel à l’hôpital : « Lorsque les premières victimes sont arrivées, il n’y avait que trois aides-soignants. Et l’un d’entre eux était sorti avec un brancard pour aller chercher les victimes du Carillon. Résultat, nous manquions de bras pour porter les victimes ».
Je suis responsable du planning et j’ai dû en renvoyer un certain nombre chez eux. Il nous fallait de la réserve de personnel, au cas où une autre attaque survenait dans la soirée.
Deuxième faiblesse, les problèmes technologiques : « Aux urgences de Saint-Louis, seuls les abonnés à SFR ont du réseau. Lorsque le fixe est sans cesse occupé, cela pose des problèmes pour communiquer avec nos collègues ».
Dernier point : le logiciel informatique, très lent, ne permet pas de répondre à un afflux de victimes, ce qui peut causer une certaine désorganisation. Mais une grande fierté est également ressortie de ces échanges et des multiples appels de remerciements des familles des patients.
À l’Hôtel-Dieu, la prise en charge psychologique et policière
Guillaume Gandoin partageait son repas avec son collègue, le Dr Kierzec, lorsque les « push » de BFM, l’ont alerté sur son portable. « Nous avons appelé les responsables de garde, pour savoir si c’était vrai, s’ils avaient besoin d’aide. Le premier blessé par balle venait d’arriver », raconte l’infirmier. Les deux compères se précipitent vers l’hôpital. Titulaire d’un diplôme d’Etat d’expertise dans la gestion des interventions d’urgence sanitaire, ancien secouriste à la protection civile de Paris, le jeune homme a voix au chapitre dans la « cellule de crise » de l’hôpital. Le Plan blanc, il connaît par coeur : « Nous nous réunissons environ quatre fois par an, en fonction de l’actualité, pour élaborer des schémas de circulation des patients, anticiper les moyens nécessaires, tenir à jour la liste des personnels pour savoir qui rappeler », détaille l’infirmier.
Comme le 11 janvier dernier, lors des attentats de Charlie Hebdo, il faut mettre en pratique la théorie. « On se doutait que le Plan blanc allait être déclenché, alors on est passé dans les services pour briefer les gens, organiser les salles, terminer au plus vite les affaires courantes », raconte-t-il.
Voisin du Quai des Orfèvres, l’hôpital est choisi pour prendre en charge les « impliqués », ceux qui ne souffrent pas de blessures physiques mais ont assisté au drame. « Nous assurons les urgences médico-judiciaires toute l’année, et nous avons donc une expertise sur la circulation entre l’hôpital et la police. Ce soir-là, c’était très important, car les policiers avaient besoin des dépositions des impliqués », poursuit Guillaume Gandoin.
Chargé de rappeler ses collègues infirmiers, il se saisit des listes tenues à jour : « J’ai réfléchi à ceux qui se trouvaient au plus près de l’hôpital, j’en ai rappelé trois. Certains sont revenus spontanément, mais comme nous ne connaissons pas tout le monde, nous ne savions pas qui laisser rentrer ou pas ».
Rapidement, les cellules d’urgence médico-psychologique de Paris et des Hauts-de-Seine viennent prêter main-forte. « Avant, la prise en charge psychologique des victimes s’effectuait là où se déroulaient les événements. Aujourd’hui, nous craignons le « sur-attentat » et nous acheminons les victimes vers les hôpitaux. Et avec raison : au Bataclan, l’un des terroristes est revenu constater son œuvre ce soir-là », poursuit-il.
En tout, cinquante impliqués et dix blessés physiques passeront ce soir-là par l’Hôtel-Dieu. « Il faut garder groupées les urgences psychologiques et somatiques. Certains impliqués pensent qu’ils vont bien, alors que le choc leur a fait complètement oublier leur diabète. Nous devons vérifier leurs constantes, prendre leur tension etc. », détaille cet infirmier. Les jours suivants, le défilé des « impliqués » continue, jusqu’à atteindre cinq cents personnes. « Tout s’est plutôt bien passé, nous avons vraiment bien travaillé », estime Guillaume Gandoin. La seule chose à améliorer ? « Si toute la nuit, nous avons travaillé en parfaite synchronie avec la Croix Rouge, les associations de secourisme, le SAMU, les psys, la brigade criminelle, nous ne nous attendions pas à ce que la mairie du 11e arrondissement mette en place sa propre cellule psychologique. Ils envoyaient ensuite les victimes chez nous, ce qui leur a donné un sentiment de dispersion qu’on aurait pu leur épargner », conclut cet infirmier.
Lariboisière, destination des « urgences absolues »
À 23 heures, le téléphone le réveille alors qu’il sort, épuisé, de deux gardes de 12 heures en 48h. L’AP-HP lui demande de se rendre à la salle de réveil de l’hôpital Lariboisière. Surpris, l’infirmier regarde rapidement les actualités. Vingt minutes plus tard, il est sur place.
Dans la salle de déchocage où sont accueillies les urgences absolues avant de passer au bloc opératoire, il se met en binôme avec une infirmière titulaire, et commence à travailler machinalement : perfusions, bilans sanguins, préparation des cathéters artériels, pansements, antalgie… « Les patients portaient des garrots tourniquets autour des membres. Ils avaient des plaies énormes : une balle de kalachnikov, lorsqu’elle heurte un os, transforme ses fragments en autant de petits projectiles. Les points de sortie des balles sont très impressionnants. Certains avaient les membres complètement déchiquetés », décrit l’infirmier.
Les patients sont alignés dans la salle. Ils portent une feuille autour du cou avec le peu d’information recueillie et un bracelet avec un code barre, qui permet de les identifier. Une étiquette sur le front indique l’heure à laquelle ils sont entrés à l’hôpital, à laquelle on leur a posé leur garrot. Des victimes seront prises en charges à « Larib’ », jusqu’à deux heures du matin.
Les patients sont alignés dans la salle. Ils portent une feuille autour du cou avec le peu d’information recueillie et un bracelet avec un code barre, qui permet de les identifier. Une étiquette sur le front indique l’heure à laquelle ils sont entrés à l’hôpital.
Il finira sa nuit à cinq heures. « Ensuite, je ne pouvais pas dormir. C’étaient des patients qui avaient mon âge, nés entre 80 et 90. Cela aurait pu être moi. Au SMUR, je vois des choses difficiles : des suicides, des gens écrasés par le métro… mais autant de blessures, ça jamais. Sur le moment, j’étais dans l’action. Dans les salles au soussol, on n’avait pas de vision d’ensemble, pas le temps de cogiter, on ne savait pas si les autres hôpitaux avaient autant de patients que nous. Nous étions dans une ambiance un peu irréelle. À la fin de la nuit, nous avions les larmes aux yeux », se souvient le jeune homme avec émotion.
Une fois n’est pas coutume, il loue les mérites de l’AP-HP. « J’ai été très surpris par la réactivité de l’institution. Ils ont pensé à tout, y compris aux plateaux-repas à apporter aux infirmiers rappelés in extremis. Le directeur errait dans les couloirs à deux heures du matin ».
Elsa Sabado
Article paru dans ActuSoins magazine
Avec Simply Vitale 4.0, Cegedim Santé offre aux infirmier(e)s, une autre vision de leur journée sur une nouvelle tablette plus performante. |  |
| Plébiscitée depuis 11 ans par plus de 12.000 infirmier(e)s libéraux, Simply Vitale ne cesse d’évoluer pour optimiser le quotidien des IDEL et répondre aux exigences de leur métier en termes d’organisation, de mobilité et de travail en équipe. Demander une démo |
|




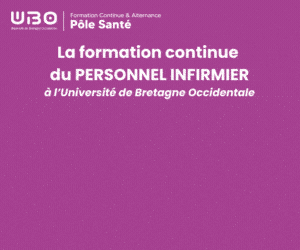












Bravo aux collègues
Bravo aux équipes chirurgicales notamment.
Vous êtes les héros de l’ombre de cette tragique date…Comme un certain 14 juillet …Plus jamais ça…
Chris Bilzerian c’est ton plan un peu hein?
Chapeau bas reconnaissance
Isma Boo Manon Souchot Nina Souchot