
Dans un café parisien, Svetlana, Liv, Mariam et Anna (1) discutent avec animation. C’est la première fois qu’elles se retrouvent, depuis leur rentrée en Ifsi (Institut de formation en soins infirmiers), en septembre dernier. Toutes sont titulaires d’un diplôme infirmier non reconnu en France, car obtenu hors de l’espace économique européen.
« C’est très dur. Je ne comprends pas », répète Mariam. Cette infirmière géorgienne a quitté son pays en 2003, à cause des désordres économiques et politiques qui ont suivi la dislocation de l’URSS : « pendant seize mois, j’ai travaillé sans toucher de salaire. » A 40 ans, elle redevient donc étudiante en soins infirmiers. Avec le sentiment d’être injustement traitée.
Exercer en France dans ces conditions prend un tour souvent chaotique. Etape indispensable, réussir le concours ouvert aux infirmières extracommunautaires (2) dans une limite de 2 % des places par établissement. Les épreuves visent à apprécier les compétences de base et les spécificités du métier dans le pays d’origine. Se fondant sur un entretien et l’examen du dossier scolaire du candidat, un jury de l’Ifsi évalue la nécessité de refaire tout ou partie du cursus.
En dépit de son passé professionnel en Géorgie – soins intensifs, réanimation, urgences –, Mariam doit reprendre sa formation depuis le début. « Je n’ai pas pu fournir mes résultats semestre par semestre. J’ai obtenu mon diplôme en 1996, à l’époque où on quittait la Russie. » La Géorgie a déclaré son indépendance en 1991.« Nous avons eu la guerre [au début des années 1990, puis en 2008, ndlr], des problèmes politiques. Il n’y a plus d’archives… »
De fait, la filière est très académique. Trop ? « Cela s’inscrit dans un problème général français : la difficulté à reconnaître les acquis de l’expérience », estime Elisabeth Wisniewski, directrice de l’Ifsi du centre psychothérapique de Nancy. Certes, certains de ces infirmiers s’avèrent peu qualifiés. « Mais pourquoi ne pas encadrer cette entrée en formation – via un entretien préalable, puis des stages – comme c’est le cas pour les médecins étrangers qui prétendent au diplôme d’infirmier en France ? »
Exercer comme aide-soignante
En attendant, il faut commencer par gagner sa vie. Beaucoup acceptent des petits boulots, ou des emplois en-dessous de leur niveau de qualification. Anna a quitté l’Israël en 2005. A Paris, elle consacre d’abord un an à l’apprentissage du français.
Pour se familiariser aussi avec l’environnement hospitalier, elle sollicite une autorisation de pratiquer en tant qu’aide-soignante auprès de l’Agence régionale de santé : « il y avait d’abord un examen écrit pour vérifier mon niveau de français et des questions sur l’hygiène. J’ai attendu un an après le dépôt de mon dossier. »Encore une année de plus et elle accède à l’épreuve pratique. Anna est embauchée en soins de suite et de réadaptation de 2010 à 2013. C’est après la naissance de son troisième enfant qu’elle s’oriente finalement vers un Ifsi. Depuis 2012, cette possibilité d’exercer en qualité d’aide-soignante n’est même plus offerte aux étrangers.
Inès, mexicaine et en France depuis 2014, s’est donc débrouillée, seule, pour effectuer des stages à l’hôpital. « Je n’ai reçu que deux réponses positives sur quatorze candidatures : ma demande était inhabituelle. »A 26 ans, elle fait preuve d’une détermination peu commune. Voilà quatre ans qu’Inès a suivi son compagnon en France. « Au Mexique, on ne part même pas de chez ses parents si ce n’est pour se marier. Alors quitter le pays ! Ce doit être quelque chose de productif. »Elle envisage alors d’étudier la spécialité d’infirmière anesthésiste, qui n’existe pas au Mexique. Prérequis indispensable au concours d’Iade : au moins deux ans d’expérience en France. « Problème : comment valider mon diplôme ? »Et comment même simplement travailler ?
Arrivée avec un visa étudiant de six mois, remplacé par une carte de séjour temporaire « visiteur » d’un an, elle devient baby-sitter. Au noir dans un premier temps. « Je ne pouvais rien faire d’autre. »Elle se marie, puis bénéficie d’un titre de séjour qui l’autorise à travailler… en 2016. Cinq ans d’études au Mexique, deux ans d’apprentissage du français et de baby-sitting en France, plusieurs mois de stages et de formation en prépa privée plus tard, Inès entre en Ifsi.
Décrocher un titre de séjour stable, le droit de travailler, se décider à passer le concours, le préparer… Cela représente du temps – parfois des années – de vie et de pratique perdues.
Déclassement
C’est le cas de Svetlana (1), une femme expansive aux grands yeux bleus : « Je suis venue en France en 2004 pour retrouver un grand amour », raconte-t-elle avec l’accent de sa Russie natale. Quand il a su que j’étais infirmière, il s’est dit :« Quelle chance, elle va me nourrir. C’est même lui qui s’est renseigné pour moi. Il a été déçu ! » », lance-t-elle d’un ton dramatique.
Svetlana peut se prévaloir de quinze ans de métier en Russie, suivis de deux ans comme auxiliaire de vie en France, puis dix ans en tant qu’aide-soignante. Non sans amertume. Dans l’URSS finissante de 1990, il existe en effet « deux niveaux de diplôme », explique Svetlana. Le sien lui permet d’être urgentiste ou en autonomie dans les villages. « Je pouvais faire des prescriptions, des arrêts de travail courts. Je traitais la bobologie… »
En France, c’est la désillusion. Il lui est « très difficile »de faire abstraction de ses connaissances. « On me répondait : « ton statut, c’est aide-soignante ! » J’ai fini par accepter de me taire, car j’avais besoin de travailler. En plus, la situation était compliquée pour le renouvellement du titre de séjour de mon fils. »Redevenue étudiante en 2017, elle a perdu une partie de ses habiletés. « En Russie, j’étais la meilleure pour piquer des veines difficiles ; pendant le stage ici, ma main tremblait. Heureusement, j’étais dans une bonne équipe. »
Qu’elle ait tant attendu a de quoi surprendre. « Tout le monde m’encourageait à retourner à l’école. Mais j’ai mis longtemps à surmonter mon orgueil. » Devoir prouver au concours « que j’étais infirmière, puis refaire trois ans d’études. Ça me révoltait. »
Le sentiment de déclassement est fort.« On nous apprend de nouveau à mettre des gants, l’hygiène des mains… », relate Anna, effarée. C’est le seul moment de la discussion où la discrète Liv hausse la voix pour confirmer. Diplômée en 2006 au Népal, elle y exerçait dans un service de soins intensifs.

« J’ai d’abord fait les vignes »
Mireille (1) a éprouvé de manière aigue ce décalage. Infirmière diplômée d’Etat en 2014, elle s’est installée en libéral dans le sud de la France. A l’issue d’un itinéraire heurté. Elle a débuté il y a dix-sept ans au Cameroun, avant de rejoindre son mari en France, en 2008. « Ambitionnant » d’entrer en Ifsi, il lui faut cotiser suffisamment pour demander un financement de sa formation par Pôle emploi. « J’ai d’abord fait les vignes. La récolte des poires aussi », avant de devenir auxiliaire de vie.
Rapidement, Mireille intègre un premier Ifsi. Au vu de son parcours, on l’admet directement en troisième année. Elle interrompt sa scolarité deux mois avant la fin. « Je ne pouvais pas continuer », dit-elle sobrement. Son dernier emploi au Cameroun, Mireille exerçait « auprès d’une population extrêmement sous-développée ».Et à un poste d’encadrement.
La transition est pénible :« je me comportais comme une professionnelle. Pourquoi être dirigée en stage par une fille diplômée depuis à peine trois ans ? J’avais l’impression que l’on me rétrogradait. Alors je ressentais énormément de rancune. Je ne parvenais pas à entrer en relation avec l’autre. Et vice versa. »
Fruit d’un long cheminement personnel, cette infirmière mettra des années à passer outre ses résistances. D’autant qu’elles se doublent d’une épreuve inattendue : l’intégration culturelle. Avec ce que cela comporte de perte de repères et d’incompréhensions.
« A l’Ifsi, j’étais la seule noire, la seule étrangère, et la seule âgée de 40 ans. »De plus, un malentendu surgit dès le premier stage. « C’était dans une unité Alzheimer. Je m’y rendais en train et en bus. Le premier jour, je suis arrivée deux heures en retard. La cadre de santé m’a rembarrée et je ne l’ai pas compris : dans mon pays on n’est pas obligé d’appeler pour prévenir. Nous sommes parties du mauvais pied, tout ce que je faisais semblait inadapté. J’encaissais et je me recroquevillais sur moi-même. »
Choc culturel
Après cette tentative avortée, Mireille exerce un temps comme aide-soignante. En 2012, elle est admise dans un autre Ifsi. Avec succès cette fois : « Pendant les cours, j’étais traitée en professionnelle. Tous les mois, je bénéficiais d’un entretien avec une formatrice. Il faut cette écoute, martèle-t-elle. On ne dit pas le nombre de personnes qui arrêtent tout parce qu’elles n’expriment pas leurs blocages et se sentent dévaluées. »
C’est ce qui a guetté Liv, tentée d’abandonner l’Ifsi. « Je pensais ne pas être capable de continuer à cause de la barrière de la langue. Mais petit à petit, j’ai trouvé des amies qui m’ont aidé. »
Ce choc culturel impacte aussi la relation de soin. « La communication y est importante, souligne Anja, norvégienne et infirmière dans une équipe mobile de soins palliatifs. Et nous avons tous nos valeurs. » La gériatrie est emblématique à cet égard. En Moldavie, les hôpitaux comptaient peu de personnes dépendantes, se souvient Olga, infirmière et chercheuse en poste dans un service de maladies infectieuses et tropicales, installée en France en 2012. « Probablement parce qu’elles choisissaient de rester à la maison. Même en milieu de soin, si la famille ne s’en occupe pas, c’est une honte. » Le métier d’aide-soignante n’y existe donc pas. Mariam et Liv témoignent aussi de soins de nursing impliquant la famille « et si le patient le préfère, précise Mariam. Je suis choquée de voir que les choses sont si automatiques. »
Les personnes dont la culture révère « les personnes âgées sont révoltées par la prise en charge française, rapporte Blandine Jacquier, formatrice pour Elzeralde, une prépa au concours infirmier. En stage, elles passent beaucoup de temps à la toilette, à discuter avec eux. Mais dans un nouveau pays, avec d’autres règles, on ne peut pas faire tout ce que l’on veut. »
Ces constats trouvent un écho particulier dans un contexte de grève dans les Ehpads, les 30 janvier et 15 mars dernier, pour protester contre le manque de moyens humains.
Emilie Lay

Il est à présent en accès libre. ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective. Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
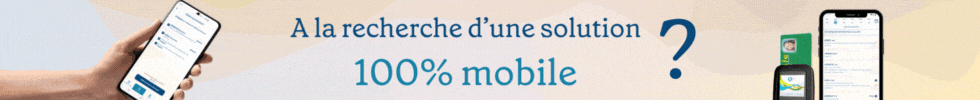












Vous devez être connecté pour poster un commentaire.