Jeudi 31 mai, de 9h30 à 10h30 : « Préparation d’une communication scientifique à l’oral : recommandations et bonnes pratiques ». Salon infirmier.

Outre le fait de savoir rédiger un article scientifique, il faut « aussi, en complément, en proposer un abstract rédigé de manière à ce qu’il puisse être sélectionné et préparer une présentation orale qui réponde aux attendus » du genre, observe l’enseignant.
Conseils pratiques et méthodologiques
Il conseille tout d’abord de ne pas dépasser le temps imparti et de bien prendre en compte les consignes matérielles relatives au support de la présentation. Sur cette présentation elle-même, il s’agit d’organiser le support visuel (Powerpoint par exemple) en adéquation avec la présentation orale et sans qu’ils soient redondants.
Le plan Imrad (introduction, method and discussion) offre selon lui aux orateurs une trame dans laquelle ils peuvent répartir judicieusement les informations importantes de leurs travaux. « En introduction, on indique ce qui est original dans le travail qu’on présente, ce qui le justifie, souligne Christophe Debout, et on pose de manière explicite la question de recherche de ce travail et nos hypothèses. » La méthodologie (approche, échantillonnage, méthodes, outils, questions éthiques…) devra aussi être exposée précisément pour assoir la validité de la recherche.
Etoffer les résultats
La partie « résultats » sera naturellement la plus étoffée, note l’infirmier, puisqu’elle vise à « exposer ce que l’on amène de nouveau sur le sujet ». Enfin, la discussion montrera le lien (ou la rupture) du travail présenté avec les travaux existants, « ses limites et prolongements ainsi que les préconisations qui en émanent sur les pratiques, l’enseignement ou l’organisation des soins », poursuit-il. Autre conseil : bien répéter sa présentation en amont du jour J et, après coup, se demander ou demander à des personnes de confiance ce qu’on aurait pu faire autrement. Histoire de progresser pour la présentation suivante.
O.D

Abonnez-vous à ActuSoins Magazine à partir de 9,90 € par an, c’est ICI.
Formez-vous à distance grâce au 100% e-learning | |
|---|---|
| Vous travaillez en établissement de santé ou en structure sociale ou médico-sociale ? Découvrez notre sélection de formations disponibles en e-learning et spécialement conçues pour les infirmier(s). En savoir plus |
|
Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée | |
|---|---|
| Notre formation "Plaies aiguës et chroniques : vers une cicatrisation dirigée" en e-learning a été spécialement développée pour vous permettre de prendre en charge tous les types de plaies, aiguës ou chroniques, effectuer un choix logique de pansements et mettre en place une cicatrisation dirigée. En savoir plus |
|



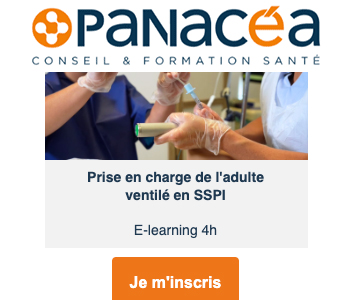
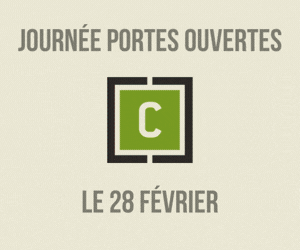




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.