
Secourisme en santé mentale : quelques pistes pour savoir réagir face à la souffrance psychique
À l’instar des « gestes qui sauvent », dont l’objectif est d’apporter un secours physique à une personne en situation d’urgence, le secourisme en santé mentale vise à offrir une aide psychologique aux individus en souffrance psychique ou à prévenir d’éventuelles crises. Puis, à orienter, si besoin, vers des professionnels de la santé mentale.
En tant que pilier du service à la personne, le secteur des soins fait quotidiennement face à des défis en matière de santé mentale. Que ce soit avec les patients pris en charge, qui peuvent souffrir psychiquement en raison de leur état de santé physique ou avec leurs proches, éprouvés par la situation. Même le personnel, confronté à des conditions de travail exigeantes et à des situations difficiles, n’est pas épargné. La santé mentale est intrinsèquement liée au bien-être global. Dans ce contexte, l’une des missions fondamentales de l’infirmier est de répondre aux situations difficiles, en mettant en oeuvre des mesures préventives, des actions directes et en favorisant l’éducation à la santé. Il s’agit de répondre de manière proactive aux besoins afin d’éviter toute aggravation d’un état de mal-être.
Intervenir précocement en tenant compte de manière concrète de la dimension psychique de toute prise en charge contribue à l’amélioration globale des soins. Cette approche favorise une société où l’expression ouverte des difficultés est encouragée et où les tabous associés à la santé mentale sont progressivement atténués.
Les quatre troubles de santé mentale les plus courants, selon le DSM-5 (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, voir tableau ci-dessous) incluent les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l’usage de substances. Face à l’émergence possible d’un de ces troubles psychiques, l’infirmier – ou le secouriste en santé mentale formé – peut appliquer un plan d’action spécifique.
Sommaire
TogglePrincipaux troubles mentaux répertoriés dans le DSM 5
|
Catégorie |
Exemples de Troubles Mentaux |
|
Troubles de l’humeur |
Dépression, Trouble bipolaire |
|
Troubles anxieux |
Trouble panique, Anxiété généralisée |
|
Troubles de stress et traumas |
Trouble de stress post-traumatique |
|
Troubles de la personnalité |
Trouble de la personnalité borderline |
|
Troubles de l’alimentation |
Anorexie mentale, Boulimie |
|
Troubles liés à l’utilisation de substances |
Dépendance à l’alcool, Toxicomanie |
|
Troubles de l’attention et de l’hyperactivité |
Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité |
|
Troubles obsessionnels-compulsifs |
Trouble obsessionnel-compulsif |
|
Troubles de la schizophrénie et autres troubles psychotiques |
Schizophrénie, Trouble schizoaffectif |
|
Troubles neurocognitifs et du vieillissement |
Maladie d’Alzheimer, Démence vasculaire |
|
Troubles de l’élimination |
Énurésie (incontinence urinaire nocturne) |
Souffrance psychique : Apprendre à repérer
Il va d’abord repérer et analyser. Les critères de bascule entre une souffrance psychique passagère et le développement d’un trouble peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la durée, la gravité et la récurrence des symptômes.
Durée : Une souffrance psychique passagère dure généralement peu de temps, tandis qu’un trouble mental s’étend une période prolongée, souvent plusieurs semaines, mois ou même années. Lors de l’échange avec la personne, la question clé pourrait être : « Depuis combien de temps ressentez-vous cela ? ». Cette question est particulièrement pertinente face à des symptômes récurrents tels que la tristesse ou la perte d’intérêt (signes potentiels de dépression) ou l’inquiétude (anxiété).
Intensité : Les symptômes d’une souffrance psychique passagère peuvent être moins intenses et avoir un impact moindre sur le fonctionnement quotidien, comparé à un trouble psychique qui peut provoquer une détresse significative et des difficultés importantes dans différents domaines de la vie.
Une question pertinente à poser pour explorer cette distinction pourrait être : « Comment cela se manifeste au quotidien ? » Face à une personne déprimée, l’inquiétude de l’aidant variera selon la situation. Par exemple, si une personne évoque de la tristesse mais parvient tout de même à gérer ses activités quotidiennes, l’aidant sera moins préoccupé que si la tristesse est si accablante que la personne ne plus sortir de son lit.
Impact fonctionnel : Un trouble psychique peut causer des difficultés majeures dans divers aspects de la vie quotidienne tels que le travail, les relations interpersonnelles, les activités sociales ou la scolarité, tandis qu’une souffrance psychique passagère a un impact moindre sur ces domaines. Pour évaluer les limitations concrètes, les questions seraient : « Qu’est-ce que vous arrivez à faire ? », « Qu’est-ce que vous n’arrivez plus à faire ? »
Plan d’action AERER
Chaque situation est singulière mais quelques étapes clés existent pour aider une personne lorsqu’elle souffre. Par manque de connaissance ou en cherchant à résoudre rapidement une situation, il peut arriver que l’on se montre maladroit, ce qui peut entraver l’échange. Initier un dialogue avec quelqu’un que l’on perçoit déjà comme vulnérable n’est pas facile. Pourtant, cela peut être extrêmement bénéfique. Globalement, pour aborder le sujet, l’infirmier peut choisir un moment de tête-à-tête pour ne pas mettre l’autre mal à l’aise. Il peut simplement lui demander si « ça va ? » ou « comment il/elle se sent ? ».
Si l’on prend le temps d’aller vers cette personne c’est souvent parce qu’on a observé des changements qui ont alertés, comme des pleurs continus chez une personne déprimée ou une agitation psychomotrice et/ou des plaintes somatiques chez une personne anxieuse.
Beaucoup de gens hésitent à poser ces questions en voyant l’autre pleurer, de peur de le mettre mal à l’aise ou d’ouvrir une brèche, surtout dans un environnement où l’aspect somatique reste prioritaire. Pourtant, une personne, en état dépressif par exemple, ne cherche pas spontanément de l’aide car cela lui semble parfois au-dessus de ses forces.
Lorsque l’anxiété prend de l’ampleur, il peut lui être difficile d’en prendre conscience ou que cela soit visible pour les autres, car elle cherche souvent à dissimuler et à garder le contrôle d’une situation qui lui échappe. Imaginons un infirmier dans un service qui observe la dégradation psychologique d’un patient ou d’un proche aidant. Une entrée en matière comme : « J’ai remarqué que vous aviez du mal à rester en place, du coup je me demandais comment vous vous sentiez. Quelque chose vous tracasse ? », pourrait faire une différence.
Il peut parfois être nécessaire d’insister pour que la personne accepte de s’ouvrir.
Si elle accepte de partager qu’elle ne se sent pas très bien en ce moment, l’infirmier peut lui accorder une attention particulière en prenant plus de temps, notamment pour l’interroger ouvertement sur la durée, l’intensité et l’impact de son état dans sa vie. Cela facilite le partage de son expérience.
Les questions ouvertes sont à privilégier. Il est important de reformuler les propos pour éviter les interprétations. Cet échange peut permettre à la personne de se sentir moins seule dans ce qu’elle traverse. L’infirmier peut lui rappeler qu’elle n’est pas seule et que beaucoup de personnes vivent des situations semblables. « Vous savez cela arrive. C’est difficile surtout lorsqu’on se bagarre seul. »
La transmission d’informations est adaptée au niveau de connaissance de la personne : elle peut déjà connaître très bien son trouble, ou au contraire, se tromper sur son état. Une question clé pourrait être : « Comment nommez- vous ce que vous traversez ? »
Il est important de pouvoir dire : « Vous savez je suis infirmier dans ce service mais je ne suis pas spécialiste de la santé mentale ni médecin, mais cela me semble un peu plus sérieux qu’un simple coup de blues. » Mentionner par exemple un possible trouble dépressif ou anxieux peut inciter la personne à y réfléchir et à se documenter sur le sujet.
L’inviter à consulter un professionnel prend ainsi tout son sens : activer un accompagnement comme on le ferait avec un problème physique est une étape clé. Un psychiatre pourra, par exemple, poser un diagnostic, proposer un traitement adapté (psychothérapie, traitement médicamenteux…) ou orienter vers d’autres professionnels (psychologues notamment) s’il estime que la situation ne nécessite pas de suivi médical. Une souffrance psychique passagère peut en effet souvent être gérée avec des stratégies d’adaptation et un soutien social, tandis qu’un trouble psychique plus installé nécessite une intervention professionnelle spécialisée.
Pour la suite, la mission de l’infirmier, comme tout secouriste formé, sera d’aider la personne à trouver des ressources comme oser se confier à ses proches ou rejoindre un groupe de parole ou de pairs aidants, ou encore se documenter sur la santé mentale.
« Allez-voir un PSY… mais parlons d’abord ! »
Se contenter de suggérer à un patient en pleurs de consulter un psychologue/ psychiatre, que ce soit dans le service ou à l’extérieur, peut donner l’illusion éphémère d’être un bon soignant, celui qui doit résoudre rapidement toutes les difficultés.
En engageant plutôt un échange sur les facteurs sous-jacents à cette détresse émotionnelle, l’objectif serait d’aider la personne à se recentrer sur ce qu’elle traverse. Cela faciliterait sa prise de conscience de sa capacité d’action malgré les difficultés, lui permettant d’agir non pas comme un patient passif suivant des directives médicales, mais en tant qu’acteur collaborant avec des professionnels de santé pour améliorer son état.
Secouristes en santé mentale
Le secourisme en santé mentale, né en Australie dans les années 2000 se déploie en France depuis 2019. Il existe une formation spécifique de deux jours, ouverte à tous les citoyens majeurs (sans autre prérequis) qui vise à offrir un premier soutien face à la souffrance psychique, sans visée thérapeutique ni remplacement des professionnels de santé mentale.
Les secouristes, formés selon des standards validés scientifiquement par des experts, sont capables d’identifier les signes de mal-être, d’informer et de diriger si nécessaire, vers des aides spécialisées. Ils ne sont pas habilités à réaliser des entretiens à visée psychothérapeutique, mais sont formés pour pouvoir favoriser le dialogue avec une personne en souffrance, communiquer avec bienveillance, sans intrusion et d’égal à égal. Infos sur : www.pssmfrance.fr
Christelle VACHER
Infirmière et instructrice PSSM France
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins


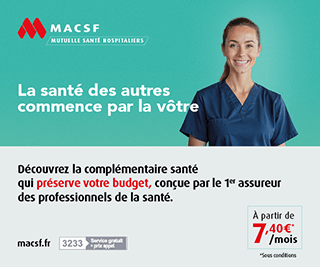



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.