Percéponimes, une étude menée au CHU de Nîmes, conclut à une représentation plutôt négative des personnes en situation d’obésité, y compris au sein du personnel hospitalier. Un projet issu de cette étude, va permettre de sensibiliser les salariés pour améliorer le parcours de soins et de vie des patients.

2,65 sur 5, sur l’échelle de la « Phobie du gras » (Fat phobia scale). Ce score résulte du questionnaire* soumis au personnel hospitalier, dans le cadre de Percéponimes, l’étude qui cherchait à évaluer leur perception des patients en situation d’obésité. « Ce chiffre correspond à une vision globalement négative de ces personnes obèses », indique le docteur Valérie Taillard, endocrinologue dans le service d’endocrinologie du CHU de Nîmes et l’unité transversale de nutrition clinique, qui a lancé ce projet d’étude**.
634 salariés de l’hôpital, tous métiers confondus, y ont répondu (soit 8 % de retours). « Cela donne une photo à l’échelle de la société qu’est un CHU », fait observer le médecin. « L’échantillon n’est pas énorme, mais c’est ce que l’on retrouve dans les études de cette ampleur », précise-t-elle. Un échantillon qui n’a pas présenté de différence significative quel que soit le métier exercé, la catégorie socio-professionnelle, le genre ou le statut pondéral.
L’étude côté « patients »
Le protocole questionnait au même instant l’expérience de la stigmatisation dans leur parcours de vie par des patients accueillis en consultation ou en hospitalisation de jour dans le service. 311 ont été volontaires, dont une majorité de femmes (57%)… « Nous avons une grosse activité et nos patients ont accueilli très positivement cette démarche qui s’intéressait à leur vécu depuis la petite enfance », justifie le docteur Valérie Taillard. Résultat : plus de deux tiers de ces patients (69 %) ont fait au moins une fois l’expérience de la stigmatisation – moqueries (65 %), injustices (47 %), discriminations (47 %).
« Ces données interpellent, elles sont en adéquation avec une étude menée en 2024, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la stigmatisation dans l’espace public, le milieu scolaire, les familles, le milieu médical… » Près d’un quart des sondés y déclaraient en avoir été victime – 50 % dans l’espace public, 45 % dans le milieu scolaire, 22% au sein des familles . « 19 % dans le milieu médical, c’est significatif », ajoute le docteur Taillard. « Le personnel soignant a souvent été désigné comme une source majeure de stigmatisation liée au poids » note-t-elle. L’étude menée à Nîmes est la première à le mesurer au sein d’un CHU.
« Le but était entre autre, de faire le point sur des croyances qui persistent quel que soit le milieu », complète Laëtitia Dore, médecin endocrinologue qui a fait de Percéponimes l’objet de sa thèse de médecine présentée l’an dernier. L’étude veut servir d’appui à une sensibilisation des soignants par la formation. « Cette pathologie est encore assez mal connue, les cursus médicaux n’informent pas suffisamment, et en tout cas pas sur la stigmatisation », ajoute ce médecin. « Il faut réfléchir à ce que peut être une stigmatisation au niveau des soins, pour les patients que nous recevons, c’est un sujet sensible. »
Fort de l’étude Percéponimes, un groupe pluridisciplinaire se constitue au CHU, avec les soignants volontaires sur le sujet de la stigmatisation – IDE de l’unité transversale de nutrition, IDE du service cardiologie, soignant en psychiatrie, psychologues… « Nous réfléchissons à la diffusion d’une information autour de l’obésité maladie chronique pour sensibiliser les équipes », indique le docteur Taillard. « L’idée est d’en faire comprendre les déterminismes complexes, au delà du rapport alimentaire et de la dépense énergétique, mais aussi les représentations, les idées reçues. » Via l’élaboration d’un livret pédagogique et d’autres supports d’informations. « Les soignants ne savent peut-être pas toujours », rappelle le docteur Taillard.
Le CLAN de ce CHU a dédié le mois de janvier à la thématique nutritionnelle (Janvier Nutrition). En 2026, il va être consacré à l’obésité et au partage du savoir sur les mécanismes sous-jacents – psychologiques, comportementaux, génétiques, hormonaux… – qui interviennent dans la maladie. « 18 % de la population française est concernée, selon l’étude de l’Observatoire Français d’Epidémiologie de l’Obésité parue en 2024, et les chiffres sont en hausse constante », fait observer le docteur Taillard. L’obésité, considérée aujourd’hui comme un problème majeur de santé publique, est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme maladie depuis 1997. Elle est aussi devenue, avec le surpoids, la cinquième cause de mortalité***.
Myriem Lahidely
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Pour info
* Le questionnaire comportait 14 couples d’adjectifs contraires (actif-inactif, mange trop ou peu, anxieux-serein…) évaluant cinq grands champs de la personne en situation d’obésité : élan vital, santé psychique, comportement alimentaire, aspect corporel, capacités physiques. Le protocole d’étude a été préalablement validé par le comité d’éthique du CHU de Nîmes.
** la Clinique de l’obésité du CHU de Nîmes a monté l’étude en partenariat avec le Comité de Liaison Alimentation Nutrition du CHU.




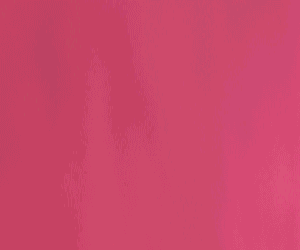





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.