Les infirmiers libéraux (IDEL) redoutent tous l’arrivée d’un courrier de notification d’indus dans leur boîte aux lettres. Comment l’Assurance Maladie procède-t-elle aux contrôles ? Quels sont les risques encourus en cas d’erreur ou de fraude ?

L’une des missions de l’Assurance Maladie consiste à effectuer des contrôles automatiques sur l’ensemble des facturations émises par les professionnels de santé libéraux, soit 1,5 milliard de feuilles de soins par an. Entre 2021 et 2022, 900 000 contrôles automatiques ont été réalisés pour les infirmiers libéraux. Les résultats de ces requêtes automatiques, ainsi que ceux provenant d’alertes ou de l’exploitation de signalements, peuvent conduire à des contrôles plus poussés.
Indus : deux types de contrôles
L’Assurance Maladie peut ainsi procéder, vis-à-vis des infirmiers libéraux, à deux types de contrôles : le contrôle administratif ou le contrôle médical. Le choix s’opère au moment de l’analyse des données du professionnel de santé. « Si nous avons besoin de contrôler uniquement des éléments d’ordre administratif en lien avec les règles de la facturation, le respect de la cotation et de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), le contrôle sera strictement administratif », explique Fabien Badinier, directeur adjoint Contrôles et lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie.
Cet article a été publié dans le n°52 d’ActuSoins magazine (avril 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Si l’Assurance Maladie a besoin, pour comprendre le dossier, d’accéder aux données médicales des patients, le contrôle devient « médical ». La procédure, encadrée par l’article L315-1 du Code de la sécurité sociale, est effectuée sous la responsabilité du médecin conseil.
« L’Assurance Maladie engage ainsi une analyse individuelle d’activité, effectuée par les équipes médicales de l’Assurance Maladie, indépendantes », précise Fabien Badinier. Dans le cadre de cette procédure, plus longue, l’infirmier est informé par courrier de la démarche et des patients qui seront auditionnés. La Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) détient la possibilité d’analyser les facturations des trois dernières années d’activité et, en cas de fraude avérée, des cinq dernières années. « Nous allons alors étudier le comportement de facturation de l’infirmier et éventuellement le comparer à celui de ses confrères », rapporte le directeur adjoint.
Pour clarifier cette distinction, un exemple : si la Cpam examine une suspicion de cumul de facturation d’actes résultant d’un double envoi des flux – intentionnel ou accidentel – de la part de l’infirmier, le contrôle reste strictement administratif. En revanche, si dans le cadre de la facturation du Bilan de soins infirmiers (BSI), la Cpam constate qu’un infirmier ne facture que des BSC, elle doit alors accéder aux données médicales des patients pour déterminer si, pour chaque patient, la facturation est adaptée à son état de santé ou non.
Dans le cadre des différents contrôles, après l’étude de l’ensemble des éléments du dossier, un constat d’anomalies est envoyé à l’infirmier. Débute alors la procédure du contradictoire. L’infirmier libéral dispose d’un mois pour présenter ses observations par courrier ou au cours d’un rendez-vous sollicité auprès de la Cpam. Ce premier échange lui offre l’opportunité de justifier ses cotations sans pour autant engager une démarche contentieuse. À l’issue de cette première étape du contradictoire, la Cpam a deux choix : enclencher une procédure au pénal ou au civil.
Indus : l’action au pénal

« La décision d’enclencher une action contentieuse, ordinale, pénale ou administrative, se décide en fonction de la qualification juridique des faits incriminés à la suite de notre analyse », explique Fabien Badinier. Il est ainsi possible, pour l’Assurance Maladie, de porter plainte au pénal en cas de délit d’escroquerie, de faux et usage de faux, et d’exercice illégal de la profession. « L’Assurance Maladie ne va cependant pas porter plainte au pénal dès le premier euro », précise-t-il. Le Code de la sécurité sociale (article L144-9) fixe à huit fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 30 000 euros, le seuil à partir duquel elle doit porter plainte. Ainsi, la qualification des faits, le montant du préjudice et les antécédents sont des éléments déterminants pour orienter la décision de l’Assurance Maladie quant au dépôt ou non d’une plainte contre l’infirmier. En cas de dépôt de plainte, aucune notification d’indus n’est envoyée à l’infirmier car le montant des dommages et intérêts envisagé pour la réparation du préjudice est intégré à la plainte. Par ailleurs, si le ministère public décide d’instruire la plainte, les services d’enquêtes peuvent, si besoin, procéder à une perquisition au cabinet ou au domicile de l’infirmier et, dans des cas plus rares, le placer en garde à vue.
Les peines encourues par l’infirmier sont prévues par le Code pénal. En cas d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, il risque sept ans de prison et 750 000 euros d’amende ; pour faux et usage de faux, trois ans de prison et 45 000 euros d’amende ; pour exercice illégal de la profession, deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. S’ajoute le paiement des dommages et intérêts demandés par la Cpam. En parallèle d’un dépôt de plainte, la Cpam peut également saisir l’Ordre des infirmiers en cas de non-respect des règles de déontologie.
Indus : la procédure au civil
À la suite d’un contrôle, la Cpam peut décider d’enclencher une action au civil. Après la procédure du contradictoire, elle procède à une notification d’indus envoyée par lettre recommandée, ce qui enclenche une nouvelle échéance de deux mois. « Lors des contrôles administratifs sur la facturation, dans certains cas, notamment pour les cumuls de facturation d’actes, nous n’avons pas besoin de procédure contradictoire en amont de la notification de l’indu car les faits sont suffisamment parlants, explique Fabien Badinier. La caisse va, de fait, directement notifier l’indu par courrier, mais le professionnel de santé pourra tout de même présenter ses observations ou saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la Cpam. »

Après avoir reçu sa notification d’indus, l’infirmier a trois options : reconnaître son erreur et payer dans le délai imparti, soumettre des observations pouvant éventuellement conduire à une baisse des indus ou saisir la CRA de la Cpam, initiant ainsi la procédure pré-contentieuse. L’infirmier doit alors fournir tous les éléments de preuve lui permettant de s’opposer à ce qui lui est reproché : les ordonnances, les ententes préalables, etc. L’accompagnement par un avocat peut être pris en charge par les assurances en responsabilité civile. À réception des documents, la CRA dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Elle peut reconnaître le bien-fondé de la contestation du professionnel et annuler la notification. Sinon, la procédure se poursuit, à l’initiative de l’infirmier, devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui doit être saisi sous deux mois par lettre recommandée. Une fois que le tribunal a accusé réception de la demande, il lui revient de fixer les délais et la date de la plaidoirie. Les procédures peuvent s’étendre sur une période allant d’un à deux ans. L’audience se déroule devant un magistrat professionnel, qui rend son délibéré dans un délai d’un à deux mois. En cas de condamnation au paiement de l’indu, l’infirmier peut également avoir à payer les frais de procédure. En parallèle, la Cpam peut enclencher la procédure des pénalités financières, une sanction administrative à la main des directeurs de Cpam. Le montant maximal pouvant être demandé est de 50 % du préjudice ou, en cas de fraude, de 300 % du préjudice subi par la Cpam.
Se former à la cotation
« Il est indispensable de bien comprendre les règles de facturation et de cotation, conseille Fabien Badinier. En cas de doute, l’infirmier doit interroger sa Cpam et non demander conseil à un confrère, au risque de prendre de mauvaises habitudes de facturation. » Il existe des formations, et les Cpam ont mis en place un dispositif d’accompagnement pour les professionnels de santé libéraux dès leur installation. « Nous l’avons développé pour les infirmiers, car il s’agit de la profession pour laquelle il y a le plus d’installations annuelles », indique-t-il. À l’issue des trois à quatre premiers mois d’exercice, les Cpam organisent habituellement des contrôles rapides pour s’assurer que l’infirmier ne prenne pas de mauvaises habitudes. Un deuxième contrôle est effectué un an plus tard pour les mêmes raisons.
Des mesures de contrôle hors champ conventionnel
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023, le gouvernement intègre, par la voie législative, des procédures de contrôles concernant l’activité des infirmiers libéraux. L’année dernière, c’est le contrôle par extrapolation qui a été introduit au Code de la sécurité sociale. « Les Cpam peuvent désormais examiner une partie de l’activité de l’infirmier, puis calculer les indus qu’elles réclament en extrapolant sur l’ensemble de l’activité, les résultats de contrôles par échantillon, explique Maître Thony Thibaut. Il appartient donc à l’infirmier de prouver que la facturation est conforme en dehors de la période contrôlée. »
Plus récemment, dans le cadre de la LFSS 2024, le gouvernement a introduit une mesure (article 7) prévoyant l’arrêt de la prise en charge des cotisations des infirmiers libéraux par l’Assurance Maladie, dès lors qu’elles font l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière, d’une sanction ou d’une condamnation pénale. L’organisme d’Assurance Maladie pourra ainsi procéder à l’annulation de tout ou partie de sa participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement. Les syndicats représentatifs des infirmiers libéraux dénoncent ses mesures mises en place hors champ conventionnel.
Cette procédure pose d’autant plus de problèmes que, selon l’Assurance Maladie, une erreur répétée peut être interprétée comme une fraude, alors que les syndicats estiment que ce n’est pas systématiquement le cas. Il relève néanmoins de la responsabilité des infirmiers libéraux de maîtriser la cotation de leurs actes.
Laure Martin
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
Lire aussi sur ActuSoins :
 Notre série en plusieurs volets, sur les indus des infirmiers libéraux
Notre série en plusieurs volets, sur les indus des infirmiers libéraux
Quand les infirmiers libéraux sont contrôlés (1er volet de la série “indus”). Janvier 2019.
Infirmiers libéraux et indus : les procédures menées par les CPAM (2e volet de la série “Indus”). Février 2019
Infirmiers libéraux et indus : pourquoi un tel comportement des CPAM ? (3e volet de la série “Indus”). Mars 2019
Demande d’indus : quel rôle pour les syndicats? (4e volet de la série “Indus”). Avril 2019.
Indus : le point de vue de la Cnam (5e volet de la série “Indus”). Mai 2019.
Fraudes, erreurs, ou acharnement ? Les infirmiers libéraux face aux CPAM. Mars 2016.
Litiges et indus : les infirmiers libéraux face aux CPAM Novembre 2016
Cherbourg : un infirmier libéral dénonce des indus en faisant une grève de la faim Septembre 2018
Infirmière libérale : tous les indus ne sont pas dûs… la preuve ! mai 2017
Fraudes, indus : une infirmière libérale s’est défendue et a été relaxée octobre 2015




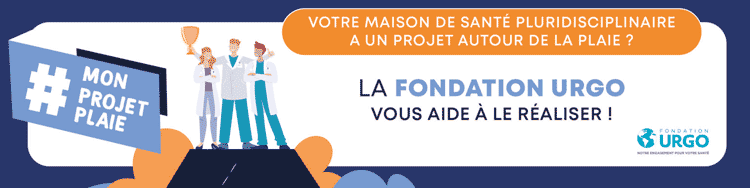






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.