Lorsqu’ils réalisent des ponctions veineuses, les infirmiers se conforment à de nombreuses recommandations. Une rigueur est essentielle pour prévenir les complications, garantir la fiabilité des prélèvements et interpréter les résultats biologiques.
Multiples sites de ponction

Chez l’adulte, les veines superficielles de l’avant-bras sont généralement privilégiées, notamment celle du pli du coude, qui est de plus gros calibre et généralement moins douloureuse lors de la ponction, par rapport aux veines situées sur le dos de la main.
Seul un capital veineux pauvre, fragile (personnes très âgées) ou difficile (prématurés, nourrissons), peut contraindre l’infirmier à effectuer le prélèvement en artériel, par voie capillaire ou par ponction sur les veines du membre inférieur.
Le prélèvement sanguin peut aussi être réalisé sur des patients disposant d’un cathéter artériel, d’une voie veineuse centrale (VVC), d’un Midline ou PiCCline*, voire d’une chambre implantable. Cet acte, particulièrement délicat, nécessite une asepsie extrêmement rigoureuse et un rinçage méticuleux pour éviter l’occlusion du dispositif. Il concerne essentiellement les patients hospitalisés en réanimation, en soins intensifs ou ceux pris en charge au bloc opératoire.
>> LIRE AUSSI – préparation des prélèvements sanguins pour bilans biologiques >>
Contre-indications de la ponction veineuse
La ponction veineuse périphérique est contre-indiquée sur une zone cutanée présentant une inflammation, une infection ou un œdème.
Il est également formellement contre-indiqué de ponctionner un bras perfusé, hémiplégique ou porteur d’une fistule artério-veineuse (FAV).
Dans le passé, le curage axillaire (CA) était considéré comme une contre-indication formelle à la prise de sang. Les recommandations ont évolué et permettent aujourd’hui de ponctionner le bras de patientes ayant subi cette intervention (voir encadré).
Risques et complications de la ponction veineuse
Il existe différents types de risques associés à la ponction veineuse périphérique. L’un des plus courants est l’apparition d’un hématome au point de ponction. Pour l’éviter, une compression de la zone pendant trente secondes à une minute après le retrait de l’aiguille est recommandée, un temps qui peut être prolongé si le patient est sous anticoagulants. Avant de finaliser avec la pose d’un pansement, il est primordial de s’assurer de l’arrêt complet du saignement.
La douleur, fréquente chez l’enfant ou le patient régulièrement ponctionné, peut être évitée par l’utilisation de patch anesthésiant. Les malaises vagaux, qui résultent souvent d’une anxiété ou d’une phobie des aiguilles, sont également à surveiller. Ils sont relativement habituels et peuvent être évités en créant un climat de confiance et en utilisant la respiration ou des techniques de communications positives (distraction, confusion etc.).
Parfois, la ponction peut échouer. Ce risque est plus élevé chez les personnes très âgées, dont le capital veineux peut être plus pauvre ou fragilisé et chez les jeunes enfants.
Une erreur courante à noter est la fausse croyance selon laquelle, si le sang ne coule plus, l’aiguille n’est plus dans la veine. En réalité, une pression élevée dans le tube de prélèvement peut collaber la veine autour du biseau, bloquant ainsi le flux sanguin. Une mobilisation délicate de l’aiguille peut, dans la plupart des cas, rectifier la situation sans avoir besoin de repiquer le malade.
L’attention doit également être portée à la durée du prélèvement. Si celui-ci est trop long, il y a un risque important d’hémolyse de l’échantillon qui implique un nouveau prélèvement. De même, le respect de l’ordre des tubes et leur remplissage correct sont des étapes cruciales pour garantir la fiabilité du prélèvement.
Enfin la vérification de la parfaite conformité de l’identité (identitovigilance) du patient avec les étiquettes (nom, prénom et date de naissance) est indispensable. L’infirmier qui a prélevé les échantillons, doit étiqueter luimême les tubes une fois le prélèvement réalisé, remplir les bons de laboratoire et compléter toutes les informations nécessaires.
Laurence Piquard, infirmière anesthésiste *
Actusoins n° 28 – Cathéters Midline et PiCCline : des indications différentes – Mars 2018
Quelques astuces pour « faire gonfler les veines »
- Positionner le bras en déclive
- Ouvrir et fermer le poing une dizaine de fois avant de poser le garrot
- Utiliser éventuellement une serviette chaude
- Utiliser de l’alcool à 70°
- Tapoter « vigoureusement » sur la veine pour la faire gonfler`
- Utiliser des techniques de communication thérapeutique afin de distraire le patient de ce soin parfois redouté
À noter : si l’utilisation de patch anesthésiant insensibilise la surface de la peau, celui-ci peut rendre la ponction plus difficile en entrainant une légère vasoconstriction.
Gare au garrot !

Si le garrot reste en place pendant plus de trois minutes, il peut causer une hémolyse des globules rouges, compromettant ainsi la fiabilité des résultats d’analyses, en particulier la kaliémie.
Principes généraux
- Prélever le bras opposé à la perfusion ou porteur d’une FAV
- Respecter l’ordre de prélèvements des tubes et le niveau de remplissage
- Ne jamais ouvrir les tubes
- Limiter le temps de garrot (1 à 2 minutes max)
- Homogénéiser tous les tubes par 5-10 retournements lents
- Acheminer rapidement les tubes au laboratoire
Dans son article très intéressant « Lymphœdème : Mythes et réalités », Stéphane Vignes* apporte un regard neuf sur les recommandations données aux patientes ayant un lymphœdème après traitement d’un cancer du sein. En se basant sur une revue exhaustive de la littérature, Stéphane Vignes remet en question certaines croyances solidement ancrées dans la pratique infirmière. Il souligne notamment que la ponction veineuse ou la pose d’une voie périphérique n’augmentent pas le risque de survenue d’un lymphœdème (LPD). En pratique, le bras non opéré est toujours privilégié lors de la prise de TA, de ponction veineuse ou de pose de VVP. Toutefois, dans certaines situations spécifiques, comme après une opération ou un traumatisme, il est désormais envisageable de ponctionner le bras ayant subi le curage, sans accroître le risque de lymphoedème ou d’infection.
* Lymphœdème : mythes et réalité – Stéphane Vignes – Unité de Lymphologie – Fondation Cognacq-Jay – Hôpital Paris
Résultats d’analyses médicales et interprétation
Lorsqu’un résultat biologique révèle une anomalie, les infirmiers doivent réagir et alerter l’équipe médicale afin que celle-ci adapte le traitement ou poursuive les explorations.
Rappel des normes. La numération formule sanguine (NFS)
Cet examen des cellules sanguines permet de révéler de nombreuses pathologies, telles que l’anémie, les infections ou les problèmes de coagulation.
Le taux d’hématies oscille entre 4,5 – 5,5 millions/mm3, celui des leucocytes entre 4 000 – 10 000/mm3 et celui des plaquettes entre 150 000 – 450 000/mm3.
Le taux d’hémoglobine varie entre 12 et 14 g/100 ml chez la femme, entre 14 et 16 g/100 ml chez l’homme.
L’hématocrite, qui représente le rapport du volume de globules rouges au volume total de sang, dépend de l’âge et du sexe. Chez les femmes, ce taux varie entre 37 et 50 % ; chez les hommes, il se situe entre 40 et 55 %.
Bilan d’hémostase
Le Taux de Prothrombine ou TP
Le TP explore la voie exogène de l’hémostase, ciblant en particulier les facteurs de la coagulation (II, V, VII, X). En mesurant le temps de coagulation, il est possible de détecter une anomalie, de surveiller un patient sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K (AVK) et de prévenir les risques hémorragiques.
Pour les patients n’étant pas sous anticoagulants, le TP se situe entre 70 et 100 %. Pour ceux sous traitement AVK, il se trouve entre 25 et 35 %. Pour tout résultat inférieur à 25 %, le risque hémorragique est majeur.
L’International Normalized Ratio ou INR : 1.0 (norme sans traitement)
L’INR est uniquement prescrit aux patients sous AVK, que ce soit à la suite d’une thrombose veineuse, d’une d’embolie pulmonaire ou en présence d’une prothèse valvulaire mécanique.
L’INR sert de référence, avec une valeur normale de coagulation fixée à 1.0 dans la population générale. Ainsi, pour un patient sous AVK, un INR compris entre 2.0 et 3.0 indique que son sang coagule deux à trois fois plus lentement que la moyenne. Un résultat supérieur à 5 traduit un risque hémorragique important.
INR = TQ malade = 2.0 à 3.0 en fonction de l’objectif
TQ témoin thérapeutique recherché
Le Temps de Céphaline Active ou TCA
Le TCA est un examen qui sert à explorer la voie endogène de la coagulation, en se concentrant sur des facteurs spécifiques (XI, XII, IX, VIII, X, V, II). Il est également utilisé pour contrôler l’efficacité traitement chez les patients recevant de l’héparine en intraveineuse. Le TCA s’exprime sous forme d’un rapport entre le TCA du patient et un TCA témoin. Une valeur normale oscille entre 28 et 38 secondes, tandis que pour les patients sous héparine, elle doit être de 1,5 à trois fois celui de référence. Une prolongation excessive du TCA indique un risque significatif d’hémorragie.
Dosage du Fibrinogène (Facteur I) : 2 – 4 g/l
Le fibrinogène est une glycoprotéine qui se transforme en thrombus lors de la coagulation finale. Très sollicité en cas de choc hémorragique, son dosage permet de dépister un trouble de la coagulation, voir une coagulation intravasculaire disséminée.
Les D- Dimères : inférieur à 500 μg/l
Il s’agit d’un produit de dégradation spécifique de la fibrine. Son élévation montre une fibrinolyse excessive, suite à une coagulation. Son dosage est important dans l’approche diagnostique de la maladie thromboembolique veineuse ou en cas d’embolie pulmonaire. Cependant, il existe de nombreux facteurs augmentant les D-Dimères (chirurgie récente, âge, cancer…), rendant son interprétation difficile*.
Ionogramme sanguin
Sodium : 135 – 145 mmol/l
L’hyponatrémie survient lors de pertes digestives importantes (diarrhées, vomissements), l’utilisation de diurétiques, une insuffisance cardiaque ou rénale, un apport hydrique trop important.
L’hypernatrémie est la conséquence directe d’une déshydratation. Elle peut être provoquée par des pertes digestives importantes, une insuffisance d’apport hydrique ou une surcharge de sodium.
Potassium : 3,5 – 4,5 mmol/l
L’hypokaliémie peut survenir suite à des vomissements, des diarrhées importantes, ou en raison d’une prise de diurétiques ou de laxatifs.
L’hyperkaliémie peut survenir lors d’une insuffisance rénale, un phénomène de lyse cellulaire massive (brûlures, rhabdomyolyses), ou la consommation de certains médicaments…
L’hyperkaliémie comme l’hypokaliémie ont des conséquences graves sur l’organisme, notamment sur le coeur !
Chlore : 95 – 105 mmol/l
L’hypochlorémie survient lors de pertes digestives et rénales importantes, d’une transpiration excessive.
L’hyperchlorémie peut survenir lors de perte digestive, d’une hypoparathyroïdie ou de déshydratation importance. Dans ce dernier cas, elle est associée à une hypernatrémie.
Créatinine : 45 – 105 μmol/l (femme), 60 – 115 μmol/l (homme)
Témoin de la dégradation d’un déchet métabolique produit par l’organisme éliminé par le rein, la créatine. Son dosage permet d’avoir un reflet de la fonction rénale.
Un taux élevé de créatinine témoigne en général d’une insuffisance rénale. Un taux bas de créatinine survient principalement lors d’une myopathie.
Pour en savoir plus, lire : « L’hémostase : une incroyable mosaïque de réactions ordonnées » (ActuSoins n° 26) et « Hémostase : anomalies, examens biologiques et principaux traitements » et n° 27 (ActuSoins n° 27)
Laurence PIQUARD
IADE Infirmière anesthésiste
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI







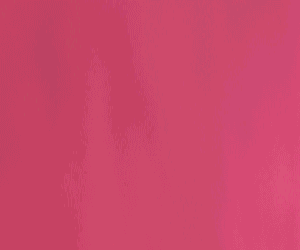
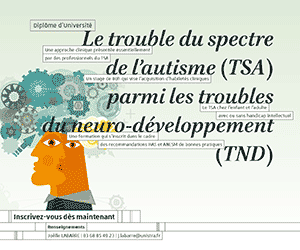




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.